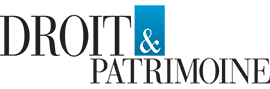Ainsi, l’intégration d’un contrat dans un groupe ne gomme pas ses caractères propres. Elle se borne à ajouter une cause de caducité. Les groupements de personnes, de biens et de contrats ne présentent en réalité qu’une analogie superficielle.
Notes
(1)
Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13.176, RDC 2012, p. 1248, obs. C. Quézel-Ambrunaz, RDC 2013, p. 101, obs. J.-S. Borghetti, JCP G 2012, n° 15, 1151, obs. P. Grosser ; Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-22.399.
Retour au texte
(2)
Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, n° 13-24.027, RTD civ. 2015, p. 119, obs. H. Barbier.
Retour au texte
(3)
H. Barbier, obs. précitées sous Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, n° 13-24.027.
Retour au texte
(4)
Cass. 3e civ., 12 juin 2014, n° 13-18.446, RDC 2014, p. 597, obs. Y.-M. Laithier.
Retour au texte
(5)
Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-19.945, JCP G 2015, 469, note R. Boffa, LPA 2015, n° 79, p. 10, note N. Bargue.
Retour au texte
(6)
N. Bargue, note précitée sous Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-19.945.
Retour au texte
(7)
Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.501, D. 2015, p. 432.
Retour au texte
(8)
Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-12.483, JCP G 2015, 373, note M. Caffin-Moi, JCP E 2015, II, 1134, note B. Dondero.
Retour au texte
(9)
Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-27.397, JCP G 2015, 216, note critique G. Viney, D. 2015, p. 657, note critique F. Rouvière.
Retour au texte
(10)
L. n° 96-1107, 18 déc. 1996, JO 19 déc. ; L. n° 65-557, 10 juill. 1965, JO 11 juill., art. 46.
Retour au texte
(11)
Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, n° 05-17.427 ; Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-12.004.
Retour au texte
(12)
G. Viney et F. Rouvière, notes précitées sous Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-27.397.
Retour au texte
(14)
Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-13.949, CEDC 2014, n° 6, obs. N. Leblond.
Retour au texte
(15)
V. notamment Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-20.972, RDC 2012, p. 838, obs. R. Libchaber.
Retour au texte
(16)
B. Teyssié, Les groupes de contrats, préf. J.-M. Mousseron, LGDJ, 1975.
Retour au texte
(17)
Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, n° 13-14.589, RTD civ. 2015, p. 130, obs. H. Barbier.
Retour au texte
(18)
Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525, RTD civ. 2006, p. 301, obs. J. Mestre et B. Fages.
Retour au texte
(20)
Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, D. 2013, p. 1658, note D. Mazeaud, D. 2014, p. 630, obs. S. Amrani Mekki et M. Mekki, RTD civ. 2013, p. 597, obs. H. Barbier, JCP G 2013, 674, note J.-B. Seube, JCP E 2013, 1403, note D. Mainguy, Contrats, conc., consom. 2013, comm. 176, par L. Leveneur.
Retour au texte
(21)
Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24.270, RTD civ. 2015, p. 128, obs. H. Barbier, Gaz. Pal. 2015, n° 95 à 99, obs. D. Houtcieff, RDC 2015, obs. J.-B. Seube.
Retour au texte
(22)
Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 02-18.277, Bull. civ. I, n° 190.
Retour au texte