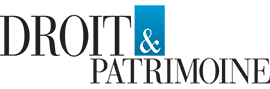A –
GÉNÉRALITÉS
Les obligations d’information du prêteur en matière d’assurance. – Une société anglaise de
factoringavait prêté des fonds à une société civile immobilière (SCI) française contrôlée quasi totalement par une personne physique. Celle-ci, pour des raisons de santé essentiellement, se trouva en mauvaise posture et ni la SCI ni l’associée majoritaire ne purent rembourser le prêteur. Celui-ci poursuivit les deux, mais se vit opposer le fait qu’il n’avait pas dispensé à l’emprunteur les bonnes informations en matière d’assurance-crédit. À la suite de la condamnation du prêteur, ce dernier introduisit un pourvoi pour contester deux points : il fit valoir que les prêts avaient été consentis avant l’entrée en vigueur de la
loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 (JO 4 janv.) relative à l’obligation de faire figurer sur l’offre de prêt immobilier la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance ; il fit aussi valoir que l’emprunteur était une personne avertie et que l’opération n’aboutissait pas à le surendetter, si bien que l’obligation de mise en garde ne s’imposait pas à lui.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2015
(7), refusa de le suivre sur les deux terrains, estimant sans doute que l’obligation d’information est intemporelle et en tous les cas antérieure à la loi de 2008. Quant au champ d’application, il est désigné comme universel. Elle affirme, par un attendu ciselé évoquant une position de principe, son indépendance par rapport au devoir de mise en garde (
001).
EXTRAITS
« Le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt »
Il s’agit clairement d’un nouveau devoir général imposé au prêteur par la jurisprudence qui l’édicte non seulement envers tous les emprunteurs mais encore demande au banquier de faire une appréciation en opportunité.
Conventions de crédit et clauses abusives. – Divers emprunteurs, soutenus par des associations de consommateurs habilitées à intervenir sur le fondement de
l’article L. 421-1 du Code de la consommation, reprochaient à une banque d’avoir inséré dans ses modèles d’offre de contrats de crédit immobilier diverses clauses qu’ils estimaient illicites en application des
articles L. 312-1 et suivants du même code, ou abusives en application de
l’article L. 132-1 du même code, et dont ils demandaient la suppression sous astreinte en vertu de l’article L. 421-6, dans sa rédaction postérieure à la
loi no 2014-344 du 17 mars 2014 (JO 18 mars) qui a permis aux associations de demander que soient déclarées non écrites ces clauses figurant dans des contrats déjà conclus. Le premier juge avait largement fait droit à leur demande, si bien que la cour d’appel fut saisie, le premier président ayant d’ailleurs arrêté l’exécution provisoire de la décision qui l’avait ordonnée.
La cour d’appel
(8) commence par écarter l’application aux contrats déjà en cours de la suppression des clauses litigieuses, car la demande était formulée pour la première fois en appel, le premier juge l’ayant prononcée d’office, droit que la Cour ne lui reconnaît pas.
La banque avait procédé elle-même, en 2014, soit en cours d’instance, à certaines modifications des clauses les plus contestées, si bien qu’une bonne partie des demandes devenaient ainsi sans objet. Dès lors, la cour examina essentiellement les clauses de remplacement. Elle valida ainsi les nouvelles clauses de «
frais d’étude » des
articles L. 312-14 et R. 312-1 du Code de la consommation, la clause de «
déchéance du terme » en ce qu’elle prévoyait désormais une mise en demeure préalable et ne permettait sa mise en œuvre que si les déclarations faites par l’emprunteur s’avéraient inexactes mais résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’emprunteur et de nature à fausser le jugement de crédit de la banque. Sont également jugées valables les clauses de déchéance du terme, après mise en demeure préalable, en cas de cession de l’immeuble financé ou affecté en garantie, celle relative au décès de l’emprunteur, sauf en présence d’un coemprunteur survivant ou paiement par l’assureur-crédit, celle relative à la non-constitution des sûretés prévues, mais seulement si elle est imputable à l’emprunteur.
En revanche, la cour d’appel invalide la clause de déchéance du terme en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble financé ou donné en garantie, estimant qu’elle est abusive, notamment si l’immeuble n’a pas été hypothéqué au profit de la banque, ou bien si l’emprunteur continue à honorer les échéances du crédit, malgré la destruction du bien. Le déséquilibre entre les droits et obligations du prêteur et de l’emprunteur est jugé ici significatif et disproportionné.
La publication de la décision est imposée à la banque sur son site Internet, ainsi que le paiement de dommages-intérêts significatifs.
C’est à un profond rééquilibrage des clauses contractuelles les plus usuelles dans les conventions de crédit que la décision invite et qui doit inciter les banques à revoir leurs modèles standards.
Contrat de swap et crédit-bail : indivisibilité. – Les contrats d’échange de devises ou de taux d’intérêt (swaps) sont des instruments – respectivement – de couverture d’un risque de taux de change ou d’un risque de taux d’intérêt, et sont de ce fait typiquement conclus à l’occasion d’une opération commerciale ou financière comportant un tel risque. Pour autant, ils ne constituent pas nécessairement de simples accessoires de l’opération sous-jacente dont ils visent à couvrir le risque. Tout dépend de la volonté des parties de lier ou non le sort des deux opérations. Elles ont évidemment intérêt à s’exprimer de façon explicite à ce sujet afin d’éviter toute discussion par la suite. Malheureusement, tel n’est pas toujours le cas en pratique et il appartiendra alors au juge de trancher si le contrat d’échange doit être exécuté indépendamment du fait que l’opération sous-jacente ait été anéantie, pour quelque raison que ce soit, voire n’ait, en définitive, jamais vu le jour.
Pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, un contrat d’échange de devises doit
a prioriêtre traité comme un contrat autonome si les parties ne l’ont pas expressément subordonné à l’opération à propos de laquelle il a été conclu et n’ont pas davantage prévu de faculté de rétractation
(9). Sous l’influence du courant jurisprudentiel admettant de plus en plus aisément l’indivisibilité ou l’interdépendance entre des contrats participant à une même opération économique, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 janvier 2015
(10), retient, au contraire, qu’un contrat de
swap de taux d’intérêt constitue l’accessoire indissociable de l’offre de crédit-bail immobilier sur laquelle il a été adossé et que, par conséquent, la caducité de celle-ci doit entraîner la caducité de celui-là.
Sa décision semble avoir été largement déterminée par les circonstances de fait. Le contrat de swap de taux d’intérêt avait été proposé par une banque dans le cadre de l’offre de financement qu’elle avait étendue à un groupement de médecins qui l’avait approchée pour financer la construction d’une nouvelle maison médicale. L’une des options du financement prévoyant des loyers financiers déterminés par rapport à un taux d’intérêt variable, le contrat d’échange de taux d’intérêt devait permettre au groupement de médecins de limiter le risque de taux d’intérêt qu’il prenait dans cette option. L’offre de crédit-bail immobilier était faite au groupement des médecins par une filiale de la banque. À la suite de différentes péripéties, cette offre ne fut jamais acceptée. Entre-temps, cependant, le groupement de médecins avait signé avec la banque le contrat de swap de taux d’intérêt. Lorsque la banque lui demanda, ou plus précisément à la SCI qui avait repris le projet, de couvrir la position débitrice du compte résultant de l’exécution du contrat de swap, la SCI rétorqua qu’elle ignorait ce contrat, et qu’en tout état de cause il ne pouvait exister valablement alors que le crédit-bail n’avait jamais été mis en place avec la banque.
Son premier argument fondé sur l’absence de cause a été rejeté par la cour d’appel, qui a considéré, de façon classique, que la cause devait s’apprécier au moment de la formation du contrat et que par conséquent on ne pouvait pas considérer que le contrat d’échange de taux d’intérêt avait été conclu sans cause.
En revanche, la cour d’appel a suivi la juridiction de première instance en ce qu’elle a considéré que le contrat d’échange était indivisible du contrat de crédit-bail immobilier proposé au groupement des médecins. Pour les magistrats : « Loin d’être une opération spéculative autonome, le contrat litigieux était adossé à l’offre de crédit-bail immobilier de sorte qu’une fois celle-ci devenue caduque faute de régularisation de l’acte authentique, il a suivi son sort ». La solution peut se comprendre, bien que sa motivation ne soit pas entièrement convaincante. La banque avait proposé au groupement des médecins une solution de financement intégrant l’option de souscrire un contrat d’échange de taux d’intérêt. Il était ainsi relativement clair que dans l’intention des parties ce dernier ne formait qu’un accessoire du contrat de financement. En d’autres mots, l’indivisibilité résultait ici de la volonté des parties, telle que les juges du fond ont pu l’interpréter sans la dénaturer.
Déduire une telle interdépendance du caractère spéculatif ou non du contrat d’échange laisse entendre qu’elle tient à la nature même du contrat ou à son objectif. Ceci paraît beaucoup plus délicat puisque le juge pourrait alors s’affranchir de l’interprétation de la volonté des parties pour apprécier si un contrat de swap doit être considéré comme autonome ou dépendant en fonction de sa qualification comme opération de couverture ou spéculative. Un tel exercice aboutissant, le cas échéant, à découvrir une indivisibilité soi-disant objective ne manquerait pas d’introduire un facteur d’insécurité juridique.
Il faut reconnaître cependant que c’est la direction que prend le projet de réforme du droit des contrats. Le nouvel
article 1186 du Code civil prévu par ce projet dispose, en effet, en son second alinéa qu’un contrat valablement formé devient caduc «
lorsque des contrats ont été conclus en vue d’une opération d’ensemble et que la disparition de l’un rend impossible ou sans intérêt l’exécution d’un autre. La caducité de ce dernier n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». La finalité du contrat plus que la volonté exprimée des parties servira à déterminer s’il constitue un élément indissociable d’un ensemble contractuel.
Contrat de vente et prêt : indivisibilité. – La question de l’interdépendance entre contrats a été portée également devant la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux affaires concernant des contrats de crédit conclus pour financer, dans la première espèce, l’acquisition et l’installation d’une éolienne et, dans la seconde, l’acquisition et l’installation d’un toit photovoltaïque. Par deux arrêts rendus le même jour, la Haute juridiction a considéré que les juges du fond avaient à juste titre retenu que le sort des deux contrats était lié
(11). Dans les deux cas, les crédits avaient été proposés à des particuliers qui souhaitaient profiter des avantages, notamment d’ordre fiscal, attachés à certaines installations de production d’énergie dite « propre ». La valeur de cette installation, et donc des crédits, dépassait cependant le seuil, alors en vigueur, des opérations pour lesquelles le Code de la consommation prévoit expressément que le financement doit être considéré comme un accessoire du contrat de vente. Les parties n’avaient pas choisi non plus de soumettre volontairement les contrats de crédit en question à ce régime protecteur pour l’emprunteur.
C’est dès lors sur la base d’une appréciation des circonstances de fait que les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, ont estimé que les contrats de vente et de prêt formaient économiquement un tout indivisible. Dans les deux affaires, le financement était organisé de telle manière que les fonds, une fois libérés par le prêteur, étaient versés directement aux vendeurs. Dans la première espèce, ce déblocage était intervenu à la suite d’une attestation établie par l’emprunteur que le contrat principal avait bien été exécuté. Dans la seconde, la cour d’appel a retenu que «
l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur ». Il est difficile de tirer de ces indices une conclusion certaine sur l’intention des parties de lier ou non le sort du contrat de crédit à celui de la vente dans l’hypothèse où celle-ci se trouve être résolue, comme c’était le cas dans les deux espèces. En excluant formellement l’application des dispositions de
l’article L. 311-32 du Code de la consommation, les parties à l’une des opérations avaient plutôt indiqué que le contrat de crédit ne devait pas être subordonné au contrat de vente.
Faute de résulter de la volonté claire des parties, l’interdépendance que les juges du fond ont vue entre les deux contrats ne pouvait dès lors être déduite que de l’économie générale de l’opération. Les hypothèses dans lesquelles les juges ont tendance à considérer ainsi deux contrats comme objectivement indivisibles sont variées et nombreuses : contrat de location de matériel informatique et contrat de maintenance, contrat de vente d’un véhicule neuf et reprise d’un véhicule d’occasion, contrat d’édition conclu avec un parolier et contrat conclu avec le compositeur pour les chansons, contrat de fourniture de gaz et contrats d’exploitation de la chaufferie, etc… Souvent, il ne s’agit, comme l’a fort bien observé Jean Boulanger, que de couvrir «
d’une apparence flatteuse une solution d’opportunité »
(12).
Était-ce le cas également dans les deux espèces évoquées ici ? Les avis sont partagés
(13). Les éléments sur lesquels se sont fondés les juges du fond et que reprend la Cour de cassation ne paraissent pas déterminants en soi pour soumettre le sort des contrats de crédit à celui des contrats de vente. En même temps, on sait que ce genre d’investissement dans la production d’énergie « propre » est proposé aux particuliers comme un tout dont le financement, négocié le plus souvent préalablement par le vendeur avec des établissements de crédit, fait partie intégrante. Entre les contrats formant cet ensemble, le degré d’interdépendance n’est alors pas moins élevé que celui qui lie un contrat de location financière à un contrat de prestation de services portant sur le même objet que la Cour de cassation considère comme indissociablement unis
(14). La solution ne paraît donc pas injustifiée.
Pour le prêteur, elle n’est évidemment pas neutre puisque c’est lui, en définitive, qui va subir le risque et les conséquences d’une résolution du contrat de crédit provoquée par la résolution du contrat de vente. En principe, l’emprunteur devra lui rembourser les fonds prêtés même si ceux-ci ont été versés entre les mains du vendeur. Le recours contre l’emprunteur s’avérera d’autant plus crucial si le vendeur se trouve, comme dans les deux espèces commentées, en difficulté financière. Mais le danger du prêteur est d’être tenu responsable vis-à-vis de l’emprunteur pour ne pas avoir vérifié si le contrat de vente a bien été exécuté avant de débloquer les fonds. C’est ce qui s’est passé dans l’une de ces affaires. L’attestation de livraison jointe à la demande de financement était, selon les juges du fond, ambiguë et ne permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal. Ils en ont déduit que la banque avait commis une faute en omettant de s’assurer, au-delà de cette attestation, de la bonne exécution du contrat de vente. La sanction est sévère puisque la banque se trouve ainsi privée de son droit d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
B –
GARANTIE DES CRÉDITS
Cautionnement et mention de sa durée. – Les conditions de forme imposées pour la validité du cautionnement souscrit par un particulier envers un professionnel continuent à alimenter le contentieux, comme en témoignent notamment deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 9 juillet 2015, sur des questions qui n’avaient pas encore été portées devant la Haute juridiction.
Dans la première affaire
(15), il s’agissait de savoir de quelle manière la durée de l’engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite.
L’article L. 341-2 du Code de la consommationimpose l’indication de la durée dans cette mention manuscrite, mais ne précise pas la façon dont elle doit apparaître.
Un particulier avait donné son cautionnement à une banque pour couvrir les engagements d’une société à responsabilité limitée. La mention manuscrite précédant sa signature précisait que son engagement valait «
pour la durée de l’opération garantie plus deux ans ». Le corps de l’acte de cautionnement indiquait bien que l’opération garantie était conclue pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. La cour d’appel de Montpellier a cependant estimé que cette précision était insuffisante pour s’assurer que la caution était pleinement consciente de la durée de son propre engagement. Elle est suivie par la Cour de cassation, pour qui, «
s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention (de la durée)
devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ». La solution peut paraître sévère, mais elle a le mérite de clarifier un point laissé dans l’ombre par
l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Cautionnement et illettrisme. – Protéger le consentement d’une personne en exigeant de sa part qu’elle appose sur l’acte qu’elle approuve une mention manuscrite par laquelle elle rappelle les éléments essentiels de son engagement n’est pas une solution qui fonctionne pour tout le monde. Elle est inapplicable aux personnes privées de l’usage de leurs mains ou de leur vue et inefficace pour celles incapables de comprendre le sens des mots ou tout simplement incapables d’écrire et de lire.
Une banque s’est trouvée confrontée à cette difficulté lorsqu’elle a voulu obtenir le cautionnement d’une personne illettrée. Soucieuse de respecter, du moins en apparence, l’exigence de
l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la banque avait fait apposer par l’un de ses employés la mention manuscrite requise par ce texte avant de le soumettre à la caution illettrée pour signature. Pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le procédé n’était pas acceptable et l’engagement de la caution devait dès lors être considéré comme nul. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt par la banque bénéficiaire du cautionnement
(16).
Pour la Cour, «
la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommationdestinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ». On pouvait difficilement admettre que l’effet recherché par ces dispositions était susceptible d’être atteint lorsqu’une personne se contente d’apposer sa signature sous la mention manuscrite rédigée par un tiers. Pour obtenir le cautionnement d’une personne illettrée, la banque doit recueillir son consentement soit, comme le suggère la Cour, à travers un acte authentique, soit à travers un acte sous seing privé contresigné par un avocat. L’un et l’autre sont dispensés du respect de toute mention manuscrite exigé par la loi, sauf dispositions dérogeant expressément à cette règle. La protection de la caution est assurée dans ce cas par le conseil que lui doit le notaire ou l’avocat.
Cautionnement et clauses de conciliation. – La distinction entre les exceptions que la caution peut opposer au créancier et celles qui n’affectent pas son engagement continue à soulever des difficultés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 octobre 2015
(17), vient de prendre position sur la possibilité pour une caution d’invoquer le non-respect d’une clause de conciliation convenue entre le débiteur principal et le créancier.
La clause figurait dans le contrat de prêt couvert par le cautionnement et prévoyait « qu’en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». Se heurtant au défaut de remboursement du crédit, la banque prêteuse agit immédiatement en justice contre l’emprunteur et la caution, sans se soucier d’engager la procédure de conciliation. La cour d’appel retient la fin de non-recevoir opposée par la caution à la banque, au motif que « l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite dont elle définit les modalités, préside à son admission et sa mise en exécution ».
Son arrêt est cassé sur ce point par la Cour de cassation, pour qui la procédure de conciliation ne touchait « que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer » au créancier.
La Cour de cassation fonde sa décision visiblement sur une analyse dualiste de la dette. L’engagement de la caution et celui du débiteur principal reposent sur le même « debitum », mais comportent chacun leur propre « obligation ». L’engagement pris par le créancier vis-à-vis du débiteur principal de recourir d’abord à une procédure de conciliation avant de l’assigner en justice ne touche qu’à son droit de recours contre le débiteur principal. Il n’affecte pas la dette à proprement parler. Il est logique que la caution ne puisse pas se prévaloir du non-respect d’un engagement qui ne vaut que vis-à-vis du débiteur principal. L’analyse est cohérente avec celle que retient la Cour de cassation à propos de l’impossibilité pour la caution de se prévaloir du délai de forclusion empêchant le recours contre le débiteur principal ou encore de l’impossibilité pour elle d’opposer au créancier sa renonciation à exercer une action justice contre le débiteur principal.
Le raisonnement fondé sur une analyse dualiste de l’obligation ne permet cependant pas de résoudre toutes les questions que soulève la délicate distinction entre les exceptions opposables par la caution et celles qui ne le sont pas. Il ne permet pas en particulier de cerner avec précision le champ des exceptions dites « purement personnelles » qui, depuis un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 juin 2007, fait l’objet de vifs débats. Il est gênant que les opérateurs économiques restent dans l’incertitude sur des questions si essentielles. Il faut espérer que le législateur vienne prochainement régler définitivement le sujet.
Cautionnement et disproportion. – Une banque qui bénéficie d’engagements successifs des mêmes cautions doit être particulièrement attentive pour vérifier le caractère proportionné de ces engagements par rapport aux ressources des cautions. Un
arrêt de la Chambre commerciale du 29 septembre 2015(18) illustre comment elle peut se trouver piégée dans une telle situation. Deux époux s’étaient portés cautions à deux reprises d’engagements de sociétés, mises par la suite en redressement judiciaire. Dans un premier temps, ils avaient garanti de façon solidaire et à concurrence de 312 000 euros chacun le remboursement d’un prêt de 480 000 euros. Six mois plus tard, les mêmes cautions s’engageaient solidairement à garantir le remboursement de deux autres prêts à concurrence de 23 000 et 54 000 euros. Devant la cour d’appel, les cautions ont obtenu l’annulation des premiers cautionnements pour non-respect de l’exigence de proportionnalité, mais restèrent tenues par les seconds engagements. La Cour de cassation confirme l’annulation des premiers cautionnements tout en estimant que les seconds devaient également être annulés en raison de leur caractère disproportionné par rapport aux ressources des cautions.
La Cour de cassation rappelle utilement que l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution doit être faite en se plaçant à l’époque où celui-ci a été pris. Il doit alors être tenu compte de toutes les obligations qui sont à ce moment à la charge de la caution et qui ont été portées à la connaissance du créancier. En revanche, les obligations ultérieurement souscrites par la caution envers le même créancier n’ont pas à être prises en considération même si elles étaient déjà prévisibles à ce moment.
Le caractère disproportionné des premiers cautionnements tenait, en l’espèce, à une certaine ambiguïté des actes. Chacun des époux s’étant obligé solidairement à concurrence de 312 000 euros, la cour d’appel a considéré que leurs engagements les exposaient à un risque cumulé de 624 000 euros que leurs ressources ne suffisaient pas à couvrir. Le calcul est contestable dans la mesure où le prêt couvert n’était que de 480 000 euros. Mais en réclamant à chacune des cautions la somme de 312 000 euros, la banque s’était d’une certaine façon piégée elle-même.
L’annulation des premiers cautionnements avait conduit la cour d’appel à valider les seconds, en estimant que leurs montants plus modestes n’étaient plus disproportionnés par rapport aux ressources des cautions. Dans une vue d’ensemble, l’appréciation n’était pas inexacte. Mais le raisonnement manquait de tenir compte du fait que la banque doit vérifier le caractère proportionné ou non de l’engagement au moment où elle le sollicite. Or, à ce moment précis, les premiers cautionnements n’étaient pas encore annulés. Pour la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel devait donc être censuré sur ce point. Sa solution peut se comprendre au regard des termes de
l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Mais est-elle vraiment en ligne avec la finalité de ce texte ? S’il s’agit de protéger la caution contre un engagement excessif au regard de ses capacités financières, il serait logique que le juge saisi d’une demande en annulation puisse tenir compte de la situation réelle et ainsi du fait que la caution s’est trouvée déchargée de certains engagements. Le raisonnement tenu par la Cour de cassation aboutit plus à sanctionner le bénéficiaire du cautionnement qu’à protéger la caution, ce qui ne peut pas être l’objectif du texte.
Cautionnement et proportionnalité. – La première chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation avaient des vues divergentes sur la question de savoir si, pour l’appréciation de la proportionnalité, il convient de tenir compte des espérances de gain que la caution peut tirer de l’opération financée. Si, pour la première chambre civile, les ressources de la caution pouvaient inclure les bénéfices que doit lui laisser l’opération à propos de laquelle elle s’engage, la Chambre commerciale refuse depuis un certain temps d’en tenir compte. Elle vient de le rappeler par deux arrêts en date des 22 et 29 septembre 2015
(19).
La première chambre civile s’est finalement ralliée à cette position. Dans un arrêt du 3 juin 2015
(20), elle casse un arrêt d’appel qui avait refusé d’annuler un cautionnement au motif qu’il n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de la caution si l’on tenait compte des revenus que celle-ci pouvait escompter de l’investissement réalisé par la société cautionnée dont elle était également l’associée.
Pour la première chambre civile, il s’agit là d’une mauvaise interprétation de
l’article L. 341-4 du Code de la consommation, qui impose, selon elle, «
que la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie ». Son ralliement à la position de la Chambre commerciale devrait conduire à une uniformisation de la jurisprudence des juridictions du fond qui sont restées, jusqu’à présent, également divisées sur cette question. La solution sera plus claire sans qu’elle corresponde nécessairement à l’approche la plus réaliste. En acceptant de se porter caution d’un projet dans lequel elle a un intérêt financier direct, la caution évalue son risque en tenant compte des ressources que peut lui procurer ce projet. En lui permettant de remettre en cause son engagement sans tenir compte de cette dimension, ne se fonde-t-on pas sur une situation artificielle ?
Cautionnement et exception de nullité. – Les tempéraments apportés par la jurisprudence au caractère perpétuel de l’exception de nullité ne vont pas sans soulever certaines difficultés lorsqu’ils sont appliqués à la situation d’une caution. Le fait d’empêcher notamment une caution de se prévaloir, après l’expiration du délai de prescription, par voie d’exception, de la nullité de son engagement au motif que le débiteur principal a exécuté partiellement son engagement suscite de fortes réserves en doctrine. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2015
(21), vient d’alléger les conditions dans lesquelles une caution peut se prévaloir de l’exception de nullité.
Une banque bénéficiaire d’un cautionnement avait intenté une action en paiement contre la caution trois ans après que celle-ci s’était engagée, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de prescription pour l’action en nullité. Ce n’est pourtant que quatre ans plus tard que la caution se prévalut de la nullité de son engagement.
Selon la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
(22), l’exception de nullité n’était pas recevable dans la mesure où l’action principale avait été introduite avant que l’action en nullité ne fût prescrite. La première chambre civile de la Cour de cassation refuse d’enserrer le droit de la caution de se prévaloir de la nullité dans ce carcan. D’après elle, «
la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ». Autrement dit, il importe peu que l’action principale ait été engagée avant ou après l’expiration de ce délai de prescription. Tant que la caution n’avait pas commencé à exécuter son engagement et à condition que sa propre action en nullité fût prescrite, elle restait recevable à soulever cette nullité par voie d’exception.
Signalons que l’arrêt statue également sur la proportionnalité de l’engagement de la caution, l’existence d’un prétendu dol par réticence de la banque ainsi que sur le non-respect par elle d’un prétendu devoir de mise en garde, mais sans apporter sur ces points d’éléments nouveaux.
C –
RÉMUNÉRATION DU CRÉDIT
Le taux de base bancaire, le TEG et l’objectivité de l’indice. – Une banque poursuivit un emprunteur qui ne remboursait plus le prêt qui lui avait été consenti au taux de base bancaire de la banque (TBB) majoré d’une marge. En réponse, il argua du fait que le TBB n’était pas un indice objectif et que dès lors le prêteur aurait dû porter à sa connaissance chaque variation du taux effectif global (TEG) résultant de la variation du TBB. La cour d’appel, insensible à l’argument, allait refuser la demande. Il n’en alla pas de même de la première chambre civile qui, au visa de
l’article 1907 du Code civil, cassa (
002)
(23). On observera qu’une fois de plus, on fait dire à l’article 1907, qui n’a pas varié depuis 1804, des choses qu’il ne dit ni ne suggère.
EXTRAITS
« La clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du TBB décidée par l’établissement de crédit ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs »
On se souvient que la Cour de cassation exige que, lors de la variation d’un taux stipulé variable, la modification du TEG entraînée par la variation du taux du crédit soit portée à la connaissance de l’emprunteur dans les relevés de compte
(24). L’exigence apparaît toutefois sans le moindre intérêt, si nous pouvons l’exprimer ainsi, dans la mesure où elle informe certes l’emprunteur mais ne lui offre aucune autre perspective que de subir la variation, puisqu’il est déjà dans les liens du contrat. L’exigence méconnaît la
ratio legis profonde du TEG qui est de permettre une comparaison valable afin de faire jouer la concurrence, ce qui n’a de sens qu’avant la signature du contrat.
Ensuite, la Cour de cassation avait limité l’exigence d’information au cas où l’indice n’était pas objectif
(25), concept sur lequel nombreux étaient ceux qui s’interrogeaient. Il est clair désormais, pour la première chambre civile, que tel n’est pas le cas du TBB, supposé à la main de la banque, comme si elle pouvait le faire varier abusivement et en toute impunité commerciale.
Cette jurisprudence méconnaît le contexte concurrentiel dans lequel les banques opèrent et le fait que le TBB tient nécessairement compte des conditions de refinancement applicables à toutes les banques, comme de la pression concurrentielle qu’exercent toutes les banques entre elles. Il est d’ailleurs significatif que celles-ci modifient quasi simultanément leur TBB, à la hausse comme à la baisse, lorsque leurs conditions de refinancement évoluent et elles le font pratiquement ensemble pour éviter la fuite de leurs clients vers le moins disant. Dans les années 1980, la Commission européenne s’en était émue et avait cru pourvoir déceler, dans cette quasi-identité des TBB et la simultanéité de leur modification, les indices d’une entente. Elle avait rapidement abandonné son enquête, dès qu’elle avait compris comment fonctionne le marché.
Cette jurisprudence contredit l’évolution que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait solennellement initiée en abandonnant la référence à
l’article 1129 du Code civil lorsque le prix était à la main du vendeur, pour laisser place à un contrôle
a posteriori(26). La Chambre commerciale en avait tiré les leçons pour le TBB en lui reconnaissant le même régime
(27). Il est surprenant et déstabilisant de voir aujourd’hui cette jurisprudence remise en cause. Cela générera probablement un nouveau contentieux important et de mauvais aloi, même si les banques utilisent de moins en moins le TBB comme indice de référence de leurs crédits à taux variable.
TEG et assurance. – Deux emprunteurs avaient souscrit un crédit immobilier et avaient affectés en garantie des contrats d’assurance-vie qu’ils détenaient déjà. Pour contester les mesures d’exécution lancées contre eux à la suite d’impayés, ils reprochaient à la banque de n’avoir pas inclus les frais de souscription de ces contrats dans le TEG du crédit immobilier. Fort logiquement, leur antériorité au crédit montrait bien qu’il ne pouvait en aller ainsi, le crédit ne se trouvant pas conditionné à leur souscription mais à leur seul nantissement. Le motif de rejet du pourvoi est plein de bon sens (
003)
(28) !
EXTRAITS
« Si le contrat de prêt prévoyait le nantissement de trois contrats d’assurance-vie, la souscription de ces contrats n’a pas pu leur être imposée par la banque puisqu’ils avaient été souscrits antérieurement à la date d’effet du prêt ; que la cour d’appel a pu en déduire que les frais liés à ces contrats n’avaient pas à être pris en compte pour la détermination du TEG »