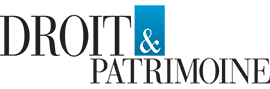Notes
(4)
V. en dernier lieu D. no 2013-319, 15 avr. 2013, précité, qui supprime la dispense de tout examen pour les anciens parlementaires ou ministres.
Retour au texte
(5)
V. en dernier lieu Déc. CNB, 15 et 16 juin 2012, en faveur de la suppression de ladite équivalence.
Retour au texte
(8)
V. notamment M. Attal, Culture judiciaire, Larcier, Bruxelles, coll. « Métiers du droit », 2e éd., 2015.
Retour au texte
(9)
L. no 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Retour au texte
(10)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2015, no 14-19.033 ; rappr. Cass. 1re civ., 19 janv. 1994, no 92-10.260.
Retour au texte
(12)
H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 14e éd., no 13.62, p. 116.
Retour au texte
(13)
B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, coll. « Précis », 24e éd., no 913, p. 681.
Retour au texte
(14)
F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 13e éd., no 1125, p. 1804.
Retour au texte
(15)
CEDH, gde ch., 23 avr. 2015, aff. 29369/10, Morice c/ France ; v. auparavant CEDH, 11 juill. 2013, aff. 29369/10, Morice c/ France ; v. également CEDH, 30 juin 2015, aff. 39294/09, Peruzzi c/ Italie ; CEDH, 4 avr. 2013, aff. 4977/05, Reznik c/ Russie.
Retour au texte
(17)
V. déjà, CEDH, 21 mars 2002, aff. 31611/96, Nikula c/ Finlande.
Retour au texte
(19)
Dr. & patr. 2015, no 250, Chronique Déontologie du barreau et du notariat, p. 68.
Retour au texte
(21)
L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars, relative à la consommation ; D. d’application no 2014-1251, 28 oct. 2014, JO 29 oct., relatif aux modes de communication des avocats.
Retour au texte
(22)
D. no 2005-790, 12 juill. 2005, JO 16 juill., relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 15, al. 3.
Retour au texte
(23)
Par renvoi à D. no 72-785, 25 août 1972, JO 29 août, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques.
Retour au texte
(24)
Dir. PE et Cons. n
o 2006/123/CE, 12 déc. 2006, relative aux services dans le marché intérieur, JOUE 27 déc., n
o L 376. On notera, non sans une pointe d’ironie, que la directive vise les communications commerciales alors que les avocats français ne sont pas autorisés à exercer cette forme d’activité. L’erreur est pardonnée, tant il apparaît difficile d’uniformiser au plan européen une profession si disparate entre les États membres. Le «
Anwaltsnotar » allemand est notaire et avocat au sens du droit français et, même si une frange importante des avocats français souhaitent la réciproque, la grande profession du droit se fait encore attendre (Source de la chambre fédérale des notaires d’Allemagne,
www.bnotk.de).
(25)
CE, 9 nov. 2015, no 386296, JCP G 2016, no 1-2, 27, note D. Landry.
Retour au texte
(27)
L’article 10.2 du RIN prévoit que : « La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l’information professionnelle de l’avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ».
Retour au texte
(29)
Une recherche rapide sur Google Images avec les termes « worst lawyer ad » fait ressortir des résultats pour le moins sidérants. On retiendra pêle-mêle : l’« avocat-gorille », l’« avocat-marteau » et des jeux de mots d’un goût douteux.
Retour au texte
(30)
L’article prohibe aussi « toute mention comparative ou dénigrante ; – toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ; – toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles ».
Retour au texte
(32)
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 18 déc. 2015, no 15/03732, JCP G 2016, no 1-2, 11 janv. 2016, 4, obs. F. G’Sell-Macrez.
Retour au texte
(33)
La jurisprudence est constante, v. Cass. com., 13 mars 1979, no 77-13.518 ; Cass. com., 22 févr. 2000, no 97-18.728 ; Cass. com., 13 févr. 2007, no 06-11.289.
Retour au texte
(34)
On se souvient ici de l’arrêt ayant jugé que la maîtresse qui aide un homme marié à violer son devoir de fidélité ne commet aucune faute, v. Cass. 2e civ., 5 juill. 2001, no 99-21.445, Bull. civ. II, no 136, RTD civ. 2001, p. 893, obs. P. Jourdain, RTD civ. 2001, p. 856, obs. J. Hauser, D. 2002, p. 1318, obs. Ph. Delebecque, Resp. civ. et assur. 2001, comm. 277, JCP G 2002, II, 10139, comm. D. Houtcieff.
Retour au texte
(35)
On rappellera utilement que les juges considèrent qu’une faute déontologique n’est pas de facto constitutive d’une faute civile (Cass. com., 10 sept. 2013, no 12-19.356, Dr. & patr. 2014, no 233, Chronique Déontologie du barreau et du notariat, p. 72 ; comp. Cass. com., 29 avr. 1997, no 94-21.524).
Retour au texte
(36)
V. le recensement opéré par Mme Dufour, O. Dufour, Les avocats à leur tour menacés d’ubérisation ?, Gaz. Pal. 5 janv. 2016, no 1, p. 9.
Retour au texte
(37)
L. no 2015-912, 24 juill. 2015, JO 26 juill., relative au renseignement.
Retour au texte
(38)
E. Pierroux, Du regrettable art perdu du secret, Gaz. Pal. 5 janv. 2016, no 1, p. 23.
Retour au texte
(39)
Cons. const., 23 juill. 2015, no 2015-713 DC, consid. 34.
Retour au texte
(41)
L. no 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Retour au texte
(43)
L. no 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Retour au texte
(44)
CEDH, 1er déc. 2015, aff. 69436/10, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c/ Portugal.
Retour au texte
(47)
V. de même, CEDH, 3 sept. 2015, aff. 27013/10, Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL c/ Portugal.
Retour au texte
(49)
V. l’étude éclairante de B. Genevois, Protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l’homme : concurrence ou complémentarité ?, RFD adm. 1993, p. 849 (avec un tableau comparatif).
Retour au texte
(50)
O. Dutheillet de Lamothe, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme : un dialogue sans paroles, in Le dialogue des juges, Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, Dalloz, 2009, p. 403 et s.
Retour au texte
(51)
Discours de Jean-Louis Debré, 2 mars 2015, 5e anniversaire de la QPC.
Retour au texte
(52)
Les décrets d’application de la loi « Macron » feront l’objet d’un commentaire dans la prochaine chronique.
Retour au texte
(56)
Cass. 1re civ., 26 févr. 2002, no 99-11.503, Bull. civ. I, no 69, Defrénois 2002, p. 1628, obs. J.-L. Aubert, JCP N 2002, no 1536, p. 1364, note V. Perruchot-Triboulet ; Cass. 1re civ., 16 mai 1995, no 93-14.330, Bull. civ. I, no 212, Defrénois 1996, p. 37, note B. Gelot.
Retour au texte
(61)
Dr. & patr. 2015, no 250, Chronique Déontologie du barreau et du notariat, p. 68
Retour au texte
(62)
J. Laurent, Flux et reflux de la dérégulation des professions, Dr. & patr. 2015, no 246, p. 86 et s., spécialement p. 91.
Retour au texte
(63)
Dir. Cons. no 93/13/CEE, 5 avr. 1993, JOCE 21 avr., no L 95.
Retour au texte
(64)
CJUE, 3 sept. 2015, aff. C-110/14, Hora iu Ovidiu Costea c/ SC Volksbank Roumânia SA.
Retour au texte
(65)
Sur ce point, il convient de noter que le contrat de crédit précise, dans sa section relative à l’objet du contrat, que le crédit est accordé pour la « couverture des dépenses courantes personnelles » de M. Costea. Cette précision permet clairement d’affirmer que M. Costea n’a pas agi pour les besoins de son activité professionnelle. Cependant, la CJUE examinant la question telle que posée par la cour de renvoi, il ne lui appartient pas de préciser correctement les faits à l’origine du litige. La cour n’exploitera donc pas cet argument qui fut soulevé par la Commission européenne et le gouvernement roumain pour rendre sa décision.
Retour au texte
(66)
CJUE, 17 juill. 2014, aff. C-169/14, Sánchez Morcillo et Abril García, § 23.
Retour au texte
(67)
J. Laurent, Flux et reflux de la dérégulation des professions, précité.
Retour au texte
(69)
Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, no 05-15.674, Bull. civ. I, no 498.
Retour au texte
(70)
Par exemple, v. Cass. 1re civ., 9 juin 1993, 2 esp., nos 91-15.563 et 91-16.565.
Retour au texte