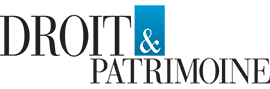I –
L’ACTUALITÉ DE L’ABUS DE DROIT
A –
CLARIFICATION BIENVENUE DE LA NOTION DE SUBSTANCE
Constatant l’irruption dans notre droit de la notion de substance en provenance de la jurisprudence communautaire, notre précédente chronique s’était longuement interrogée sur sa portée en matière d’abus de droit.
L’arrêt « Natixis » rendu par le Conseil d’État
(1) a permis de clarifier cette notion.
Les faits de l’espèce importaient assez peu : il s’agissait d’un schéma du type « Pléiades »
(2) d’utilisation abusive du régime des sociétés mères et filiales dans un cadre international (un «
Dutch Sandwich », pour les initiés) où était en débat la question de la « substance » de la société étrangère interposée à la source des dividendes perçus et exonérés en quasi-totalité d’impôt grâce au régime mère-fille. En résumé, alors que le schéma entrait à l’origine indiscutablement dans la catégorie des schémas abusifs compte tenu de la jurisprudence « Pléiades », une modification de la législation néerlandaise l’avait rendu nettement moins intéressant puisqu’un impôt non négligeable était venu grever sa rentabilité. La société Natixis en déduisait que le schéma avait été corrélativement « purgé » de son vice originel, ce à quoi le Conseil d’État lui a donné tort.
L’intérêt de la décision résulte surtout des conclusions du rapporteur public, E. Bokdam-Tognetti, qui s’interroge sur la notion de substance. Pour le rapporteur, la substance n’est pas susceptible de se définir en termes de personnel ou de moyens matériels, mais d’intérêt autre que fiscal à la structure considérée.
Il est donc inutile de chercher à renforcer en moyens matériels et humains une structure qui n’a été constituée que dans un but fiscal, mais à l’inverse une structure sans moyens peut avoir une substance juridique si la raison ayant présidé à sa mise en œuvre est intrinsèquement légitime.
Finalement, cette notion de substance n’est guère différente du concept de « but exclusivement fiscal » que nous avions l’habitude de manier depuis l’arrêt fondateur de 1981
(3), et après avoir fait couler beaucoup d’encre, il n’y a rien de nouveau sous le soleil : même dépourvue de moyens humains et matériels, l’interposition d’une société holding ne sera critiquable que lorsqu’elle ne poursuit pas un but légitime.
M. B.
B –
UTILISATION ABUSIVE DU PEA : LE CONSEIL D’ÉTAT VALIDE L’APPROCHE DU COMITÉ DE L’ABUS DE DROIT FISCAL
On sait que le plan d’épargne en actions (PEA) permet, sous certaines conditions et limites, d’exonérer d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la vente de droits sociaux. Les titres éligibles pouvant être des actions ou parts de sociétés non cotées, la tentation est forte pour des PME de mettre en place des « management packages » permettant en pratique de transformer une partie de la rémunération des cadres dirigeants en plus-values exonérées. Ce schéma est d’ailleurs bien connu de l’administration fiscale puisqu’il est en tête des montages abusifs mis en ligne en avril 2015 dont nous avons rendu compte ci-avant.
Dans plusieurs avis, le Comité de l’abus de droit fiscal
(4) a considéré que lorsque les titres étaient souscrits pour une valeur de convenance, l’abus résultait de la connaissance par le souscripteur que, compte tenu de leur valeur réelle, la souscription des titres via le PEA aboutissait à dépasser le maximum autorisé, actuellement fixé à 150 000 euros.
Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris, suivant le tribunal administratif, a jugé, le 17 janvier 2013, que dans la mesure où, à la date d’inscription des titres sur le PEA, le contribuable n’avait pas connaissance d’une négociation de vente de la société pour une valeur très supérieure, l’abus de droit n’était pas constitué.
Par une décision rendue le 10 décembre 2014
(5), le Conseil d’État a cassé l’arrêt, en rappelant que c’est la connaissance par le contribuable de la valeur réelle des actions inscrites sur le PEA à la date de leur inscription qui, lorsque cette valeur aboutissait à dépasser le plafond autorisé par le législateur, constituait l’abus de droit.
Deux conditions doivent donc être réunies : que le contribuable sache que le prix fixé s’écarte significativement de la valeur réelle des titres et qu’il s’agit donc d’une valeur de convenance, d’une part, et que compte tenu de la valeur réelle, le plafond du PEA est dépassé, d’autre part. En pratique, toutefois, sauf circonstances particulières, c’est l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur réelle qui, compte tenu des fonctions exercées par l’acquéreur dans la société dont les titres sont cédés ou dans le groupe qui cède les titres, permet à l’administration fiscale, sous le contrôle du juge, de déduire l’existence d’un prix de convenance.
En définitive, le débat va donc tourner exclusivement autour de la valeur des titres à la date de l’inscription sur le PEA, débat délicat à trancher lorsque la société n’est pas cotée et qu’aucune transaction comparable n’existe. Afin de se préconstituer la preuve que cette valeur n’aboutissait pas à dépasser le plafond autorisé, la seule solution pour les parties de bonne foi nous semble être le recours à une expertise effectuée de préférence par un expert en évaluation d’entreprise agréé près la cour d’Appel.
M. B.
C –
APPORT AVEC SOULTE : ATTENTION DANGER !
On sait que lorsqu’un contribuable apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et que cet apport est également rémunéré par une soulte d’un montant n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’apport bénéficie d’un sursis ou d’un report d’imposition de la plus-value réalisée et la soulte appréhendée n’est pas taxable.
Cette possibilité d’utiliser la technique de la soulte pour appréhender une fraction des liquidités contenues dans la société dont les titres étaient apportés a été largement utilisée sans que l’administration fiscale s’en émeuve particulièrement.
C’est maintenant terminé. En effet, dans ses commentaires du nouveau régime de report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts qu’elle a mis le 2 juillet 2015 en ligne pour consultation (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20150702), l’administration fiscale écrit ceci : « Toutefois, l’administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, notamment d’imposer la soulte reçue, s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement » (no 170).
Or, la justification d’une soulte n’est certainement pas de permettre à l’apporteur de percevoir des sommes défiscalisées, mais de rétablir l’équilibre dans le rapport d’échange des titres entre les actionnaires de la société dont les titres sont apportés et/ou ceux de la société bénéficiaire de l’apport. Lorsque l’apporteur détient 100 % de la société bénéficiaire de l’apport, aucune soulte ne paraît donc justifiée. Quant à l’intérêt économique de verser une soulte pour la société bénéficiaire de l’apport, on pourra le chercher longtemps…
Malheureusement, l’administration fiscale est fondée à rappeler qu’un tel redressement ne pourra s’effectuer que dans le cadre de la procédure de répression de l’abus de droit, avec à la clé une pénalité égale à 80 % des impôts éludés.
La seule bonne nouvelle, c’est qu’elle considère que la stipulation d’une soulte abusive n’entraînera que l’imposition de cette dernière et non la remise en cause du report ou du sursis d’imposition du reste de la plus-value d’apport, ce qui ne nous apparaît pas d’une parfaite évidence…
M. B.
D –
DONATION DÉGUISÉE ET ABUS DE DROIT : ATTENTION À NE PAS SOULEVER LE VICE DE PROCÉDURE TROP TÔT !
Par un arrêt du 23 juin 2015
(6), la Chambre commerciale de la Cour de Cassation vient enfin d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’État
(7) en matière d’abus de droit rampant. Il n’aura fallu que vingt-six ans pour que le juge judiciaire sanctionne à son tour l’administration fiscale lorsqu’elle requalifie une opération comme fictive ou fiscalement abusive sans accorder au contribuable les garanties prévues par la procédure de l’abus de droit…
Contreparties de l’application d’une pénalité de 80 %, ces garanties sont en effet de deux ordres :
- la proposition de rectification doit être visée par un fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ;
- en cas de désaccord, le contribuable doit avoir la possibilité de saisir le Comité de l’abus de droit fiscal.
De nombreuses procédures de redressement se trouvent actuellement fragilisées par cette jurisprudence : en effet, comme dans l’arrêt qui vient d’être rendu, l’administration fiscale avait pris la mauvaise habitude, lorsqu’elle estimait qu’une cession entre parties liées par des relations affectives avait été conclue pour un prix ne correspondant pas au marché, de requalifier ces ventes en donation sans invoquer explicitement l’existence d’un abus de droit.
Ce vice de procédure peut toutefois faire l’objet d’une régularisation. Il suffit pour cela que l’administration fiscale reprenne la procédure de redressement avant la commission du vice, pour autant, bien entendu, que la prescription ne soit pas déjà acquise au contribuable.
Or, en matière de droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration fiscale est de six ans, plus l’année en cours. En effet, la prescription courte triennale n’est en l’espèce pas applicable puisque ce type de redressement nécessite toujours des recherches complémentaires.
Cela signifie que dans l’hypothèse où l’administration fiscale a correctement interrompu la prescription en adressant au contribuable une proposition de rectification visée par un inspecteur divisionnaire (alors même que ce visa était motivé par l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, que l’administration fiscale applique systématiquement dans ces hypothèses), elle aura six ans, plus l’année en cours, à compter de la proposition de rectification pour régulariser la procédure en dégrevant l’imposition déjà mise en recouvrement puis en accordant au contribuable la possibilité de saisir le Comité de l’abus de droit fiscal avant de mettre à nouveau l’impôt en recouvrement à l’issue d’une procédure régulière.
Encore faut-il qu’elle y pense. Mais si c’est le conseil du contribuable qui lui en donne l’idée en invoquant ce vice de procédure alors qu’il est encore régularisable, il est à craindre qu’il n’engage alors sa responsabilité civile professionnelle.
M. B.
E –
INVESTISSEMENT EN DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET ABUS DE DROIT
On sait que par
l’article 13, 5, du Code général des impôts, le législateur a souhaité « désinciter » les contribuables de céder à titre temporaire l’usufruit d’un bien (souvent, un immeuble) qu’ils détiennent dans le but de percevoir en une seule fois la valeur capitalisée des revenus du bien selon le régime des plus-values, par hypothèse plus favorable que celui des revenus : c’est particulièrement vrai pour les revenus fonciers, qui peuvent subir jusqu’à 64,5 % d’impôt alors qu’une plus-value immobilière est totalement exonérée après trente ans de détention par le jeu des abattements.
Dans une affaire no 2014-33, le Comité de l’abus de droit fiscal a eu à connaître d’une situation où le démembrement ne portait pas sur un immeuble, mais sur les parts d’une société civile immobilière (SCI) fiscalement translucide.
Après avoir constaté que l’apport des titres de la SCI à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés avait en pratique permis à ses associés d’éviter l’impôt sur le revenu, le Comité a sanctionné le schéma au motif de l’absence de substance de la société.
Il faut dire que le cas était particulièrement caricatural : la société civile usufruitière n’avait même pas de compte bancaire ! Surtout, alors qu’elle était usufruitière de la totalité des parts de la SCI, elle ne se versait des dividendes que pour des montants très limités, alors pourtant que le droit aux dividendes est la prérogative fondamentale de l’usufruitier. Enfin, le fait qu’elle n’avait d’autre actif que l’usufruit des parts de la SCI et qu’elle n’exerçait aucune autre activité démontrait qu’elle n’avait été créée que pour cela.
Nous ne pensons toutefois pas que cet avis condamne systématiquement ce type de schéma, mais qu’il doit plutôt inciter les praticiens à la vigilance. Lorsque l’immobilier acquis est professionnel et que l’usufruit des parts de la SCI est détenu par la société d’exploitation, il n’y a, selon nous, aucun problème à redouter. Lorsque l’usufruit des parts est le seul actif possédé par la société usufruitière, il faut veiller à ce que la totalité des bénéfices de la SCI lui soit bien distribuée, y compris les bénéfices comptables qui excèdent l’excédent de trésorerie perçu : en effet, la créance que la société usufruitière va ainsi constater sur la SCI et qu’il faudra bien que cette dernière finisse par lui rembourser apportera la preuve indiscutable que, pour elle, cette opération aura présenté un réel intérêt économique.
M. B.
II –
L’ACTUALITÉ EN MATIÈRE PÉNALE
A –
UN PAS SUPPLÉMENTAIRE VERS L’INTERDICTION DU CUMUL DES SANCTIONS FISCALES ET PÉNALES ?
Dans la chronique de l’année dernière, nous avions mentionné la nouvelle étape vers l’interdiction du cumul des sanctions administratives et pénales en France franchie à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant écarté la réserve formulée par l’Italie en des termes très proches de la réserve française à propos de l’application de l’article 4 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l’homme
(8). Cette année, c’est une
décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 qui pose pour la première fois en France l’interdiction du cumul des sanctions administratives et pénales
(9). Cette décision a été rendue à propos du cumul des poursuites et des sanctions pour un manquement d’initié sur le fondement de
l’article L.621-15 du Code monétaire et financier et pour le délit d’initié sur le fondement de
l’article L. 465-1 du même code. Le raisonnement suivi par les juges à cette occasion laisse incertaine la question de sa transposition en matière fiscale.
Le Conseil constitutionnel déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 que les mêmes faits commis par une même personne peuvent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Le Conseil pose ainsi deux conditions à la conformité d’un cumul de sanctions à l’article 8 de la DDHC : il doit être issu de deux corps de règles distincts et relever de deux ordres différents de juridiction ( 001).
EXTRAITS
001 Cons. const., 18 mars 2015, no 2015-462 QPC, no 2014-453/454 QPC
« Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : “La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée” ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ; que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues »
En l’espèce, le cumul des sanctions prononcées sur le fondement des articles précités du code des marchés financiers ne remplissait pas ces conditions. Pour conclure que les sanctions en l’espèce n’étaient pas issues d’un corps de règles distincts, le Conseil a retenu en premier lieu que les dispositions contestées tendaient à réprimer les mêmes faits, qu’elles définissaient et qualifiaient de la même manière. En second lieu, il a retenu l’identité des intérêts sociaux protégés, ceux des investisseurs et a souligné l’identité de nature entre les sanctions pénales et les sanctions administratives, lorsque la sévérité de ces dernières permet de leur reconnaître une nature répressive (en l’espèce, les montants des sanctions pécuniaires administratives dépassaient largement les montants des sanctions pénales). Enfin, dans la mesure où les recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers relevaient de la compétence du juge judiciaire, tout comme les sanctions pénales, le cumul des sanctions ne relevait pas davantage de deux ordres distincts de juridiction.
La transposition de ces critères au cumul des sanctions administratives et pénales en matière fiscale soulève de délicates questions. L’unique certitude porte sur le fait que les deux catégories de sanctions visent à protéger les mêmes intérêts sociaux, ceux du Trésor public et ceux des autres contribuables, notamment au regard du respect du principe d’égalité. L’application des autres critères – dont on ne sait s’ils sont cumulatifs ou s’il ne s’agit que d’un faisceau d’indices qui peut être variable selon les affaires – soulève davantage de difficultés. Prenons l’exemple de l’abus de droit et de la fraude fiscale, hypothèse dans laquelle le cumul des sanctions administratives (une majoration dont le taux est au minimum de 40 %, mais qui, pour les instigateurs et les bénéficiaires principaux, est de 80 %) et pénales (amende de 500 000 euros et cinq ans d’emprisonnement) est particulièrement lourd de conséquences pour le contribuable. Outre le fait que, contrairement à l’opération et au délit d’initié, l’abus de droit et la fraude fiscale ne sont pas codifiés au sein d’un même code (l’abus de droit est prévu à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales alors que la fraude fiscale est prévue à
l’article 1741 du Code général des impôts), l’identité de qualification est également moins frappante entre ces deux dispositifs, bien qu’il soit certain que les mêmes faits peuvent parfois être qualifiés d’abus de droit et de fraude fiscale. En effet, l’abus de droit vise à écarter les actes fictifs ou ceux qui recherchent l’application littérale des textes fiscaux à l’encontre de leurs esprits et ce, dans le but exclusivement fiscal, alors que la fraude fiscale vise à réprimer toute soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt. Cependant, lorsque l’administration fiscale publie une « carte des pratiques et montages abusifs » (v.
infra) dans la rubrique portant sur la lutte contre la fraude fiscale, elle se garde bien d’affirmer la qualification juridique qui serait donnée à ces montages. Elle parle sobrement des «
montages destinés à réduire indûment l’impôt » et des «
opérations contraires à la loi ». La plupart de ces opérations remplissent tant les critères de la fraude fiscale que ceux de l’abus de droit. L’administration fiscale ne fournit-elle pas ainsi elle-même une illustration des similitudes entre les deux qualifications ? Reste enfin la question des ordres de juridiction. Le texte relatif à l’abus de droit peut être appliqué tant par le juge administratif lorsqu’il est soulevé à l’occasion du contentieux sur les impôts relevant de sa compétence (tels les impôts directs frappant les revenus des personnes physiques ou morales) que par le juge judiciaire lorsqu’il est soulevé à l’occasion du contentieux concernant les impôts relevant de sa compétence (tels les droits d’enregistrement). La fraude fiscale relevant toujours de la compétence du juge judiciaire, les deux catégories de sanctions tantôt relèveront du même ordre de juridictions, tantôt non.
La Cour de cassation a appliqué la décision du Conseil constitutionnel dans un arrêt du 20 mai 2015
(10), en annulant l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné sur le fondement de
l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier une personne ayant déjà été condamnée de manière définitive sur le fondement de
l’article L. 621-15 du même code. Cet arrêt se réfère explicitement et uniquement à la décision du Conseil constitutionnel fondée, rappelons-le, uniquement sur la DDHC. Il ne permet donc pas d’anticiper la solution qui serait retenue par la même juridiction quant à la conformité du cumul des sanctions administratives et pénales au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu de l’invalidité certaine de la réserve française à la lumière de la jurisprudence susmentionnée de la Cour européenne.
P.K.C.
B –
LA CARTE DES PRATIQUES ET MONTAGES ABUSIFS
Après une intense communication médiatique, l’administration fiscale a publié en avril une liste des dix-sept pratiques et montages abusifs, qui a depuis été enrichie de deux nouveaux montages.
L’objet de cette publication est d’envoyer aux contribuables et leurs conseils un message clair : les montages visés seront systématiquement remis en question par le fisc et les personnes les ayant mis en œuvre sont invités à régulariser leur situation afin d’éviter des poursuites, que nous imaginons pénales.
Sur les dix-neuf montages que contient cette liste, neuf concernent effectivement l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), donc la fiscalité du patrimoine au sens large.
Les pratiques dénoncées nous inspirent les réflexions suivantes.
En premier lieu, à deux exceptions près
(11), les montages identifiés comme abusifs frisent la caricature : certains imaginaient qu’en vidant leur compte bancaire chaque fin d’année puis en remettant l’argent sur le compte après le 1
er janvier de l’année suivante, ils allaient réellement réduire à due concurrence leur base taxable à l’ISF !
Autre exemple un peu moins caricatural mais tout autant frauduleux : la souscription d’un contrat d’assurance-vie pour rapatrier des avoirs étrangers non déclarés.
Le montage consiste pour un contribuable qui détient des actifs non déclarés à l’étranger à souscrire un crédit « Lombard » auprès d’une banque en les donnant en garantie puis, avec les fonds empruntés, à souscrire un contrat d’assurance-vie pour bénéficier de la fiscalité avantageuse de ce type de placement. Bien évidemment, le crédit est remboursé grâce aux fonds étrangers non déclarés.
Il est clair que ce type de schéma s’est pratiqué par le passé. En revanche, l’évolution de la législation anti-blanchiment fait qu’aujourd’hui il ne constitue certainement pas une option pour les contribuables concernés. En effet, aucun assureur sérieux ne peut accepter de recevoir une souscription de ce type, car un contrat d’assurance-vie, pour être valable, doit être alimenté par le produit d’une épargne. Donc, sauf à expliquer le schéma à l’assureur, celui-ci ne pourra pas accepter que le contrat soit alimenté grâce à des fonds empruntés.
Et un assureur à qui la vérité serait exposée se rendrait immédiatement complice du délit de blanchiment de fraude fiscale, délit qui se diffuse dans les juridictions respectables puisque son existence est imposée par les organismes internationaux chargés de la lutte contre le blanchiment. La Suisse, par exemple, l’a introduit dans son droit positif depuis le 1er janvier 2016.
À notre connaissance, les assureurs luxembourgeois, qui sont implicitement visés par la fiche technique même s’ils ne sont pas désignés explicitement, ne se livrent plus et depuis longtemps à ce type de pratique.
En second lieu, si l’invitation de l’administration fiscale à régulariser ce type de schéma est à considérer sérieusement, rien n’est indiqué quant aux conditions qu’obtiendront les contribuables concernés : seront-ils assurés de ne pas être poursuivis pour fraude fiscale ? Quelle réduction du taux des pénalités leur repentance leur permettra-t-elle d’obtenir ?
Or, l’opération de régularisation des comptes étrangers non déclarés a permis de démontrer à l’administration fiscale qu’on n’attire pas les mouches avec du vinaigre et qu’à côté du bâton pour les fraudeurs découverts, il faut une carotte pour récompenser les bonnes volontés.
Si l’administration fiscale veut encourager les contribuables repentants, elle doit leur dire au préalable à quelle sauce ils seront mangés.
M. B.
III –
DES PRÉCISIONS EN MATIÈRE DE CALCUL DES PLUS-VALUES
A –
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE L’INSTRUCTION SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES
Plusieurs recours pour excès de pouvoir ont été déposés contre l’instruction ayant commenté le nouveau régime des plus-values de cession de valeurs mobilières résultant de la « barèmisation » des plus-values voulue par le président de la République et modifiée suite à la révolte des « Pigeons ».
À l’heure où cette chronique est rédigée, le Conseil constitutionnel n’a pas encore tranché la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que lui a posée le Conseil d’État le 14 octobre 2015
(12) portant sur le point de savoir si le refus d’application d’un quelconque abattement pour durée de détention aux compléments de prix se rapportant à des cessions réalisées avant le 1
er janvier 2013 était conforme aux principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques.
En revanche, par une décision no 390265 rendue le 12 novembre 2012, qui sera mentionnée au Recueil Lebon, le Conseil d’État a annulé l’application de l’abattement aux moins-values, renvoyant les concepts de « gain net négatif » et de « parallélisme des formes avec les plus-values » dans les oubliettes de la fiscalité.
De manière plus surprenante, il a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu’avait posée le contribuable sur ce texte, au motif que…« la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité ».
Partant, il a considéré que cette différence de traitement constituait une dérogation acceptable au principe de l’égalité puisqu’elle était conforme à l’intérêt général dès lors qu’elle était… « en rapport direct avec l’objet de la loi qui, en réservant l’application de l’abattement pour durée de détention aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, vise à encourager la détention longue de valeurs mobilières ».
Il est clair qu’avec cette décision, les contribuables qui ont le malheur de détenir des titres porteurs d’une plus-value en report vont être vivement incités à les conserver jusqu’à leur mort, puisque avec les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ils seront redevables en cas de cession d’une taxation pouvant atteindre 64,5 %.
On sent bien qu’il y a un sophisme dans ce raisonnement et nous déplorons vivement que cette question n’ait pas, contrairement à celle relative aux compléments de prix des cessions antérieures à 2013, été transmise au Conseil constitutionnel pour clarification. Ceci d’autant plus que le Conseil constitutionnel n’a validé la « barèmisation » des plus-values qu’en raison de l’existence d’abattements pour durée de détention.
Ce vice de raisonnement est, nous semble-t-il, à rechercher dans la conception qu’a le Conseil d’État des plus-values en report, qu’il considère comme définitivement cristallisées lors de l’échange, alors même que le régime fiscal qui leur est applicable est celui en vigueur au jour de la cession des titres reçus en échange
(13).
Or, comment concilier la prévisibilité de la loi fiscale avec une telle incertitude ? Rappelons que, lorsque les contribuables ont opté pour reporter l’imposition de leur plus-value d’échange, le taux auquel ils échappaient provisoirement s’établissait alors à 26 % et ils n’imaginaient certainement pas que quinze ans plus tard, il aurait plus que doublé !
Pour les contribuables ayant des plus-values en report antérieures à 2000, tout espoir n’est cependant pas perdu : en effet, en fonction de ce que dira le Conseil constitutionnel sur la QPC relative aux compléments de prix dont il est saisi, il sera peut-être possible d’invoquer un changement de circonstances pour tenter une nouvelle saisine.
Pour les contribuables ayant réalisé des plus-values en report en 2012 sur le fondement de l’article 150-0 B ter, qui n’étaient pas directement concernés par le recours, la question se présente sous un angle légèrement différent. En effet, contrairement aux régimes de report de plus-values d’échange antérieurs à 2000, qui étaient optionnels, le report de leur plus-value était automatique. Ces contribuables n’ont donc pas pu opter pour l’imposition forfaitaire de 24 % (ou 19 % pour les entrepreneurs) au lieu et place des 45 % qui s’appliqueraient à l’avenir.
Cette absence d’option, dont on sait qu’elle fut inspirée par un désir de mise en conformité avec la directive « Fusions », pourrait alors s’avérer problématique au regard des principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques.
Il est donc probable que de nouveaux développements sur ces points sont à attendre à court terme, dont nous rendrons compte l’an prochain dans cette chronique.
M. B.
B –
TAUX DE LA PLUS-VALUE D’ACQUISITION DE STOCK-OPTIONS EN CAS DE DONATION AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT : LE CONSEIL D’ÉTAT DONNE RAISON À L’ADMINISTRATION FISCALE
À quel taux devait être taxée la plus-value d’acquisition lorsque le salarié qui bénéficie des options de souscription ou d’acquisition d’actions fait donation des actions issues de la levée de ses options tout en s’en réservant l’usufruit ?
On sait que depuis le 20 septembre 1995, la plus-value d’acquisition des stock-options est taxable à un taux majoré qui dépend du montant de la plus-value réalisée et de la durée de conservation des titres souscrits ou acquis lors de l’exercice des options.
Dans l’hypothèse où l’acte de donation a prévu qu’en cas de cession des titres démembrés, le prix de vente devait être remployé dans l’acquisition ou la souscription de titres eux-mêmes démembrés, la plus-value sur l’usufruit n’est pas imposable entre les mains de l’usufruitier, mais dans celles du nu-propriétaire, conformément à la doctrine administrative
(14).
Partant du constat que le nu-propriétaire n’était pas salarié de l’employeur du donateur, d’une part, et que le taux majoré procédant d’une exception, son champ d’application devait être interprété strictement, d’autre part, le contribuable soutenait que le donataire nu-propriétaire ne pouvait être taxé qu’au taux de droit commun sur la plus-value d’acquisition devenant imposable entre ses mains lors de la cession des actions données.
Par une décision rendue le 17 avril 2015
(15), le Conseil d’État lui a cependant donné tort, en considérant que le changement de redevable de l’impôt n’avait pas d’incidence sur le taux de ce dernier.
Il convient de noter que pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, la question tranchée ne se posait plus puisque les mutations à titre gratuit ne « purgent » plus les plus-values d’acquisition.
M. B.
IV –
DES PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES
A –
LA SUBSIDIARITÉ DES CONVENTIONS FISCALES AU REGARD DES QUESTIONS DE QUALIFICATION
La question s’est présentée dans une affaire portant sur l’imposition d’une succession d’un défunt, résident fiscal monégasque, comprenant les parts d’une société de droit monégasque, propriétaire d’immeubles situés en France. En droit interne
, l’article 750 ter du Code général des impôts (CGI) soumet aux droits de succession français les biens immeubles situés en France détenus directement ou indirectement (lorsque le contribuable et son cercle familial détiennent plus de la moitié des titres de la société propriétaire de l’immeuble situé en France), ainsi que les titres de sociétés à prépondérance immobilière (les sociétés non cotées dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France et non affectés à l’exploitation). En l’espèce, les deux fondements pouvaient être utilisés : l’immeuble ayant été détenu indirectement par le défunt et la société monégasque remplissant les critères de la prépondérance immobilière. La question était de savoir si la convention fiscale franco-monégasque du 1
er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions en matière successorale pouvait s’opposer à cette imposition. En effet, l’article 2 de cette convention permettait l’imposition des biens immeubles dans l’État de leur situation, alors que l’article 6 attribuait le droit d’imposer les titres de sociétés uniquement à l’État de la résidence du défunt, en l’espèce Monaco. Il fallait donc déterminer la nature des titres de la société monégasque pour savoir s’ils relevaient de l’article 2 ou de l’article 6 de la convention.
Lorsque cette affaire s’est présentée la première fois devant la Cour de cassation, le 9 octobre 2012, les juges ont cassé l’arrêt attaqué, lequel avait appliqué l’article 6 de la convention. Nombre de commentateurs y avaient vu la reconnaissance implicite de la nature immobilière des titres de la société monégasque. M. le premier avocat général Le Mesle soutient pourtant qu’il ne s’agissait que de sanctionner une mauvaise méthode de raisonnement et non de se prononcer sur la nature des biens concernés. La suite a confirmé cette interprétation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur renvoi en considérant que les titres relevaient bien de l’article 6 de la convention, ce qui fut confirmé par la Cour de cassation le 2 octobre dernier
(16).
Si la nature mobilière des titres de sociétés monégasques détenant des immeubles en France était déjà acquise tant au regard de l’ancienne jurisprudence que de la doctrine administrative, l’intérêt principal de cet arrêt (outre d’avoir dissipé quelques craintes apparues à la suite de l’arrêt du 9 octobre 2012) réside dans la comparaison des méthodologies suivies par le Conseil d’État et la Cour de cassation dans l’application des conventions fiscales.
Le Conseil d’État commence en principe toujours par vérifier la validité d’une imposition au regard du droit interne (du moins lorsque les parties soulèvent cet argument, car autrement le Conseil d’État vérifie les références à la loi fiscale nationale, sans forcément vérifier que les conditions d’imposition posées par cette loi sont réunies)
(17), en retenant à cette étape la qualification du revenu en droit interne. Cette première étape du raisonnement correspond à l’application du principe de subsidiarité des conventions fiscales, selon lequel seules les lois nationales peuvent servir de fondement à une imposition
(18). Il regarde ensuite la convention fiscale, en appliquant l’article correspondant à la qualification du revenu en droit interne, à moins que ce texte ne donne une définition particulière des revenus concernés divergente par rapport à la définition du droit interne. Dans ce cas, la définition conventionnelle prime sur celle du droit interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution, imposant au juge l’application d’un autre article de la convention. Cette seconde étape correspond à l’application du principe classique de la supériorité des conventions internationales.
D’aucuns
(19) ont soutenu à cette occasion que la Cour de cassation n’applique pas le principe de subsidiarité, dans la mesure où elle ne se réfère pas à la loi nationale mais affirme, au contraire, «
qu’en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d’abord, aux conventions internationales ». Cette conclusion doit cependant être nuancée. En effet, selon les termes mêmes du rapport de Mme Dagneaux, conseiller à la Cour de cassation, le principe de subsidiarité vise à délimiter les champs d’application respectifs de la loi interne et de la convention et non de résoudre la question de la hiérarchie des normes. Ainsi, la référence de la Cour de cassation à la hiérarchie des normes semble indiquer que l’arrêt ne se prononce pas sur la subsidiarité des conventions. Au contraire, dans son avis, M. le premier avocat général Le Mesle préconise de commencer «
par la question qui est nécessairement préalable, c’est-à-dire celle de savoir si une succession portant sur des parts dans une société civile immobilière étrangère, en l’occurrence monégasque, est taxable en France au regard du seul droit interne, et à quelles conditions. Si elle ne l’était pas, ou si les conditions requises n’étaient pas réunies, le débat serait clos avant même d’avoir été ouvert ».
D’ailleurs, les questions de qualification – comme celle qui a été soulevée devant la Cour de cassation – dépendent uniquement de l’application du principe de supériorité des conventions fiscales et non de celui de subsidiarité. En effet, que l’on commence par retenir la définition donnée par le droit interne avant de la confronter à la définition conventionnelle ou que l’on commence par la définition conventionnelle pour suivre le renvoi au droit interne, le résultat est identique. Le Conseil d’État serait arrivé à la même conclusion. Il aurait constaté qu’en droit interne aucun texte – ni en droit civil ni en droit fiscal – ne permet de qualifier de biens immobiliers les titres de sociétés opaques détenant des immeubles.
L’article 750 ter du CGI soumet aux droits de succession français les titres des sociétés étrangères, sans pour autant les qualifier de biens immobiliers. Dès lors, c’est l’article 6 de la convention qui aurait été appliqué. La Cour de cassation, en revanche, commence par appliquer la convention fiscale. Elle constate que les biens en question n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2 de celle-ci. Ce texte, relatif aux biens immobiliers, se réfère, pour la définition de ces biens, à «
la législation de l’État dans lequel est situé le bien considéré ». Il aurait pu être difficile de savoir la législation de quel État devait être appliquée (quel est «
le bien considéré » ? Les titres ou l’immeuble ? Donc législation monégasque ou française). Mais il se trouve en l’espèce, comme cela a été examiné dans le rapport de Mme Dagneaux, qu’aucune de ces législations ne permet de qualifier les titres de biens immobiliers. Dès lors, seul l’article 6 de la convention pouvait être appliqué.
L’application d’autres conventions peut donc aboutir à des résultats très différents. Ainsi, un certain nombre de conventions plus récentes conclues par la France et portant sur les droits de successions qualifient expressément de biens immeubles les titres de sociétés à prépondérance immobilière. Il en est notamment ainsi des conventions fiscales en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions signées par la France avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie ou la Suède.
P. K. C.
B –
DES PRÉCISIONS QUANT À LA NOTION CONVENTIONNELLE DE RÉSIDENT FISCAL
Deux décisions rendues par le Conseil d’État le 9 novembre 2015 apportent des précisions sur la notion de résident, critère essentiel du champ d’application personnel des conventions fiscales
(20). Dans ces affaires, des fonds de retraite étrangers – allemand dans l’une des affaires, espagnole dans l’autre – percevaient des dividendes de sociétés françaises, soumis à une retenue à la source au taux de 25 % en vertu des
articles 119 bis et 187 du Code général des impôts. Or les conventions fiscales – franco-allemande et franco-espagnole, respectivement – permettaient de réduire le taux de la retenue à la source à 15 %. Il restait cependant à savoir si les fonds en question, bien qu’ayant leurs sièges respectivement en Allemagne et en Espagne, pouvaient être considérés comme des résidents de ces pays, alors même qu’ils y sont exonérés d’impôt sur les sociétés.
Le Conseil d’État répond par la négative, en se fondant avant tout sur l’objet principal des conventions fiscales qui est d’éviter les doubles impositions. Les personnes exonérées d’impôt dans l’État de leur résidence ne risquent pas – de ce fait – la double imposition. Il n’y a donc pas de raison, selon la logique du Conseil d’État, de leur appliquer les conventions fiscales. Cet argument appelle pourtant deux remarques. Il est, d’une part, constant que des dispositions conventionnelles accordent expressément aux contribuables des avantages dépassant la simple élimination des doubles impositions. Le Conseil d’État a ainsi jugé le 25 février 2015, à propos de l’article 22 de l’
accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, qu’en cas de silence de la convention, cette dernière devait être interprétée comme ne soumettant pas l’attribution du crédit d’impôt forfaitaire aux résidents fiscaux français percevant des revenus de source chinoise à la condition que ces revenus aient été effectivement soumis à l’impôt en Chine
(21). Pourtant, faute d’imposition effective en Chine, ces revenus ne risquent pas de subir une double imposition. Ce raisonnement pourrait être d’autant plus fragile que de nombreuses conventions sont aujourd’hui conclues non seulement en vue d’éviter les doubles impositions, mais aussi pour prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ce qui d’ailleurs est le cas de la convention fiscale franco-espagnole, applicable dans l’une des affaires), ce qui pourrait entraîner l’élargissement de leur champ d’application.
À titre secondaire, le Conseil d’État évoque d’autres dispositions des conventions concernées qui permettent d’accéder à certains avantages conventionnels aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), alors même que ces organismes ne sont pas assujettis à l’impôt dans leur État de résidence. En effet, les OPCVM, tout comme les fonds de retraite, sont exonérés d’impôt. Ces dispositions, invoquées à titre subsidiaire, constituent pourtant un meilleur fondement de l’interprétation retenue du terme « assujetti », comme exigeant une soumission effective à l’impôt.
En revanche, il faut rappeler qu’une imposition retardée ne prive pas une personne de sa qualité de résident fiscal, conformément à ce qu’a jugé le Conseil d’État le 27 juillet 2012, à propos d’une personne résident fiscal du Royaume-Uni, mais bénéficiant du régime de «
remittance basis » qui reporte l’imposition des revenus de source étrangère à la date de leur rapatriement au Royaume-Uni
(22). Enfin, il semblerait que le défaut d’imposition effective d’un contribuable dû à la situation déficitaire de ce dernier ne le prive pas de son statut de résident au sens des conventions fiscales
(23).
Il est également à noter que ces décisions reprennent, sans référence expresse, les mots exacts de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
(24), selon lequel un traité doit être interprété de bonne foi «
en suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Bien que la France ne soit pas partie à cette convention, le Conseil d’État suit ses recommandations de longue date, dans la mesure où la convention ne fait que codifier le droit international coutumier
(25). Pourtant, auparavant, il ne reprenait pas le texte en tant que tel. Or, en 2015, plusieurs décisions du Conseil d’État en reprennent les termes exacts. Il en était notamment ainsi dans une
décision du 6 mai 2015, à propos du champ d’application matériel (les impôts visés) de la convention fiscale conclue entre la France et Monaco
(26). Il est intéressant de relever que malgré cette référence à la Convention de Vienne, les juges dans les
décisions du 9 novembre 2015 ne retiennent finalement pas le sens ordinaire du terme « assujetti », qui renvoie davantage au fait de relever d’une législation
(27) qu’à l’imposition effective à un impôt
(28).
P. K. C.
V –
LES CONTRAINTES EUROPÉENNES SUR LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAISE
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé dans un arrêt du 26 février 2015
(29) que les prélèvements sociaux français relevaient du
règlement no 1408/71/CEE du Conseil du 14 juin 1971 (JOCE 5 juill., no L 149) relatif a l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent a l’intérieur de la Communauté, y compris lorsqu’ils étaient prélevés sur les revenus du patrimoine. Les juges ont suivi le même raisonnement qu’en 2000
(30), en déclarant que les prélèvements sociaux présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale dès lors qu’ils étaient affectés au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Le fait que, contrairement aux affaires antérieures, les prélèvements en cause portaient sur les revenus du patrimoine et non sur les revenus d’activité n’a pas été jugé de nature à éviter l’application du règlement. Les juges ont en effet souligné que la solution inverse aboutirait à des disparités dans l’application du règlement selon l’origine des revenus. D’autres arguments classiques du gouvernement français ont été rejetés, tout comme dans les affaires antérieures. Il en était ainsi de l’absence de contrepartie, ainsi que de l’affectation d’une fraction des produits de ces prélèvements au remboursement de la dette de la sécurité sociale.
De même, la qualification de ces prélèvements en droit interne est sans importance. Il faut d’ailleurs souligner que les juges européens ne cherchent pas à qualifier ces prélèvements de cotisations sociales, mais simplement à garantir l’efficacité du règlement européen dont l’objectif est de prévenir les inégalités de traitement constitutives d’entraves à l’exercice de la liberté de circulation des personnes. Il ne saurait en être autrement étant donné que les différents États membres choisissent des modes différents de financement de leur sécurité sociale, certains (Royaume-Uni, Finlande, Danemark) ayant en grande partie recours à l’impôt
(31). Cet arrêt ne remet donc pas en cause – pas plus que les arrêts précédents de la CJUE – la qualification nationale de ces prélèvements en tant qu’impositions de toute nature.
C’est à cette lumière qu’il faut envisager une
décision du Conseil d’État du 17 avril 2015(32), où les juges ne reviennent pas sur la qualification juridique des prélèvements sociaux français (remettant ainsi en cause leur caractère non déductible en tant qu’impositions, par opposition au caractère déductible des cotisations sociales), mais affirment l’indifférence de cette qualification quant à l’application du règlement européen (
002).
EXTRAITS
« considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à juger, pour écarter le moyen de M. A… tiré de ce qu’il n’avait pas à acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale en l’absence d’affiliation à un régime obligatoire français de sécurité sociale, que ces cotisations, dépourvues de tout lien avec l’ouverture d’un droit une prestation ou à un avantage servi par un régime de sécurité sociale, ont le caractère d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit »
Les contribuables non affiliés à la sécurité sociale française sont dès lors invités à réclamer le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine payés dans le délai de deux ans, conformément à l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales.
En revanche, le choix de la solution pour mettre la législation française en conformité avec le droit européen a soulevé de nombreux débats. Le gouvernement a proposé de modifier l’affectation du produit des prélèvements sociaux en les attribuant désormais au fonds de solidarité vieillesse, servant uniquement des prestations non contributives
(33). Validé par les députés, le texte avait été modifié par les sénateurs qui y avaient ajouté la suppression de l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. La commission mixte paritaire n’a pas pu parvenir à un accord et l’Assemblée nationale est revenue au texte initial du gouvernement, malgré des réserves exprimées par certains députés. Il est en effet peu probable que cette modification soit jugée satisfaisante par les institutions européennes. L’article 4 du règlement en question ne distingue pas entre les prestations contributives et celles qui ne le sont pas. Il comprend notamment des prestations familiales, celles de maternité et aussi les prestations de vieillesse. Le changement d’affectation ne semble donc pas suffire pour exclure les prélèvements en cause du champ d’application du règlement.
P. K. C.
Notes
(1)
CE, 11 mai 2015, no 65564, Dr. fisc. 31-35/15, comm. 521, concl. E. Bokdam-Tognetti.
Retour au texte
(2)
CE, 18 févr. 2004, no 247729, SA Pléiade, Dr. fisc. 2004, no 47, comm. 849.
Retour au texte
(4)
V. par exemple CADF, avis nos 2006-16, 2007-11 et 2009-15.
Retour au texte
(8)
CEDH, 4 mars 2014, aff. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens et a. c/ Italie.
Retour au texte
(9)
Cons. const., 18 mars 2015, no 2015-462 QPC, no 2014-453/454 QPC.
Retour au texte
(11)
La délicate question des « management packages », où une grande confusion règne actuellement avec des divergences d’appréciation entre l’administration fiscale et le Comité de l’abus de droit fiscal, et les cessions croisées de titres pour les inscrire sur un plan d’épargne en actions (PEA), puisque la jurisprudence (CE, 8e et 3e ss-sect., 14 octobre 2015, no 374211) venant de juger que l’apport de titres sur un PEA était possible, de sorte que la règle que le contribuable a cherché à contourner n’existait pas, aucun abus ne nous semble répréhensible.
Retour au texte
(13)
CE, 10 avr. 2002, no 226886, de Chaisemartin ; CE, 3 déc. 2014, no 364506, de Ganay.
Retour au texte
(17)
V. notamment sur ce point la note de l’auteur sous CE, 20 mai 2015, no 369373, Dr. fisc. 2015, no 47, comm. 687.
Retour au texte
(18)
Principe issu de la célèbre décision CE, 28 juin 2002, no 232276, Schneider Electric, constamment réaffirmé depuis. Pour une illustration récente, v. CE, 20 mai 2015, no 369373, Universal Aviation France (UAF).
Retour au texte
(19)
V. la note explicative de l’arrêt publiée sur le site de la Cour de cassation, ainsi que le rapport de Mme Martine Dagneaux, spéc. p. 23.
Retour au texte
(20)
CE, 9 nov. 2015, no 370054, LandesärztekammerHessenVersorgungswerk (LHV), et no 371132, Société Santander Pensiones SA EGFP.
Retour au texte
(22)
CE, 27 juill. 2012, no 337656, Ministre c/ M. Regazzacci.
Retour au texte
(24)
Il s’agit de la Convention sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, adoptée par une conférence de l’ONU réunie à Vienne en 1986.
Retour au texte
(25)
J. Dehaussy et M. Salem, J.-Cl., Vo Sources du droit international. – Les traités. – Interprétation. – Principes, règles et méthodes applicables à l’interprétation, no 10.
Retour au texte
(27)
L. Agron, Histoire du vocabulaire fiscal, LGDJ, 2000, p. 367.
Retour au texte
(30)
CJCE, plén., 15 févr. 2000, aff. C-169/98, Commission c.. France, et aff. C-34/98, Commission c/ France.
Retour au texte
(31)
Haut Conseil du financement de la protection sociale, État des lieux du financement de la protection sociale en France, t. I, Note, 31 oct. 2012, p. 29.
Retour au texte
(33)
L. fin. séc. soc., no 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 24.
Retour au texte