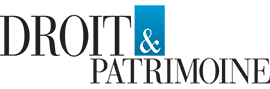Chronique de jurisprudence de droit des sociétés : focus sur le dirigeant
Paru dans Droit&Patrimoine n°294 - septembre 2019
Par Didier Poracchia, professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I)
Chronique de jurisprudence de droit des sociétés : focus sur le dirigeant.
I – Pouvoirs des dirigeants
A – Objet social des sociétés à risque limité
Dans les sociétés à risque limité, les pouvoirs des dirigeants ne sont en principe limités que par les pouvoirs conférés par la loi aux autres organes. Ni l’objet social, ni l’intérêt social ne sont en eux-mêmes des éléments dont la violation permet automatiquement de remettre en cause l’acte conclu par les représentants légaux. Comme le rappel une décision du 19 septembre 2018 (1), « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée » (2). Cette solution pourrait cependant être réexaminée par les juges à l’aune du nouvel alinéa 2 de l’article 1833 du code civil issu de la loi Pacte du 22 mai 2019 qui dispose désormais que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (3). Si la société, qu’elle soit à risque limité ou illimité, est gérée dans son intérêt et ne doit donc agir que pour le poursuivre, a-t-elle alors la capacité de conclure des actes qui seraient contraires à son intérêt ? On peut en douter (4). Le seul dépassement de l’objet social ne peut pas plus conduire à la nullité de l’acte conclu par le représentant légal avec le tiers de bonne foi. Une telle nullité ou aujourd’hui une telle inopposabilité (5) n’est concevable que si l’acte dépasse les limites de l’objet social et que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances. Et la preuve de cette connaissance est difficile à rapporter comme le montre l’arrêt précité. En l’espèce, une SAS s’était portée caution, envers la Direction générale des impôts, des dettes fiscales d’une autre société ayant le même dirigeant qu’elle. Cette dernière n’ayant pas réglé intégralement sa dette, l’administration fiscale avait émis un avis de mise en recouvrement puis avait demandé paiement à la société caution, qui avait contesté son engagement. Déboutée par les juges du fond, la société caution forma un pourvoi en cassation. Celle-ci reprochait notamment au juge d’appel de ne pas avoir annulé le cautionnement conclu selon elle en dehors de son objet social et alors que l’administration devait être considérée comme connaissant ou ne pouvant ignorer la substance de cet objet. La raison pour laquelle l’administration était censée connaître la substance de l’objet social et son dépassement résidait dans le fait qu’elle avait demandé à la société que soit remis lors de la signature de l’acte le procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS autorisant son président à se porter caution au profit de l’autre société également dirigée par lui. En d’autres termes, pour la société caution, la raison pour laquelle l’administration exigeait que le président remette le procès-verbal de la décision de la collectivité des associés autorisant le président à conclure le cautionnement tenait dans le fait qu’elle savait nécessairement que cet acte dépassait l’objet social et qu’il devait donc être expressément autorisé par les associés (6). La Cour de cassation ne suit pas cette analyse et rejette le pourvoi. Pour la Haute juridiction, aux termes de l’article « L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, la société par actions simplifiée est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’il ne soit démontré que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances ; que cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que l’administration fiscale aurait exigé que soit remis, lors de la signature de l’acte de cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée générale de la société LSI autorisant son président à se rendre caution de la société Multiples, la cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur des conclusions inopérantes ». Il faut certainement approuver la solution. Si l’exigence formulée par l’administration fiscale pouvait être un élément de nature à établir qu’elle connaissait le dépassement de l’objet social, cela ne suffisait pas à le démontrer car cette demande pouvait être justifiée par d’autres raisons légitimes. Ainsi, l’administration pouvait souhaiter s’assurer que les éventuelles clauses limitatives de pouvoirs avaient été respectées. Plus largement, et comme c’est très souvent le cas en pratique, elle souhaitait, par précaution, s’assurer que la collectivité des associés était d’accord pour que le représentant légal de la SAS confère une telle caution pour éviter tout doute sur la régularité de l’acte (7). Un tel comportement diligent ne pouvait donc, à lui seul stigmatiser sa connaissance de l’objet social. Il peut cependant arriver que les circonstances de fait permettent d’établir que le créancier connaissait l’objet social de son débiteur et ne pouvait ignorer que l’acte conclu par ce dernier à son profit le dépassait, comme en témoigne un arrêt du 14 février 2018 (8). Dans cette affaire, une société Iso Sud se rend caution d’obligations contractées par la société mère, la société Iso Plas envers son fournisseur la société Deceuninck. Appelée en garantie, la société Iso Sud, placée en liquidation judiciaire, demande au juge du fond par le prisme des organes de la procédure d’annuler le cautionnement au motif qu’il a été conclu en dehors de l’objet social, objet que connaissait la société Deceuninck. Les juges font droit à sa demande. Il considère d’une part que le cautionnement était bien conclu en dehors de l’objet social, peu important l’utilité du cautionnement ayant permis de maintenir les approvisionnements de la société Iso Plas et donc l’activité de commercialisation de la société Iso Sud. L’existence d’une communauté d’intérêt ne pouvait pas étendre le programme d’activité de la société Iso Sud. Ensuite, pour les juges, la société Deceuninck avait connaissance ou ne pouvait ignorer l’objet de la société Iso sud « compte tenu de sa connaissance du groupe, de l’ancienneté de ses relations commerciales tant avec la société Huis Clos qu’avec la société Iso Plas, et de ce qu’elle était actionnaire de la société Huis Clos, actionnaire unique de la société Iso Plas, elle-même associée unique de la société Iso Sud ». En d’autres termes, tout à la fois les liens commerciaux et capitalistiques entretenus entre le bénéficiaire du cautionnement et les sociétés du groupe le conduisait à connaître non seulement l’activité de la société Iso Sud, mais également, plus formellement son objet social. Enfin, les juges du fond avaient considéré que le cautionnement conduisait, en cas de mise en œuvre, à faire perdre à Iso Sud tout moyen de poursuivre son activité et compromettait sa pérennité. Aussi, pour ces derniers, le cautionnement était contraire à l’intérêt social de la société Iso Sud et ne pouvait donc être rattaché indirectement à l’objet même s’il existait une communauté d’intérêts. Le raisonnement tenu par les juges du fond est consacré par la Cour de cassation. Celle-ci estime tout d’abord que les juges ont caractérisé la connaissance par le tiers du dépassement de l’objet social. On notera ici pourtant que les éléments retenus en l’espèce, s’ils permettaient certainement au créancier de connaître l’activité sociale de la société Iso Sud, n’induisaient pas nécessairement sa connaissance des statuts de cette dernière et de son objet social. On voit donc, qu’en fonction des situations de fait (9), le risque que l’on retienne la connaissance par le créancier de l’objet social du débiteur critiquant son engagement n’est pas à négliger. La Cour admet ensuite qu’en raison de la contrariété à l’intérêt de la société Iso Sud, le cautionnement ne pouvait entrer indirectement dans son objet social même si la caution et le débiteur cautionné avaient un intérêt commun au maintien des approvisionnements par le bénéficiaire du cautionnement. Cette analyse n’est en réalité pas nouvelle. Dès lors que l’acte en cause n’entre pas dans l’objet social prévu par les statuts, la possibilité de l’y rattacher suppose, pour la jurisprudence, que cet acte ne soit pas contraire à l’intérêt de la société et donc ne la mette pas en péril (10), peu important, ce qui est critiquable, l’existence d’une véritable communauté d’intérêts. Au final, le cautionnement n’étant ni directement, ni indirectement compris dans l’objet social de la SAS caution et le créancier ayant eu connaissance de l’objet, celui-ci a pu être annulé.
B – Clause limitative des pouvoirs – opposabilité par les tiers à la société
Chacun sait que les clauses limitatives des pouvoirs des dirigeants et plus exactement des représentants légaux des sociétés sont inopposables aux tiers, peu important que le tiers ait connaissance de ces limitations (11). En revanche, la loi est muette sur la possibilité pour les tiers d’opposer à la société les limitations desdits pouvoirs (12). On sait qu’en matière procédurale, la jurisprudence accueille en principe favorablement l’opposabilité par les tiers des limitations des pouvoirs du représentant légal pour lui dénier précisément le pouvoir de représenter la société en justice (13). Cette solution est à nouveau reprise par un arrêt du 14 février 2018 (14). En l’espèce, la société Opalis qui avait confié à la société Kosmetto le conditionnement de ses produits avait assigné, par la voix de sa gérante, cette dernière société en réparation de certains préjudices. La société Kosmetto lui oppose la nullité de son assignation au motif que la gérante n’avait pas les pouvoirs pour introduire une telle action. En effet, selon une résolution de l’assemblée générale « extraordinaire » d’Opalis (15), la gérante ne pouvait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer (…) toute action en justice de la société en tant que demandeur ». Or, il n’était pas établi que la gérante avait été autorisée à agir par une décision collective ordinaire des associés. Aussi, les juges du fond avaient-ils annulé l’assignation formée selon eux par un représentant sans pouvoir. La Cour de cassation les en approuve en rappelant « qu’un tiers peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci ». Elle en conclut que la décision des associés prise dans les conditions nécessaires pour modifier les statuts, et les ayant d’ailleurs certainement modifiés (16), suffisait à limiter les pouvoirs du gérant (17). En conséquence, ce dernier n’ayant pas été habilité à agir, était dépourvu du pouvoir d’assigner la société Kosmetto et l’assignation devait être annulée. Au plan procédural, les limitations statutaires des pouvoirs du représentant légal peuvent donc être opposées par les tiers pour démontrer que celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter la société en justice (18). La même solution doit-elle être retenue au plan substantiel, lorsqu’il s’agit de dénier au représentant légal le pouvoir d’engager la société par un acte conventionnel ou unilatéral ? On sait qu’en droit commun toute personne, tiers à un contrat, peut se prévaloir de la situation créée par ce dernier (19), règle aujourd’hui exprimée par l’article 1 200 du code civil aux termes duquel, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir, notamment pour apporter la preuve d’un fait ». Par conséquent, si l’on admet que les statuts constituent le contrat de société, les tiers doivent pouvoir se prévaloir des clauses qui y figurent ; plus précisément, ils doivent pouvoir se prévaloir de la situation juridique qui résulte de ces clauses. Toute la question est alors de savoir ce qui en résulte (20). En d’autres termes, les clauses limitatives des pouvoirs du représentant légal ont-elles bien pour effet de limiter leur pouvoir ? Si la réponse est positive, rien ne devrait empêcher les tiers de se prévaloir de cette situation. Si la réponse est négative, les tiers pourront toujours se prévaloir de la clause mais celle-ci ne privant pas le représentant légal de son pouvoir, les griefs formulés par les tiers fondés sur ledit défaut ne pourront être accueillis. Et c’est là toute l’ambiguïté de la loi (21) qui d’une part détermine le pouvoir du représentant légal et vient préciser d’autre part que les limitations statutaires des pouvoirs sont inopposables aux tiers. En effet, si les pouvoirs de représentation définis par la loi relevaient totalement de l’ordre public sociétaire, il n’aurait pas été nécessaire, pour protéger les tiers, de préciser que les limitations statutaires des pouvoirs leur sont inopposables puisque de telles clauses n’auraient pas pu limiter lesdits pouvoirs. En venant au contraire prévoir que les limitations statutaires des pouvoirs sont inopposables aux tiers, la loi semble donc admettre que les statuts peuvent limiter les pouvoirs de représentation du dirigeant. L’ordre public sociétaire ne concerne pas la consistance du pouvoir de représentation mais l’attribution de ce pouvoir puisque les statuts ne peuvent pas, en principe, attribuer statutairement ce pouvoir à un organe qu’il détermine. Seule la loi attribue ou permet aux statuts d’attribuer (22) un tel pouvoir aux organes qu’elle nomme. En revanche, les statuts peuvent limiter les pouvoirs de représentation de l’organe recueillant, en application de la loi, lesdits pouvoirs. Et pour protéger les tiers, la loi prévoit que ces dispositions statutaires sont inopposables aux tiers. Par conséquent, la société ne peut se prévaloir de cette situation juridique à l’égard du tiers et considérer que son représentant légal n’avait pas les pouvoirs requis pour l’engager lorsqu’il n’a pas respecté une clause statutaire qui limite ses pouvoirs de représentation. En revanche, la loi ne prévoit pas de protéger la société contre ses propres clauses. Elle ne prévoit pas que les clauses limitatives des pouvoirs du représentant légal sont inopposables à la société. On en revient donc au droit commun. Ces clauses doivent pouvoir être opposées à la société par les tiers. Aussi, lorsqu’elles limitent réellement les pouvoirs du représentant légal et qu’elles n’ont pas été respectées, les tiers peuvent se prévaloir de cette situation juridique et considérer que le représentant de la société a agi sans pouvoir et ce tant au plan procédural, qu’au plan substantiel, comme le montre la décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 2018 (23). En l’espèce les juges du fond avaient fait droit à la demande d’annulation d’un congé destiné à mettre fin à un bail à long terme donné par le représentant légal d’un GFA alors qu’il n’y avait pas été autorisé par l’assemblée générale extraordinaire conformément aux statuts. Pour la Cour de cassation : « Attendu que le GFA et Mme X… font grief à l’arrêt d’annuler le congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire ; mais attendu, d’une part, que c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l’article 16 des statuts, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que la commune intention des parties était de conférer à l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à autoriser la conclusion de baux, le pouvoir d’en approuver parallèlement la rupture et en a déduit que le verbe “réaliser” devait être considéré comme signifiant résilier ; attendu, d’autre part, que les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci ; que la cour d’appel a constaté que M. Alexandre Z… n’était pas associé du GFA lors de la délivrance du congé, son père ne lui ayant fait donation de parts sociales qu’après cette date ; qu’il en résulte que M. Alexandre Z…, tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ». Pour les raisons évoquées plus haut, la décision doit être approuvée. Deux questions se posent cependant. D’une part, la société peut-elle limiter l’effet de ces clauses de limitation statutaire des pouvoirs dont les tiers peuvent se prévaloir ? La réponse est positive. Il faut et il suffit que les clauses statutaires ne limitent pas les pouvoirs de représentation légale. Cela ne signifie pas que les statuts ne pourront pas obliger le dirigeant à respecter une procédure particulière en vue de mettre en œuvre son pouvoir. Cela signifie seulement que s’il ne respecte pas cette procédure, il viole les statuts et peut engager sa responsabilité mais que cela n’a aucune influence sur l’existence et la possibilité d’exercer les pouvoirs que la loi lui attribue. Dès lors, les tiers pourront toujours se prévaloir des clauses « limitatives des pouvoirs » mais celles-ci ne les limitant pas, ils ne pourront considérer que le représentant légal agissait sans pouvoir. Pour obtenir un tel résultat, peut-être suffit-il de préciser dans la clause que les limitations des pouvoirs ne valent que dans l’ordre interne, ou encore à titre de règlement intérieur ou encore qu’elles ne peuvent être invoquées par les tiers (24), de telles indications pouvant être interprétées comme manifestant la volonté de ne pas limiter les pouvoirs du représentant légal, mais de procéduraliser, dans l’ordre interne, son exercice. À supposer ensuite qu’en raison du non-respect des dispositions statutaires le représentant légal de la société ait agi sans pouvoir en concluant un contrat, la question se pose de savoir si le tiers peut obtenir l’annulation du contrat. Il s’agit donc de mettre en œuvre l’article 1156 du code civil alinéa 2 (25) aux termes duquel « [l]orsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité ». Reste alors la question de savoir si l’on doit considérer que le tiers connaissait les limitations statutaires des pouvoirs puisque les statuts sont publiés et lui sont en conséquence en principe opposables (26), sous réserve de la connaissance de l’objet social. La réponse pourrait être négative puisque le droit positif construit l’ignorance par le tiers des limitations statutaires des pouvoirs en indiquant que celles-ci lui sont inopposables. Par conséquent, il nous semble délicat de tirer de la publicité des statuts une opposabilité des clauses limitatives des pouvoirs aux tiers que le droit positif nie. Tout au plus pourrait-on admettre que la société puisse démontrer que le tiers avait connaissance, à la date de l’acte dont il demande la nullité, de l’existence et du contenu des clauses limitatives des pouvoirs du représentant légal. La preuve de la réalité de sa connaissance ne modifiera certes pas le fait qu’il peut toujours prétendre ignorer ces clauses comme la loi le prévoit. Mais elle devrait permettre d’établir que lorsqu’il s’en prévaut dans le cadre d’une action en nullité fondée sur un défaut de pouvoir du représentant légal, sa connaissance de la clause remonte en réalité à la date de conclusion de l’acte ce qui l’empêche de pouvoir en obtenir la nullité sur le fondement de l’article 1156 al. 2 du code civil. À tout le moins, face à une demande en nullité émanant du tiers cocontractant fondée sur un défaut de pouvoir du représentant légal à engager la société dans un acte au motif que les autorisations sociétaires n’ont pas été obtenues, il restera à la société la possibilité de ratifier cet acte conformément aux statuts comme le permet le dernier alinéa de l’article 1156 du code civil. La question se pose alors de savoir jusqu’à quand la société pourra ratifier cet acte. Au demeurant, cette question se pose également dans toutes les situations où la personne déclarant agir au nom de la société, sur le fondement notamment d’une délégation, n’en avait pas les pouvoirs. La jurisprudence est en principe très accueillante lorsqu’il s’agit d’admettre la faculté de ratification par le représenté de l’acte réalisé par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs comme le montre à nouveau une décision de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 (27). En l’espèce, une société d’assurance avait résilié les protocoles de courtage la liant à l’un de ses courtiers. Ce dernier, considérant que la personne qui avait résilié les protocoles au nom de la société d’assurance n’en avait pas les pouvoirs assigne la société d’assurance en annulation des résiliations intervenues et en paiement de dommages-intérêts. Les juges du fond ne font pas droit à ces demandes et la Cour de cassation rejette son pourvoi. À la suite des juges du fond, elle considère que la résiliation du contrat ne peut être annulée dans la mesure où la société d’assurance « ayant reconnu, dans ses conclusions d’appel, avoir ratifié tacitement la décision de résiliation des conventions de courtage, prise par Mme Z… pour son compte, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette dernière avait reçu pouvoir pour y procéder ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ». C’est donc dire que le représenté peut en principe ratifier l’acte passé par le représentant sans pouvoir jusqu’à ce que le juge du fond statue. Cette solution sera-t-elle maintenue pour les actes conclus à compter du 1er octobre 2016 ? Nous l’avons vu, l’article 1156 alinéa 2 du code civil issu de l’ordonnance du 1er février 2016 offre au cocontractant qui a ignoré que le représentant agissait sans pouvoir ou en dépassement de ses pouvoirs la faculté de demander la nullité (28) de l’acte ainsi conclu. L’alinéa 3 de ce texte dispose que « l’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès que le représenté l’a ratifié ». Aussi, la question se pose de savoir si cette ratification ne peut désormais intervenir qu’avant que le tiers n’invoque la nullité c’est-à-dire avant l’introduction de l’instance en nullité de l’acte (29), ou, comme par le passé, jusqu’à ce que la nullité soit définitivement prononcée (30).
II – Rémunération du dirigeant et convention de management
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 décembre 2018 (31) revient sur la question importante de la validité des conventions dites de management (32). En l’espèce, la société Sequana, société mère d’un groupe dont faisait partie la SAS AWS, souhaitait céder sa « branche sécurité ». Pour réaliser l’opération, la société Sequana a eu recourt à M.G. et l’a notamment fait nommer président d’AWS et président de plusieurs des filiales contrôlées par AWS. Dans le même temps, elle a conclu avec la société H, créée par M.G., un contrat de prestation de services. À la suite de l’échec de la cession de la branche d’activité, M.G. a été révoqué de ses mandats sociaux et la société Sequana a notifié à la société H la résiliation du contrat de prestation de services avec effet immédiat et sans indemnité en raison d’une faute lourde. M.G. et la société H ont alors assigné la société AWS et la société Sequana en réparation de leurs préjudices. Condamnée à payer à la société H une certaine somme au titre du contrat de prestation de services, la société Sequana forma un pourvoi en cassation en reprochant notamment au juge du fond de ne pas avoir annulé le contrat de prestation de services pour défaut de cause. Elle estimait en effet que les statuts de la société AWS conféraient à M.G. un pouvoir de représentation de cette société à l’égard des tiers ainsi qu’un pouvoir de déterminer et de mettre en œuvre les orientations politiques de la société. Dès lors, elle considérait que la détermination des modalités de cession de la société faisait nécessairement partie des fonctions sociales de l’intéressé. De manière plus générale, elle considérait qu’une confusion existait entre les missions exercées par M.G. au titre de son mandat et celles qui lui étaient personnellement confiées au titre du contrat de prestation de services, lequel était privé de contrepartie et donc de cause. En d’autres termes, le pourvoi était fondé sur la jurisprudence considérant qu’une convention de prestation de services dont l’objet est la mise à disposition d’une personne au profit d’une société pour que celle-ci exerce une mission en son sein est dépourvue de cause lorsque cette personne est le dirigeant de la société et que sa mission contractuelle correspond aux prestations qu’elle doit réaliser au titre de ses fonctions sociales (33). Dans une telle situation, la convention de prestation de service est dépourvue de contrepartie et doit, aujourd’hui (34) comme hier, être annulée. Cela étant, dans notre espèce, la convention de management avait un objet plus large que la direction de la SAS AWS, statutairement définie par son article 16, puisqu’elle comportait une prestation au profit de la société Sequana, mais également au profit d’autres sociétés du groupe. En outre, cette convention n’avait pas été conclue par la société AWS mais par sa société mère avec la société H et non avec le dirigeant de la société AWS, M.G., même si celui-ci était par ailleurs l’unique associé de la société H. Ces éléments avaient conduit les juges du fond à considérer que la convention de management ne servait pas à rémunérer les fonctions de M.G. La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère « qu’ayant fait ressortir que le contrat de prestation conclu entre la société Sequana et la société Herschel gestion ne rémunérait pas les fonctions de M.G. en qualité de mandataire social de la société AWS, la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait ».
La Cour de cassation n’abandonne donc pas, à juste titre, la jurisprudence précitée de 2010 et de 2012 (35). La Cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que les juges du fond avaient suffisamment caractérisé le fait que la convention de prestation de service ne rémunérait pas les fonctions de M.G. en qualité de mandataire social d’AWS. Et en l’espèce, il est vrai que la mission de la société H et donc de M.G. ne se limitait nullement à la seule gestion de la société AWS. A contrario, une convention de prestation de services dont l’objet serait de rémunérer un dirigeant pour l’exercice de ses fonctions sociales resterait nulle pour défaut de contrepartie (36). Reste alors la question de savoir ce que recouvre exactement, tant en droit des contrats, qu’en droit des sociétés, les missions et fonctions du dirigeant social dont la réalisation ne pourrait constituer l’objet d’un contrat de prestation de services (37). Mais en réalité, la difficulté principale tient dans les contrats de « management fees » où la même personne est tout à la fois le dirigeant de la société, et celle qui exécute pour cette société une mission particulière. C’est bien cette ubiquité qui rend ici la figure contractuelle du contrat de prestation de services suspecte puisque l’on peut se demander en quoi les services rendus (38) matériellement par cette personne sont distincts de l’exercice de sa mission de dirigeant. En revanche, cette ubiquité ne semble pas menacer, logiquement, le contrat de prestation de services lorsque la mission du débiteur « matériel » de la prestation, par ailleurs dirigeant d’une société d’un groupe, dépasse la gestion de cette filiale et s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une opération de restructuration dudit groupe.
III – Responsabilité du dirigeant
A – Faute séparable des fonctions et droit pénal
La victime d’une faute commise par le dirigeant d’une société qui agit contre ce dernier devant les juridictions pénales sur le seul plan civil, doit-elle démontrer que le comportement du dirigeant constitue une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (39) ? Non, répond la chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision du 5 avril 2018 (40). En l’espèce, un dirigeant poursuivi pour abus de confiance car il avait revendu des véhicules, non intégralement payés, grevés d’une clause de réserve de propriété est relaxé en première instance. La partie civile forme appel et la juridiction d’appel, seulement saisie des intérêts civils, condamnent le dirigeant au motif que celui-ci avait bien commis une faute ayant causé le dommage dont il était demandé réparation. Le dirigeant forme un pourvoi en cassation au motif que les juges du second degré avaient considéré qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sans avoir établi les caractéristiques ci-dessus rappelées. Ce pourvoi est rejeté car, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce grief est totalement inopérant. Pour la Haute juridiction, devant les juridictions pénales, pour que le dirigeant engage sa responsabilité civile à l’égard de la partie civile, il faut et il suffit que sa faute soit établie à partir et dans la limite des faits faisant l’objet de la poursuite. Il n’est nul besoin que cette faute soit séparable de ses fonctions. Cette décision nous semble devoir être approuvée (41). Dans l’espèce sous examen, la partie civile ne pouvait plus faire réexaminer le comportement pénal du dirigeant. Aux termes de l’article 497 du code de procédure pénale, les jugements rendus en matière correctionnelle ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel par la partie civile que pour ce qui concerne ses intérêts civils. Par conséquent, si le prévenu est relaxé par le tribunal correctionnel, comme cela était le cas en l’espèce, la partie civile ne peut former appel que pour obtenir la condamnation du prévenu à réparer le préjudice que sa faute, tirée des éléments dont peuvent connaître les juges d’appel, lui aura causé. Et c’est à ce stade que la question de la faute séparable des fonctions se pose. En effet, la victime qui a pu se porter partie civile doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice né de l’infraction pénale sans autre condition (42). Ce lien est-il rompu en cas d’appel de la partie civile sur les seuls intérêts civils ? De prime abord, on pourrait le penser puisqu’il est désormais impossible de prononcer une sanction pénale. Seule une faute civile peut donc être caractérisée en appel, faute qui doit résulter des faits faisant l’objet de la poursuite puisque l’article 3 du code de procédure pénale précise que l’action civile est recevable en matière pénale pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits faisant l’objet de la poursuite. Dès lors, la juridiction pénale saisie des seuls intérêts civils doit-elle déclarer recevable l’appel sur les chefs de dommages précités et s’écarter, pour analyser les conditions nécessaires à leur réparation, de la qualification des seuls faits faisant l’objet de la poursuite, et partant, éventuellement admettre la théorie de la faute séparable des fonctions lorsque le prévenu relaxé était un dirigeant social ? Doit-elle au contraire ne s’en tenir qu’aux faits faisant l’objet de la poursuite pour savoir si ces faits constituent une faute civile et exclure par conséquent tout élément relevant de l’imputabilité de cette faute au prévenu ? En effet, lorsqu’il s’agit de savoir si le tiers peut engager la responsabilité civile du dirigeant social, il s’agit tout d’abord de savoir si les faits reprochés peuvent constituer une faute de ce dirigeant et ensuite s’interroger sur la possibilité pour ce tiers de lui imputer cette faute (43). Et c’est à ce deuxième stade qu’intervient le concept de faute séparable des fonctions imaginé par les juridictions civiles, concept qui interdit au tiers à la société d’imputer au dirigeant une faute quelconque dans l’exercice de ses fonctions et qui l’oblige à démontrer que le dirigeant n’a pas seulement commis une faute qui lui cause un préjudice, mais a commis une faute séparable de ses fonctions. Si l’on estime que la victime doit pouvoir obtenir réparation de la faute civile commise par le prévenu né des seuls faits faisant l’objet de la poursuite (44), on comprend alors la position adoptée par la Cour de cassation. La question de savoir si les faits en cause permettent d’imputer au dirigeant la faute qui en résulterait, et donc de savoir si elle est séparable des fonctions, est inopérante puisque l’imputation est réglée par les dispositions légales qui permettent à la victime d’obtenir réparation du dommage à la seule condition que les faits faisant l’objet de la poursuite constituent une faute correspondant aux caractéristiques de l’infraction poursuivie (45). On comprend dès lors que « le grief tiré du défaut d’établissement d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n’ayant pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (46).
Cette solution, qui existait déjà en filigrane dans la jurisprudence de la chambre commerciale, nous semble tout à fait fondée pour les raisons indiquées plus haut. On peut cependant en regretter les conséquences puisque les victimes pourraient avoir tendance à rechercher la responsabilité pénale des dirigeants pour obtenir plus aisément réparation au plan civil. Cela étant, il ne faut tout de même pas exagérer le risque d’une pénalisation accrue des litiges impliquant les dirigeants sociaux puisqu’il faudra tout de même que les faits puissent permettre aux victimes des prétendues infractions de se porter partie civile. Il faudra donc qu’elles démontrent qu’elles ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction poursuivie et donc, en principe, qu’elles entrent dans le champ des victimes protégées par l’infraction imputée au dirigeant de la société, même si, sur ce point, la chambre criminelle de la Cour de cassation a une vision parfois assez large des intérêts protégés par les dispositions du droit pénal (47). Exit donc la condition de faute séparable des fonctions pour engager la responsabilité civile du dirigeant devant les juridictions pénales. Lorsque la faute résulte des faits faisant l’objet de la poursuite, cette faute est directement imputable au dirigeant et la partie civile peut obtenir réparation de son préjudice en lien de causalité avec cette faute. Bien évidemment la faute sera établie si l’infraction l’est également. Peu importe alors que l’infraction poursuivie soit intentionnelle ou non. Dès lors, on comprend sans difficulté que la chambre criminelle de la Cour de cassation ait jugé, dans un autre arrêt du 5 avril 2018 (48), que « dès lors que le prévenu, devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituent que des contraventions, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice ».
B – Dirigeant de fait et quitus
Un arrêt du 14 février 2018 (49) rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne (notamment) l’action en responsabilité que la société souhaite exercer à l’encontre de l’un de ses dirigeants de fait. Dans cette affaire, un gérant d’une SARL démissionnaire, mais dont la cessation des fonctions n’avait pas été publiée, cède deux brevets de la société à un tiers. La société demande la nullité de la cession et recherche la responsabilité de son ancien gérant devenu dirigeant de fait à la suite de sa démission au motif qu’il aurait commis une faute en vendant lesdits brevets.
L’action en nullité est rejetée sans surprise dans la mesure où la cessation des fonctions n’avait pas été publiée et qu’il était en outre établi que le tiers ne connaissait pas cette situation (50). Par conséquent, la société ne pouvait opposer à ce tiers, pour se soustraire à ses engagements, cette cessation des fonctions non publiée (51) et, partant, le défaut de pouvoir du dirigeant démissionnaire. Les juges du fond rejettent également l’action en responsabilité intentée par la société à l’encontre de l’ancien gérant devenu dirigeant de fait (52) car l’assemblée générale de la société avait, postérieurement aux cessions réalisées par ce dernier, adopté une résolution aux termes de laquelle « l’assemblée générale prend acte que M. D…, malgré sa démission du 31 mars 2008 de ses fonctions de gérant, a poursuivi son mandat dans les mêmes conditions qu’antérieurement et décide de lui donner quitus de sa gestion jusqu’à ce jour et renonce à tout recours à son encontre ». En d’autres termes, pour les juges du fond, l’assemblée ayant donné quitus au dirigeant de fait, et en conséquence renoncé à tout recours, elle ne pouvait plus le poursuivre. Bien évidemment la société critiquait cette analyse et considérait qu’il convenait au contraire d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce aux termes duquel « aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Sans surprise cependant, le pourvoi est rejeté : « mais attendu que l’article L. 223-22 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les gérants de droit ; que l’arrêt constate que l’assemblée générale extraordinaire de la société Odin tenue le 3 octobre 2011 a, selon une résolution adoptée à l’unanimité, pris acte de ce que M. D… avait, malgré sa démission du 31 mars 2008 de ses fonctions de gérant, poursuivi son mandat et relève que selon cette même résolution, l’assemblée générale a décidé de lui donner quitus et renoncé à tout recours ; que de ces seules constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel a pu déduire que l’action en responsabilité formée par la société et les associés contre Jean D…, gérant de fait, devait être rejetée ». C’est donc dire que le régime de responsabilité civile (53) applicable au dirigeant de fait relève non du droit des sociétés, mais seulement du droit commun, les juges refusant d’étendre les dispositions concernant les seuls dirigeants de droit au dirigeant de fait. Cela lui sera tantôt défavorable (54), tantôt, comme en l’espèce, favorable (55) puisque, appliquant le droit commun, la Cour de cassation admet que la société puisse renoncer à agir en responsabilité à l’encontre de son dirigeant de fait alors qu’elle ne le peut à l’encontre de son dirigeant de droit. Pour conclure, on notera que cette renonciation, qui engage la société, a été exprimée par la seule assemblée générale. Cela montre qu’un tel organe peut, à côté du représentant légal, parfois engager directement la société et donc que le consentement sociétaire ne peut se résumer à celui de son représentant légal ni dans sa construction, ni même, parfois, dans son extériorisation (56).
IV – Cessation des fonctions des dirigeants
A – Juste motif de révocation
Plus exactement, lorsque les associés perdent confiance (57) en celui qu’ils ont nommé pour diriger la société, peuvent-ils, sans faute, le révoquer pour ce motif lorsque la loi ou les statuts exigent que ce motif soit juste ? L’admettre sans nuance reviendrait certainement à détruire l’exigence d’un juste motif puisque le sentiment de perte de confiance est intime et que le juge ne pourrait vraisemblablement que s’incliner face à l’extériorisation de l’expression de ce sentiment. On comprend donc qu’il ne suffise pas de perdre confiance, encore faut-il montrer que cette perte de confiance est objectivement fondée (58). Ainsi, tel dirigeant qui aurait, même en dehors du cadre sociétaire, menti à plusieurs reprises aux associés pourrait-il objectivement perdre leur confiance. Pour autant, cette perte objective de confiance suffit-elle à constituer un juste motif de révocation ? On pourrait le penser dans la mesure où la nomination repose précisément sur la confiance faite par les associés au dirigeant et lorsque celle-ci est atteinte objectivement, lorsqu’un associé normalement prudent et diligent a perdu confiance, la cause fondamentale de la présence du mandataire social disparaît. Dès lors, on pourrait parfaitement admettre que cette perte « objective » de confiance suffit à constituer un juste motif (59). Tel ne semble pas l’avis de la Cour de cassation (60) qui, dans un arrêt du 14 novembre 2018 (61), reproche au juge du fond d’avoir admis la révocation d’un président de SAS pour juste motif, lequel était requis par les statuts, au motif que nonobstant les bons résultats de la société de 2006 à 2010 sous sa présidence, la perte de confiance des actionnaires à son égard, pour subjective qu’elle soit, apparaît bien réelle et constitue un motif légitime de révocation. Pour la haute juridiction, « (…) en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte de confiance était de nature à compromettre l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette décision admettrait donc que la perte de confiance puisse constituer une juste cause de révocation d’un dirigeant social lorsqu’elle est de nature à compromettre l’intérêt social. Avouons que la formule retenue par la Cour de cassation est maladroite, car comme l’a relevé Dominique Schmidt, ce n’est pas la perte de confiance qui est de nature à compromettre l’intérêt social, mais les faits qui la fondent. C’est parce que le dirigeant a commis des faits de nature à compromettre l’intérêt social que les associés ont perdu confiance en lui et le révoquent. Mais dans cette situation, ce n’est pas la perte de confiance qui constitue les justes motifs de révocation ; ce sont les faits commis par le dirigeant de nature à compromettre l’intérêt social (62). Si l’on s’en tient à cette analyse, la perte de confiance ne pourrait jamais fonder la révocation du dirigeant pour juste motif puisque seuls des faits objectifs compromettant l’intérêt social le pourraient (63). Exit donc cette perte de confiance, qui par nature est subjective (64). En réalité, on peut avoir une lecture plus nuancée de cet arrêt. On peut en effet considérer que le lien établi par les juges entre la perte de confiance et la compromission de l’intérêt social est non objectif, mais subjectif. Dans cette analyse, ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui justifient la révocation, mais la manière dont les associés ont pu raisonnablement les comprendre et fonder leur conviction que ce dirigeant n’était plus à même de poursuivre l’intérêt de la société. En d’autres termes, lorsque les faits conduisent les associés à penser légitimement que le dirigeant n’est plus en mesure d’assurer la gestion de la société au mieux de son intérêt, et donc qu’ils n’ont plus confiance dans ses capacités pour assurer l’avenir, ils pourraient le révoquer pour juste motif (65). Souhaitons que telle soit l’analyse de la Cour de cassation qui permet de maintenir le caractère fondamental du lien fiduciaire entre le dirigeant et les associés, sans pour autant faire de la révocation pour juste motif une révocation ad nutum par une acceptation purement subjective de la révocation pour perte de confiance.
V – Dissolution de la société pour faute de l’associé
La dissolution d’une société peut-elle être prononcée par le juge à la suite de la demande formulée par un associé, lorsqu’il est constaté que l’un des coassociés a manqué à ses obligations ? On sait en effet que l’article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. On aurait donc pu déduire d’une lecture littérale de cette disposition que l’inexécution de ses obligations par un associé suffit pour que le juge prononce la dissolution de la société. Telle n’est heureusement pas l’analyse suivie par la Cour de cassation dans une décision du 3 mai 2018 (66). Dans cette affaire, l’un des associés d’une SARL demandait notamment au juge d’en prononcer la dissolution au motif qu’un autre associé avait manqué à ses obligations en faisait acquérir par la société son fonds de commerce pour un prix surévalué en contournant la procédure des conventions réglementées. Les juges du fond avaient refusé de prononcer cette dissolution car il n’était pas établi que la faute de l’associé conduisait à une paralysie de la société. La Cour de cassation les en approuve et rejette le pourvoi en considérant « que l’inexécution des obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5° du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société », paralysie non démontrée en l’espèce. La Cour de cassation érige donc en facteur commun la paralysie de la société (67) pour que la dissolution puisse intervenir, non seulement, pour mésentente (68) mais également pour inexécution par un associé de ses obligations (69). Plus largement, la Cour de cassation semble considérer que la paralysie de la société intègre le juste motif, la juste cause de dissolution. En d’autres termes, il ne peut y avoir de juste cause de dissolution sans paralysie de la société (70). Qu’en penser ? On peut certainement approuver cette solution dans la mesure où elle permet de préserver des sociétés dont la pérennité n’est pas compromise par l’inexécution qui l’affecte. Cela d’autant plus qu’en cas d’inexécution par un associé de ses obligations, celui-ci pourra engager sa responsabilité civile, suivant les cas, envers la société, des associés et éventuellement des tiers (71). En outre, d’un point de vue contractuel, la solution mérite d’être approuvée. Dans l’ordre contractuel, la dissolution judiciaire pour inexécution par un associé de ses obligations correspond à une résiliation judiciaire du contrat de société pour inexécution. Or, en matière contractuelle, le juge saisi d’une telle demande de résolution n’est pas tenu de la prononcer, en particulier si l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour compromettre définitivement le contrat (72). On comprend donc que la Cour de cassation considère que seule la paralysie de la société causée par l’inexécution par un associé de ses obligations peut conduire le juge à prononcer la liquidation.
Pour conclure, on notera encore que les statuts doivent pouvoir envisager cette situation d’inexécution par l’associé de ses obligations et prévoir dans ce cas qu’il pourra être exclu. La loi l’envisage d’ailleurs parfois (73). On pourrait même certainement admettre que les comportements des associés caractérisant une inexécution suffisamment grave de leurs obligations puissent conduire à leur exclusion en l’absence de clause ou de disposition légale particulière. Une telle exclusion pourrait être fondée sur la résolution du contrat d’apport (74). On sait cependant que la jurisprudence majoritaire n’est pas en ce sens (75) et qu’elle refuse de prononcer l’exclusion d’un associé à défaut de clause statutaire ou de disposition légale le permettant expressément (76).
Notes :
(1) Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-17.600, BJS 2018, n° 119c5, p. 627, Gaz. Pal. 18 déc. 2018, n° 44, p. 81, obs. M. Roussille ; Dr. sociétés 2018, comm. 207, note J. Heinich ; Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-24.146, Dr. sociétés 2018, comm. 84, note J. Heinich.
(2) V. Déjà pour une SARL, Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, D&P 2016, n° 259 et réf. citées.
(3) En ce sens J.-F. Barbiéri, note précit. ; D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
(4) Les articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ont été modifiés par la loi Pacte pour exclure que la violation de l’alinéa 2 de l’article 1833 puisse entraîner la nullité de la société, la nullité des actes et délibérations sociétaires. Cela étant, la nullité que nous envisageons n’est pas celle d’un acte ou d’une délibération sociétaire, mais celle d’un contrat conclu par la société, par exemple une sûreté, cf. D. Poracchia, précit.
(5) Il s’agit de ne pas engager la société, cf. art. 9 § 1 al. 2 Dir. 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. En outre, dans l’hypothèse envisagée, le dirigeant aura agi au-delà de ses pouvoirs. Par conséquent l’article 1156 du code civil devrait s’appliquer et l’acte déclaré inopposable à la société.
(6) À supposer que cela soit possible si les statuts ne le prévoient pas. Au demeurant, dans une SAS on peut même se demander si une telle clause des statuts permettant aux actionnaires d’habiliter le président à agir en toute hypothèse au-delà de l’objet social peut, sans modifier l’objet social, purger l’éventuelle nullité de l’acte conclu par le représentant muni d’une telle habilitation. En effet, la loi ne prévoit pas, pour les SAS, la possibilité pour les associés d’autoriser le président à agir au-delà de l’objet social, sans le modifier.
(7) Cass. com., 18 juin 1980, n° 78-16.419, Bull. IV, n° 264.
(8) Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-16.013, BJS 2018, p. 412, note E. Schlumberger ; Rev. sociétés 2018, p. 378, note R. Dalmau ; Gaz. Pal. 26 juin 2018, n° 324z0, note M. Roussille ; Dr. sociétés 2018, comm. 85, note C. Coupet.
(9) Et spécialement dans les groupes de sociétés.
(10) V. not. Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-11.785, D&P mai 2009, n° 181.
(11) Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-18.313, BJS 1992, p. 946, note P. Le Cannu ; Cass 3e civ., 24 janv. 2001, n° 99-12.841, D&P juill.-août 2001, p. 112.
(12) Sur la question, v. not. A.-C. Rouaud, « Limitations statutaires au pouvoir d’agir en justice du représentant légal », Rev. sociétés 2014, p. 415 ; D. Gallois-Cochet, « L’invocabilité par les tiers des clauses limitant le pouvoir des dirigeants sociaux », Mélanges M. Germain, LexisNexis, LGDJ-Lextenso 2015, p. 325.
(13) V. déjà, Cass. 2e civ., 23 oct. 1985, n° 83-12.007, Rev. sociétés 1986, p. 409, note B. Bouloc ; RTD Civ. 1986, p. 180, obs. R. Perrot.
(14) Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-21.077, BJS 2018, n° 118n5, note A. Couret ; Gaz. Pal. 26 juin 2018, n° 325d9, p. 75, note D. Gallois-Cochet ; Rev. sociétés 2019, p. 42, note A. Lecourt ; Dr. sociétés 2018, comm. 98, obs. R. Mortier.
(15) Opalis étant une SARL, le concept d’assemblée générale extraordinaire est impropre.
(16) V. D. Gallois-Cochet, précit., même si les statuts modifiés n’avaient pas été publiés.
(17) La question pourrait se poser de savoir si, sans modifier les statuts, une décision de la collectivité des associés d’une SARL pourrait limiter les pouvoirs du représentant légal, l’article L. 223-18 C. com. n’envisageant qu’une possibilité de limitation statutaire des pouvoirs. Le même article précise par ailleurs que dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts et dans le silence de ceux-ci par l’article L. 221-4 C. com, texte selon lequel dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs dans les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
(19) La jurisprudence admet également que le salarié peut critiquer son licenciement au motif que le représentant légal n’avait pas, à raison des statuts, voire des dispositions d’un pacte extrastatutaire, le pouvoir de le licencier, v. A. Couret, précit. ; R. Mortier, précit.
(19) Notamment pour établir la faute délictuelle du cocontractant ayant manqué à ses obligations contractuelles, Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; RTD Civ. 2007, p. 123, obs. P. Jourdain ; JCP 2006. II. 10181, avis Gariazzo et note M. Billiau ; RCA 2006. études 17, L. Bloch ; Contrats conc. consom. 2007, p. 11, note L. Leveneur.
(20) V. Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-25.567, D&P 2013, n° 226, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RDC 2013/2, p. 533, note Y.-M. Laithier ; RDC 2013/3, p. 915, J.-B. Borghetti ; BJS 2013, p. 191, note H. Barbier ; D. 2013, p. 746, note R. Boffa. Aux termes de cette décision, « si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c’est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l’application d’une règle juridique lui conférant le droit qu’il invoque ».
(21) Et des dispositions européennes dont elles sont issues, v. art. 9 § 2 Dir. 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(22) V. art. 9 § 3 Dir. 2017/1132 du 14 juin 2017, précit.
(23) Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 16-28.672, BJS 2018, p. 483, note A. Couret ; Dr. sociétés 2018, comm. 160, obs. R. Mortier ; Rev. sociétés 2019, p. 42, note B. Lecourt ; RTD Com. 2018, p. 701, obs. B. Lecourt ; ibid., p. 982, note M-H. Monsérié-Bon ; JCP E 2019, 1145, n° 8, obs. R. Raffray.
(24) En ce sens Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-25.675, D&P 2014, n° 236 et réf. citées.
(25) Pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Par ailleurs, l’alinéa 1er de cette disposition est inapplicable puisque les clauses limitatives des pouvoirs ne peuvent être opposées aux tiers par la société.
(26) En ce sens B. Lecourt, précit., p. 46, n° 16.
(27) Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-22.285, BJS mai 2018, p. 272, note N. Ferrier ; Gaz. Pal. 26 juin 2018, n° 325e1, p. 74, obs. L. Rougé-Viance.
(28) Faculté que le droit positif lui fermait, tout au moins lorsque le mandataire agissait sans pouvoir, la jurisprudence considérant que l’acte réalisé sans pouvoir était nul de nullité relative laquelle ne pouvait être demandée que par le représenté, cf. Ph. Le Tourneau, Rep. Civil, v° Mandat, 2017, n° 362 ; add. Cass. com., 12 nov. 2015, n° 14-23.340, D&P 2016, n° 259.
(29) En ce sens, A. Tadros, « La délégation de pouvoirs en droit des sociétés : aspects de droit civil après la réforme du droit commun des contrats », D. 2017, p. 1662, n° 21.
(30) V. not. O. Deshayes, Th. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2016, p. 248.
(31) Cass. com., 12 déc. 2018, n° 16-15.217, BJS mars 2019, 119 p. 8, p. 23, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2019, comm. 46, note C. Coupet ; Gaz. Pal., 26 mars 2019, p. 77, obs. C. Barillon.
(32) V. réc. C. Coupet, « Contrat de management et organisation sociétaire », AJ Contrat 2017, p. 61 ; A. Reygrobellet, « Les conventions de management fees : où en est-on ?», BJS 2018, p. 120.
(33) Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-16.084, BJS 2010, p. 960, note P. Le Cannu, JCP E 2010, 1995, note A. Viandier, Dr sociétés 2010, comm. 226, note D. Gallois-Cochet, D. 2011, p. 57, note F. Marmoz ; Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.376, D&P 2011, n° 203 ; Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.376, Rev. sociétés 2013, p. 160, note A. Reygrobellet ; D. 2013, p. 686, note D. Mazeaud ; BJS 2013, p. 108, note D. Ferrier.
(34) En application de l’article 1169 du code civil qui dispose qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », et a fortiori n’existe pas.
(35) Comp. Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-11.105, BJS 2017, n° 116d3, p. 177, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2017, comm. 41, note C. Coupet.
(36) On notera cependant que la Cour de cassation (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19.685, Rev. sociétés 2016, p. 443, note L. Godon ; JCP E 2016, 1018, note B. Dondero ; BJS 2016, p. 137, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 2016, comm. 60, note D. Gallois-Cochet) semble admettre à la suite des juges du fond que lorsque la société est une SAS la question de la validité d’une telle convention de prestation de service peut dépendre des stipulations statutaires : « Ayant énoncé que l’article L. 227-5 du code de commerce renvoyait aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la société par actions simplifiée, et relevé que les statuts prévoyaient seulement les modalités de désignation du président, éventuellement assisté d’un vice-président, c’est sans dénaturer les statuts que la cour d’appel a retenu qu’ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de service. » Les auteurs précités, et nous avec eux, s’interrogent cependant sur la possibilité d’externaliser ainsi totalement la direction d’une SAS.
(37) V. A. Coupet et A. Reygrobellet, précit.
(38) Lorsqu’ils ne sont pas purement techniques.
(39) Cass. com., 20 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 84, Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 786, § 167, note H. Le Nabasque ; Rev. sociétés, 2003, p. 479, note J.-F. Barbiéri ; D. 2003, p. 1502, obs. A. Lienhard, et p. 2623, note B. Dondero ; D. 2004, somm., p. 266, obs. J.-Cl. Hallouin ; RTD com., 2003, p. 523, obs. P. Chazal et Y. Reinhard, et p. 741, obs. Cl. Champaud et D. Danet ; RTD civ., 2003, p. 509, obs. P. Jourdain ; D&P, nov. 2003, p. 91 et nos obs. ; JCP, éd. G, 2003, II, n° 10178, note S. Reifegerste, et éd. E, 2003, p. 1203, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker, et p. 1398, note S. Hadji-Artanian ; JCP G, 2004, I, n° 101, spéc. n° 21, obs. G. Viney ; LPA n° 223, 7 nov. 2003, p. 13, note S. Messaï ; Bull. Lamy Sociétés commerciales, sept. 2003, p. 1, note I. Grossi ; Dr. sociétés, 2003, comm. n° 148, obs. J. Monnet ; Banque et droit, sept.-oct. 2003, p. 64, obs. M. Storck ; Defrénois, 2003, art. 37801, p. 1067, note M.-H. Maleville-Costedoat ; RJDA, 2003/8-9, p. 747, n° 842, et p. 717, avis de R. Viricelle.
(40) Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-87.669, BJS 2018, p. 258, concl. R. Salomon, note A. Couret ; Dr. sociétés 2018, comm. 83, note J. Heinich.et concl. R. Salomon ; D. 2018, concl. R. Salomon, p. 1128 ; ibid., p. 1137, chron. L. Saenko ; ibid., p. 2056, obs. E. Lamazerolle ; RJ Com. 2018, obs. C. M. ; JCP G, 2018, 644, note J.-H. Robert ; AJ pénal 2018, p. 248, note C. Mangematin ; RTD Civ. 2018, p. 677, note P. Jourdain. Add. O. Dexant de Bailliencourt, « Pour une consécration légale de la faute séparable des fonctions du dirigeant – Proposition d’ajout au projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2019, p. 144. Sur l’autonomie du droit pénal en matière de faute des dirigeants constitutive d’une infraction pénale, v. not. Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-81.422 considérant que « le prévenu devant répondre des conséquences dommageables de l’infraction dont il s’est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice ».
(41) Contra, not. L. Saneko, P. Jourdain, J.-H. Robert, précit.
(42) Cf. art. 2 CPP
(43) Le plus souvent, on explique que le tiers ne peut poursuivre le dirigeant social lorsque la faute n’est pas séparable car, vis-à-vis du tiers, c’est la société qui a agi et non le dirigeant. J.-P. Métivet, Rapport Cour de cassation 1998 ; S. Messaï, La responsabilité civile des dirigeants sociaux, Th. Paris I, 2005, dir. P. Le Cannu, n° 602.
(44) Les juges pénaux statuant sur seuls intérêts civils ne peuvent pas rechercher si les faits poursuivis constituent une infraction pénale (CEDH, 12 avr. 2012, Lagardère c/ France, spé. § 55 et 87, JCP G, 724, note A. Dethomas ; D. 2012, p. 1708, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2012, p. 421, obs. S. Lavric ; Rev. sociétés 2012, p. 517, obs. H. Matsopoulou ; RSC 2012, p. 695, obs. D. Roets ; AJDA 2012, p. 1726, obs. B. Burgogue-Larsen). Ils doivent, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, rechercher si les conséquences dommageables ont été causées par la faute civile du prévenu, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite (Cass. crim., 5 févr. 2014, n° 12-80.154, Bull. crim. 2014, n° 35 ; JCP G 2014, act. 195, obs. J.-Y. Maréchal ; Dr. pén. 2014, comm. 46, note A. Maron et M. Hass ; L. Saenko, « L’infraction, la faute et le droit à réparation », D. 2014, p. 807 ; V. Wester-Ouisse, « Le sort de la victime en cas de relaxe : quelle faute civile ? », D. 2016, p. 2018). Cela signifie « que la faute civile (…) découle de faits entrant dans les prévisions de l’infraction poursuivie, mais non qualifiée. La faute civile doit donc correspondre exactement aux éléments constitutifs de l’infraction, dans ses dimensions tant matérielle que morale », M. Salomon précit. et réf. citées. Cf. art. 2 code de procédure pénale.
(45) R. Salomon, précit.
(46) Cass. crim., 5 avril 2018, précit.
(47) V. not. J. Gallois, L’exercice de l’action civile par l’associé, Th. Université Paris-Saclay, 2018, n° 88 et s.
(48) Cass. crim., 5 avril. 2018, n° 16-83.961, BJS 2018, p. 258, concl. R. Salomon, note A. Couret ; Dr. sociétés 2018, comm. 83, note J. Heinich.et concl. R. Salomon ; D. 2018, concl. R. Salomon, p. 1128 ; ibid, p. 1137, chron. L. Saenko ; ibid, p. 2056, obs. E. Lamazerolle ; RJ Com. 2018, obs. C. M. ; JCP G, 2018, 644, note J.-H. Robert ; AJ pénal 2018, p. 248, note C. Mangematin ; RTD Civ. 2018, p. 677, note P. Jourdain.
(49) Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-24.146, Dr. sociétés 2018, comm. 84, note J. Heinich ; Gaz. Pal., 26 juin 2018, n° 325d5, p. 78, obs. A. Rabreau.
(50) À supposer que cela soit nécessaire. Tel est le cas si l’on admet que l’article L. 210-9 al. 2 C. com. n’exclut pas l’application de l’article L. 123-9 C. com, en ce sens, CA Paris, 25e ch. A, 15 sept. 1995, BJS 1996, p. 50, note P. Le Cannu.
(51) Art. L. 210-9 al. 2
(52) À l’égard de la société, la démission du gérant lui fait perdre en principe ses fonctions dès qu’elle a été portée à la connaissance de celle-ci, v. not. Cass. com., 20 sept. 2017, n° 15-28.262, D&P 2018, n° 284.
(53) En revanche, les infractions pénales visent le plus souvent tant le dirigeant de fait que le dirigeant de droit.
(54) V. not. Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841, D&P 2011, n° 203 et réf. citées, Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-12.894, BJS 2016, p. 651, note J.-J. Ansault, appliquant à l’action en responsabilité la prescription quinquennale de droit commun.
(55) V. not. Cass. com., 29 mars 2017, n° 16-10.016 ; Dr. sociétés 2017, comm. 101, note J. Heinich ; Rev. sociétés 2017, p. 562, note L. Godon ; BJS 2017, p. 521, note C. Coupet, refusant qu’un associé puisse intenter l’action sociale ut singuli à l’encontre d’un dirigeant de fait.
(56) Sur l’ensemble de la question, voir S. François, Le consentement de la personne morale, Thèse Paris I, 2018.
(57) A. Albarian, « La révocation des mandataires sociaux pour perte de confiance », RTD com. 2012, p. 1
(58) Ibid.
(59) Rapp. Cass. com., 12 juin 2007, n° 06-13.900, BJS 2008, p. 43, note B. Saintourens.
(60) V. not. Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-14.693, Rev. sociétés 1993, p. 800, note P. Didier.
(61) Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-11.103, Rev. sociétés 2019, p. 401, note D. Schmidt ; Dr. sociétés 2019, comm. 25, note J. Heinich ; Gaz. Pal., 26 mars 2019, n° 12, p. 67, obs. J-M. Moulin ; BJS 2019, p. 21, note Th. de Ravel d’Esclapon.
(62) V. not. Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-27.967, Rev. sociétés 2015, p. 371, note A. Viandier ; JCP E 2015, 1463, note B. Dondero ; Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21.633, Dr. sociétés 2017, comm. 186, note C. Coupet ; Rev. sociétés 2017, p. 707, note P.-L. Périn.
(63) Ces faits sont de nature à constituer un juste motif : v. not. Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-15.803, BJS 2007, p. 502, note P. Le Cannu, tout comme la faute du dirigeant, les deux situations pouvant se recouper.
(64) Cette analyse pourrait s’inscrire dans la perspective du nouvel article 1833 al. 2 du code civil souhaitant « détacher » la société de ses associés en affirmant que la société est gérée dans son intérêt social…
(65) En ce sens, CA Paris, 20 mai 2010, RJDA 2010, n° 1088 ; rapp. Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-12.560, Rev. sociétés 2017, p. 413, note A. Couret ; Dr. sociétés 2017, comm. 122, note C. Coupet.
(66) Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456, Rev. sociétés 2018, p. 498, note D. Schmidt ; RTD com. 2018, p. 944, obs. A. Lecourt ; BJS 2018, p. 484, note T. de Ravel d’Esclapon ; Gaz. Pal. 25 sept. 2018, p. 58, obs. B. Buchberger.
(67) Laquelle est très délicate à définir, cf. D. Schmidt, précit.
(68) Comme le texte de l’article 1844-7 5° le prévoit.
(69) Et plus généralement certainement pour justes motifs.
(70) V. déjà en ce sens not. Memento F. Lefebvre, Sociétés commerciales, 2019, n° 86130 ; Lamy sociétés commerciales, 2018, n° 1634 ; M. Germain et V. Magnier, Traité de droit des affaires, Les sociétés commerciales, t. 2, 22e éd., 2017, LGDJ, n° 1617, p. 123 ; cpt., Cass. com., 18 mai 1982, n° 80-12.209, Rev. sociétés 1982, p. 804, note P. Le Cannu.
(71) S’il a commis une faute séparable de ses fonctions d’associé.
(72) V. not. A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd., LGDJ, 2016, n° 392.
(73) V. not. pour la sanction de la non-libération des sommes restant à verser sur le montant des actions souscrites, C. com., art. L. 228-27.
(74) M. Buchberger, Le contrat d’apport, Essai sur la relation entre la société et son associé, préf. M. Germain, éd. Panthéon-Assas, 2011, spé. n° 530 et s.
(75) V. cpt., Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 92-20.005, Rev. sociétés 1995, note Jeantin, p. 525 ; Dr. sociétés 1995, comm. 70, note Th. Bonneau ; v. égal. CA Grenoble, 16 sept. 2010, n° 10-16, ch. com., SA ITM E c/ D.
(76) En ce sens, Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-17.813, Rev. sociétés 1996, p. 554, note D. Bureau.