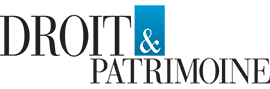Mai à septembre 2014 : Vivent les bêtes !
Plutôt que de s’atteler à une véritable réforme du droit des biens, le Parlement touche aux grandes classifications par le petit bout de la lorgnette de la qualification juridique de l’animal.
Par Jean-Baptiste Seube, Professeur à l’Université de la Réunion, Doyen honoraire de la faculté de droit et d’économie, et Thierry Revet, Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Plutôt que de s’atteler à une véritable réforme du droit des biens, le Parlement touche aux grandes classifications par le petit bout de la lorgnette de la qualification juridique de l’animal. Cherchant un équilibre fragile entre les partisans de la cause animale et les défenseurs de l’agriculture, l’amendement et la façon dont il a été retenu illustrent le peu de considération pour les distinctions fondamentales qui soutiennent la matière. Loin de ces débats théoriques, et confirmant que l’animal reste un bien, la jurisprudence considère que des daurades devenues adultes sont de même nature que les alevins qui avaient été livrés quelques mois auparavant. Elles peuvent donc être revendiquées par le vendeur impayé.
Sommaire
I – Les biens
C. civ., art. 515-14, issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale, séance du 17 septembre 2014 (la nouvelle définition de l’animal)
Cass. com. 11 juin 2014, n° 13-14.844 (identité et nature des choses : le vendeur d’alevins impayé peut-il revendiquer les poissons qu’ils sont devenus ?)
II – Propriété et possession
A – Propriété individuelle
Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-10.404 (qualification de l’ouvrage public et application de la loi dans le temps)
Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-18.136 (les troubles anormaux du voisinage et l’article 1382 du Code civil)
B – Propriétés collectives
Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-21.463 (la mise en demeure de payer les loyers visant la clause résolutoire est un acte conservatoire pouvant être délivré par un indivisaire seul)
Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197 (l’indemnisation des dépenses nécessaires)
III – Les droits réels
Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.970 (quelle incidence de l’absence de tierce opposition dans l’admission d’une servitude ?)
I – Les biens
Une définition de l’animal dans le Code civil ? – Dans la précédente chronique, nous avions mentionné l’existence d’une proposition de loi du 7 octobre 2013 dont l’objet était de définir les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité en ce qu’ils sont dotés d’un système nerveux les rendant scientifiquement aptes à ressentir la douleur et à éprouver des émotions »[1]. Preuve que la question du statut de l’animal préoccupe nos députés, la question du statut juridique de l’animal revient sur le devant de la scène politique, et donne au lecteur des débats parlementaires l’étrange sentiment que si la cause animale transcende les clivages politiques, elle n’exclut nullement les petits coups bas…
En novembre 2013, un projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a été déposé par le gouvernement au Sénat. Ce projet portait sur la réforme du droit des contrats, sur l’informatisation de la procédure pénale, sur la protection des majeurs, sur la réforme du Tribunal des conflits, sur celle des successions… Une véritable loi fourre-tout ! Discuté au Sénat en janvier 2014, le texte est venu devant l’Assemblée nationale en avril 2014 et un amendement a été soutenu, notamment par M. Jean Glavany, ancien ministre de l’Agriculture. Cet amendement, portant le n° 59 et visant à harmoniser le statut de l’animal qui apparaissait écartelé entre différents codes, proposait l’insertion dans le Code civil d’un nouvel article 515-14 selon lequel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». Le 29 avril 2014, était alors déposée une proposition de loi sur le statut juridique de l’animal. Le projet de loi sur la modernisation et la simplification du droit revenant en seconde lecture de l’Assemblée nationale en septembre 2014, le texte est devenu,à la faveur d’un amendement rédactionnel n° CL 10 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Deux lectures du texte sont possibles.
Extrait
001 Futur article 515-14 du Code civil
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Selon une lecture politique, il semble bien que l’amendement « Glavany », déposé à la dernière minute, ait été proposé dans le seul but de couper l’herbe sous le pied, si ce n’est de « torpiller », la proposition de loi qui devait être déposée dans les jours suivants par le groupe de travail « Protection des animaux ». La lecture des travaux parlementaires révèle en effet que la présidente de ce groupe n’avait pas été tenue au courant de l’initiative et que c’est en vain que les membres du groupe de travail ont tenté d’amender l’amendement pour faire inscrire dans le texte que l’animal devait être placé « dans des conditions conformes aux impératifs de son espèce et assurant leur bientraitance ». Ils n’ont pas été dupes de la manœuvre, dont le seul intérêt était de repousser sine die l’examen de cette proposition de loi[2]. Il semble bien que les lobbys des industriels agro-alimentaires et des agriculteurs n’ont pas été étrangers à cette manœuvre, légitimement inquiétés par la nécessité de placer l’animal dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de son espèce. C’eût été, en effet, au prétexte de lutter contre les excès de l’élevage intensif dénoncés dans des émissions télévisuelles à des heures de grande écoute, faire peser une dangereuse épée de Damoclès sur des pans entiers de l’économie et sur des pratiques régionales ou traditionnelles nombreuses (gavage des oies et des canards, chasse à courre, tauromachie, etc.). Animé du souci politique d’éviter les méfaits d’une règle générale dont on mesure mal les conséquences, l’amendement « Glavany » est-il pour autant rigoureux d’un point de vue juridique ?
Selon une lecture juridique, on pourrait d’abord se demander si l’amendement proposé ne constitue pas un « cavalier législatif » tant la définition juridique de l’animal paraît éloignée du souci de modernisation et de simplification affiché dans le titre de la loi. On remarquera ensuite que la formule initialement retenue par l’amendement « Glavany » s’inspirait très directement des propositions faites par le groupe de travail dirigé par le professeur Hugues Périnet-Marquet, sous l’égide de l’Association Capitant. Mais cela ne suffit pas à emporter la conviction.
D’abord, l’amendement reste encore trop général en ce qu’il affirme que tous les animaux sont des êtres doués de sensibilité. En l’état des données de la science, seuls les vertébrés sont sensibles à la douleur : un moustique, un acarien, une fourmi, etc., ne sont pas doués de sensibilité. On voit donc que le texte pèche par excès de généralité.
Ensuite, l’amendement précise que l’animal est soumis au régime des biens… ce qui sous-entend nécessairement qu’il ne l’est pas. Mais alors qu’est-il ? La même incertitude existe en droit allemand où le Bürgerliches Gesetzbuch dispose que « les animaux ne sont pas des choses ; des lois spéciales les protègent ; il y a lieu de leur appliquer par analogie les règles régissant les choses, sauf dispositions contraires » (art. 90). Si l’on pense, comme le texte y invite, que l’animal n’est pas un bien, les défenseurs de l’amendement qui voulaient garder l’animal dans la sphère des biens sans créer une nouvelle catégorie entre les biens et les personnes en seraient pour leurs frais[3]. Croyant satisfaire les défenseurs de la cause animale tout en conservant la summa divisio personne/bien, l’amendement aboutit au résultat inverse : n’étant ni des biens ni des personnes, les animaux sont autre chose. En réalité, cette formulation ambiguë est le résultat d’une incompréhension. Les défenseurs de la cause animale pensent que qualifier l’animal de « bien » ou de « chose », c’est l’assimiler à une armoire, une table ou une commode. Rien n’est plus faux puisque les biens sont soumis à des régimes juridiques très différents : un immeuble, une voiture, un fonds de commerce, des parts de sociétés… sont des biens… et n’ont pas le même régime juridique. Il y a bien longtemps que le capuchon gris que le droit a jeté sur la diversité des choses, la qualification de bien, s’est déchiré pour laisser place à la diversité des choses ! On aurait donc pu faire l’économie de cette formulation ambiguë et trompeuse. L’animal, puisqu’il peut être approprié, reste un bien.
Enfin, l’amendement est purement descriptif et point prescriptif. Il n’emporte aucune conséquence pratique et reste donc purement idéologique. Conscient que cet amendement ne sera pas perçu comme un point d’arrivée victorieux mais un point de départ ambitieux par les défenseurs de la cause animale, il est cependant à prévoir que l’avenir nous offre de revenir sur le statut juridique de l’animal. Simplement défini pour l’instant, l’animal sera sans doute prochainement doté d’un véritable régime juridique.
Identité et nature des choses : le vendeur d’alevins impayé peut-il revendiquer la propriété des poissons qu’ils sont devenus ? – La revendication d’un bien vendu sous réserve de propriété est possible si le bien se retrouve « en nature » dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 624-16). L’appréciation de l’existence « en nature » est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ont déjà pu retenir des solutions remarquées. Il a ainsi été jugé qu’une cour d’appel avait valablement pu estimer que l’abattage, le dépeçage et le découpage d’animaux arrivés sur pieds dans les locaux d’un abattoir étaient incompatibles avec l’exigence de l’existence en nature des biens revendiqués[4]. Mais, à l’inverse, il a été jugé qu’une cour d’appel n’avait fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en retenant que les marchandises revendiquées (en l’espèce des raisins vendangés) se trouvaient encore en nature dans les caves de la coopérative « dès lors que l’incorporation des moûts les uns aux autres et le processus d’évolution et de vinification des récoltes apportées n’avaient pas transformé leur substance »[5]. L’arrêt commenté porte sur des alevins de poissons, devenus gros.
En l’espèce, entre le 2 avril 2009 et le 28 janvier 2010, une société avait livré à une autre des alevins de daurade royale pour une valeur de plus de 300 000 euros. L’acheteur ayant été mis en redressement le 2 février 2010, le vendeur avait exercé une action en revendication à laquelle il avait été fait droit avec report de l’action sur le prix devant être perçu par l’acquéreur au titre de la vente des daurades devenues adultes. L’acheteur faisait valoir que les alevins s’étaient transformés, de manière irréversible, en un autre bien, dont les propriétés et les caractères étaient différents de ceux du bien vendu, quand bien même cette transformation serait le résultat d’une évolution biologique normale. Dans un arrêt très dense duquel on ne retiendra qu’une partie, la Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.844 002).
Extrait
002 Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.844
« Mais attendu (…) qu’après avoir énoncé qu’il appartient au propriétaire revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d’existence en nature s’entend de la conservation de la marchandise dans son état initial, l’arrêt relève que les alevins livrés entre dix mois et quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective, ont pris du poids, sans que cette prise de poids, en ait modifié la substance ; que l’arrêt relève encore que le cycle de maturation d’un alevin est de l’ordre de dix-huit à vingt-quatre mois et qu’une daurade est commercialisable au poids de 220 grammes, correspondant à dix-huit mois environ de maturation ; (…) ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’a ni inversé la charge de la preuve, ni statué par des motifs contradictoires, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en retenant que la société FMD établissait que les alevins revendiqués, livrés moins de dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure, existaient en nature au jour de cette ouverture »
La décision peut paraître ambiguë, car après avoir posé, de manière générale et comme clé de solution, que la « condition d’existence en nature s’entend de la conservation de la marchandise dans son état initial », la Cour de cassation avalise l’appréciation des juges du fond de laquelle s’évinçait que le cycle de maturation avait eu pour effet de métamorphoser les alevins en daurades commercialisables de plus de 220 grammes. L’état initial de la marchandise semblait alors pour le moins altéré, ce qui n’empêche cependant pas la Cour de cassation de respecter l’analyse souveraine selon laquelle les marchandises revendiquées se retrouvaient « en nature ».
La solution nous paraît signer une certaine conception de l’exigence de l’existence « en nature » de la chose revendiquée. Les choses existent en effet non seulement dans leur substance mais également dans leur forme, laquelle peut résulter de la nature ou de l’activité humaine. En l’espèce, il ne fait nul doute que la substance des dorades adultes était la même que celle des alevins vendus… mais leur forme était différente. La Cour de cassation signe donc la victoire d’une identité substantielle sur une identité formelle.
Examiner l’identité des marchandises en termes de forme ou de fonctionnalités, en s’attachant notamment à la taille et au caractère commercialisable des daurades, aurait inévitablement conduit à admettre la différence entre les marchandises vendues et celles revendiquées. En effet, les alevins, petits et non commercialisables, ont été transformés en dorades adultes, commercialisables du fait de leur poids supérieur aux normes applicables. La prise de poids traduirait donc une transformation, laquelle ne serait d’ailleurs rien d’autre que le fruit des efforts et des soins apportés par l’acheteur à la marchandise.
La Cour retient cependant le critère de l’identité naturelle des poissons : en dépit des soins apportés par l’acheteur, ce sont bien les mêmes poissons qui sont entre ses mains (passant sous silence le débat sur la fongibilité des poissons). L’évolution cellulaire normale subie par les alevins ne pouvait donc être assimilée à une altération susceptible de les avoir transformés en des biens d’une autre nature. De fait, la prise de poids des alevins n’avait pas modifié les alevins de daurade royale dans leur substance. Cette solution avait déjà été retenue par la cour d’appel d’Orléans qui avait admis la revendication de champignons, alors que la marchandise livrée était du mycélium, c’est-à-dire le seul appareil végétatif souterrain et ramifié du champignon. En dépit du changement de forme intervenu, elle avait considéré que la chose revendiquée (les champignons) était de même nature que celle livrée[6]. La solution retenue par la Cour de cassation a finalement le mérite de la simplicité. Elle rompt avec certaines décisions qui, ayant retenu des distinctions qualifiées de byzantines par Derrida, avaient exclu la revendication des poussins vendus à un jour, alors qu’ils avaient plusieurs semaines lors de la revendication, mais l’avait admise pour des poulettes que l’acheteur s’était contenté de maintenir dans l’état de poules pondeuses qu’elles avaient lors de la livraison[7]. Désormais, en dépit des changements de taille et de traits caractéristiques, les juges du fond pourront admettre que les marchandises restent les mêmes.
En guise de conclusion, on émettra une hypothèse fondée sur les différences entre le Code civil et le Code de commerce quant à la revendication de la chose transformée par l’activité de l’acquéreur. Dans le Code civil, les articles consacrés à la clause de réserve de propriété restent silencieux sur la revendication d’un bien transformé par l’activité de l’acquéreur (C. civ., art. 2367 et s.). On peut cependant penser, en faisant référence à la spécification prévue aux articles 570 et suivants, que cette revendication sera possible par le propriétaire de la matière pourvu que le coût de la main-d’œuvre ne dépasse pas la valeur de la matière. Lorsque la revendication sera admise, le revendicateur devra alors indemniser le spécificateur du travail accompli. Dans le Code de commerce, l’action en revendication est soumise à un critère plus précis, suivant lequel la revendication est admise lorsque la chose se retrouve « en nature ». Selon l’interprétation faite de cette exigence, il serait possible d’interdire la revendication dès lors que le travail de l’acquéreur a eu pour effet de transformer la chose qui lui avait été livrée. En adoptant une interprétation stricte, selon laquelle la croissance des poissons n’a pas modifié leur nature, la Cour de cassation admet la revendication et évite que son régime ne soit différent selon que l’acquéreur est in bonis ou en difficulté. Ce souci de conserver une cohérence à l’action en revendication conduit à approuver la solution retenue.
II – Propriété et possession
A – Propriété individuelle
Qualification de l’ouvrage public et application de la loi dans le temps : quelle qualification pour les ouvrages implantés par France Télécom depuis que la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a transféré les biens, droits et actions de la personne morale de droit public France Télécom à une entreprise nationale ? – Lorsqu’un propriétaire est victime d’un empiètement, il est essentiel de savoir si l’ouvrage litigieux est privé ou public. Dans le premier cas, le respect de la propriété privée commandera la destruction de l’ouvrage, fût-ce pour quelques centimètres d’emprise (C. civ., art. 545). La question est bien connue et donne lieu à de nombreuses analyses. Dans le second cas, la considération que l’ouvrage mal implanté est nécessaire au bien public commandera une atténuation de la règle : par application de l’adage « ouvrage public mal implanté ne se détruit pas », la victime ne pourra obtenir que des dommages et intérêts. Même si la force de cet adage a faibli et que les juges administratifs[8] ou civils[9] n’hésitent plus à ordonner, notamment lorsque l’acte est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation n’a été engagée, la destruction de l’ouvrage, la nature de l’ouvrage réalisé est encore importante. L’arrêt commenté précise le moment auquel doit s’apprécier la qualification d’ouvrage public.
En l’espèce, un particulier avait assigné en 1994 la société France Télécom en enlèvement d’une chambre téléphonique et d’un poteau implanté sur sa propriété et en paiement de dommages et intérêts. En cours d’instance, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 (JO 27 juill.) avait transféré les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom à l’entreprise nationale France Télécom et déclaré ces biens relevant du domaine privé. La cour d’appel avait seulement ordonné le paiement de dommages et intérêts pour emprise irrégulière mais n’avait pas ordonné la destruction. Elle avait pour cela considéré que, les installations étant des ouvrages publics lors de l’introduction de l’instance, le litige devait être examiné au regard de ce seul caractère. La décision est cassée au visa de l’article 2 du Code civil et de la loi de 1996 : « en statuant ainsi, alors que par l’effet de la loi du 26 juillet 1996 ces installations avaient perdu leur caractère d’ouvrages publics, la cour d’appel, qui a constaté qu’elles empiétaient sur la propriété de M. X..., a violé les textes susvisés » (Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-10.404).
La solution est une exacte application du principe de l’effet immédiat de la loi et de ses exceptions : si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut en revanche remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date[10]. Or, en l’espèce, France Télécom ne pouvait se prévaloir d’aucune situation régulière puisque, justement, l’implantation des ouvrages avait empiété sur le fonds du particulier. De fait, la loi nouvelle de 1996, métamorphosant les ouvrages publics ou ouvrages privés, restait applicable. La juridiction de renvoi aura donc à dire, selon les règles du droit privé de l’empiètement, si les conditions qui permettent de poursuivre la destruction de l’ouvrage sont remplies. Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, la chose ne fait guère de doute…
Les troubles anormaux du voisinage et l’article 1382 du Code civil. – Les troubles anormaux du voisinage se sont émancipés de la responsabilité civile avec pour conséquence que la preuve d’une faute n’est pas nécessaire[11]. Mais cette émancipation est-elle à ce point tranchée que l’on ne puisse pas invoquer les troubles anormaux du voisinage lorsqu’un texte fait référence à l’article 1382 du Code civil. C’est la question que pose l’arrêt commenté, à propos de l’application de l’article L. 426-4 du Code de l’environnement. Ce texte dispose que « la possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1382 du Code civil ».
En l’espèce, se plaignant de dégâts causés à ses récoltes et cultures, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) avait assigné une association de chasse en indemnisation du préjudice subi. Elle avait fondé sa demande sur les troubles anormaux du voisinage. La cour d’appel avait fait droit à sa demande et dit que le régime spécial d’indemnisation organisé par le Code de l’environnement s’appliquait à toute action en réparation des dommages de toute nature, notamment celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et ne comportait pas d’exclusion des actions fondées sur l’article 544 du même code et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle avait ensuite caractérisé les inconvénients anormaux du voisinage subis par la SCEA : « mettre à la disposition du gibier certaines quantités de nourriture a pour effet de fixer les populations d’animaux sauvages sur le territoire concerné et de favoriser leur reproduction ; cette pratique entraîne une prolifération du gibier, en l’espèce, non compensée par la mise en œuvre d’actions de régulation ; (…) ; que cette situation, liée à l’exercice du droit de chasse par l’association sur les terres voisines de celles de la société provoque pour celle-ci des inconvénients anormaux de voisinage lui ouvrant droit à une indemnisation correspondant aux dommages subis ». Son arrêt est sèchement cassé au visa des articles 1382 du Code civil et L. 426-1à 4 du Code de l’environnement : « en statuant ainsi, sans relever une faute de nature à engager la responsabilité de l’association sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-18.136).
L’arrêt a au moins un précédent jurisprudentiel qui révèle la tendance de la Cour de préserver l’originalité du régime spécial d’indemnisation et d’éviter que ses digues ne craquent sous les assauts du droit commun. Ainsi, un arrêt rendu en 2012 avait cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait admis que, déboutée sur le terrain de l’article 1382 du Code civil pour n’avoir pas intenté l’action dans les six mois du dommage (C. env., art. L. 426-7), la victime soit néanmoins recevable à faire valoir une indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage[12].
Si la solution n’est donc pas entièrement nouvelle, elle peut néanmoins être interprétée de différentes façons.
On pourrait d’abord penser que la Cour de cassation dessine un nette ligne de démarcation entre la responsabilité civile de l’article 1382 et la réparation des troubles anormaux du voisinage. En l’occurrence, en ne laissant survivre contre l’auteur du dommage que les actions fondées sur l’article 1382 du Code civil, l’article L. 426-4 du Code de l’environnement aurait incidemment exclu toute action fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Cette interprétation pourrait évidemment se justifier par le mouvement d’autonomisation de la théorie des troubles du voisinage et la tentation de les faire reposer sur le fondement de la propriété plus que sur celui de la responsabilité[13]. Il nous semble cependant que cette interprétation pécherait par un excès de légalisme : comme tous les principes généraux du droit, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage a une portée générale et s’applique indépendamment des articles du droit positif. Dans ces conditions, le fait que l’article L. 426-4 du Code de l’environnement permette à un propriétaire d’intenter une action fondée sur l’article 1382 ne devrait pas suffire à exclure la possibilité d’une action fondée sur un principe général du droit. Il nous semble donc inutile de s’emparer de cet arrêt pour exhumer le débat sur les fondements de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Cette interprétation serait d’autant plus excessive qu’elle méconnaîtrait en outre les termes employés par la Cour.
L’arrêt d’appel n’est en effet pas cassé pour avoir admis une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage mais pour n’avoir pas relevé de faute de nature à engager la responsabilité de l’association de chasse sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. C’est donc dire que l’action, quoique fondée sur les troubles anormaux du voisinage, aurait été recevable si la faute avait été prouvée. Il nous semble donc que, loin de tracer une ligne de démarcation entre responsabilité civile et propriété, l’arrêt sous-entend que l’action en indemnisation des troubles anormaux du voisinage pourrait encore s’abriter, comme ce fut longtemps le cas, sous le fondement de l’article 1382 du Code civil. En d’autres termes, si le trouble peut être constitué sans qu’il y ait de faute[14], il peut tout aussi bien être constitué en présence de faute. On mesure alors que les frontières entre la responsabilité civile et les troubles anormaux du voisinage ne sont donc pas aussi étanches qu’on le croit.
B – Indivision
La mise en demeure de payer les loyers visant la clause résolutoire est un acte conservatoire pouvant être délivré par un seul indivisaire. – Lorsqu’un immeuble est en indivision, le commandement de payer les loyers délivré au locataire est-il un acte conservatoire ou un acte d’administration ? Dans le premier cas, il pourra être délivré par un indivisaire seul (C. civ., art. 815-2) ; dans le second, il faudra l’accord des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis (C. civ., art. 815-3). La jurisprudence distinguait, pour répondre à cette question, selon que le commandement de payer annonçait ou non la fin du bail : si le commandement ne visait pas la clause résolutoire, il était considéré comme un acte conservatoire puisque la mise en demeure de payer était alors perçue comme un simple acte visant à faire entrer les loyers dans le patrimoine des bailleurs sans que, du non-paiement des loyers, découle automatiquement la résiliation du bail[15] ; en revanche, si le commandement visait la clause résolutoire, il était considéré comme un acte d’administration en ce qu’il annonçait la fin probable du bail[16]. Tout comme un refus de renouvellement ou un congé, il devait donc être délivré par tous les indivisaires ou à une majorité qualifiée. Cette distinction se justifiait par les finalités de l’acte conservatoire, rappelées par le professeur Claude Brenner : « Par essence, l’acte conservatoire a pour finalité la sauvegarde des richesses patrimoniales. Plus précisément, il vise à empêcher que les attributs, qualités et caractéristiques matérielles et juridiques qui donnent aux biens leur valeur économique ne disparaissent. Mais parce que cette finalité ne se conçoit pas en l’absence d’un risque de perte ou de disparition préexistant et implique une parfaite adaptation de la réaction salvatrice au péril, l’acte conservatoire est en même temps conditionné, dans son existence, ses formes et son intensité, par la menace qu’il combat »[17]. La menace et l’urgence semblaient donc consubstantielles à l’acte conservatoire.
C’est cet équilibre que vient de rompre la Cour de cassation. Elle a en effet jugé que : « mais attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-21.463 003). La solution n’est, à vrai dire, pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été retenue quelques mois auparavant dans un arrêt resté inédit[18]. Elle nous semble doublement justifiée.
Extrait
003 Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-21.463
« Mais attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis »
D’abord, l’article 815-3 du Code civil impose une majorité qualifiée pour la seule conclusion du bail. Or, le paiement du loyer par le locataire ne relève pas de la conclusion du bail, mais de son exécution. L’article 815-3 du Code civil n’est alors d’aucun secours. Comme l’écrit notre collègue William Dross, « il y a quelque chose d’excessif à exiger que l’acte soit régulièrement conclu à telle condition de majorité et à réitérer l’exigence pour ce qui touche à son exécution »[19].
Ensuite, la Cour de cassation avait fait une lecture étroite de l’article 815-2 du Code civil en considérant que ce texte ne pouvait être appliqué qu’en cas d’urgence. Elle avait ainsi retenu que « les mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis, que l’article 815-2 permet à tout indivisaire de prendre seul, s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des autres indivisaires »[20]. Or, la réforme de 2006 a entendu briser cette jurisprudence en précisant que tout indivisaire peut désormais prendre des mesures conservatoires, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Cette suppression de la condition d’urgence impliquait nécessairement une extension du domaine des actes conservatoires. Certains auteurs écrivaient ainsi qu’il « est fort à parier que la demande en résolution du bail, à défaut d’urgence, sera aussi qualifiée d’acte conservatoire dans un avenir proche »[21]. Cette prévision doctrinale sera sans doute confirmée sous peu tant la mise en demeure visant la clause résolutoire est proche de la demande en résolution du bail.
L’indemnisation des dépenses nécessaires de l’indivisaire. – Lorsqu’un indivisaire a amélioré avec ses propres deniers le bien indivis, il se produit un transfert de valeur de l’individu vers le groupe. Il est naturel que ce transfert soit compensé afin d’éviter l’enrichissement du groupe au détriment de l’indivisaire. Plusieurs mécanismes classiques du droit civil auraient pu être sollicités à cet effet : constructions sur le terrain d’autrui, théorie des impenses, etc. L’article 815-13 du Code civil pose cependant une règle dérogatoire, parfois qualifiée de plus impressionniste que ces autres notions éprouvées[22] : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Le texte distingue donc entre deux types de dépenses : les dépenses facultatives faites pour l’amélioration du bien indivis donnent droit à une indemnité fixée selon l’équité, eu égard à l’augmentation de valeur procurée par la dépense ; en revanche, les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis donnent lieu à une indemnité fixée en fonction de la dépense faite, sans tenir compte de l’éventuelle plus-value.
Cet agencement textuel a cependant été singulièrement malmené par la Cour de cassation. Opérant un rapprochement avec l’article 1469 du Code civil relatif aux récompenses, la Cour avait ainsi revalorisé l’indemnité de remboursement des dépenses nécessaires en tenant compte de la plus-value prise par le bien au jour du partage : « lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage »[23]. Le parallèle avec les récompenses avait ensuite été accru par le fait que la Cour avait jugé que, pour une dépense conservatoire, l’indemnité devait prendre en considération la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite [24]. En dépit de ce rapprochement quant à la fixation du montant de l’indemnité, la Cour de cassation avait récemment clairement distingué entre la récompense due par la masse commune et l’indemnité due par l’indivision. Dans un arrêt de mai 2012, la première chambre civile avait en effet nettement évincé la technique des récompenses au profit de celle des créances sur indivision pour trancher le cas de l’indemnité due en cas d’indivision post-communautaire[25]. Comme l’avait alors noté le président Vareille, « avant la dissolution de la communauté, récompense ; après la dissolution, créance sur l’indivision ». Mais, dans cette décision, la Cour avait tout de même maintenu le principe selon lequel l’indemnité devait être fixée à la valeur la plus haute entre le profit subsistant et la dépense faite.
L’arrêt commenté rompt avec cette solution. En l’espèce, l’époux avait supporté seul le remboursement de l’emprunt ayant financé l’immeuble indivis à hauteur de 37 652 euros (soit 55 % de la valeur d’acquisition). Il réclamait donc, en application du texte, une indemnité de 155 736 euros correspondant à 55 % de la valeur actuelle de l’immeuble. Les juges du fond avaient cependant limité l’indemnité à 70 000 euros. Le pourvoi de l’époux est rejeté (Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197 004).
Extrait
004 Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197
« qu’après avoir constaté que M. X... avait remboursé seul pendant l’indivision post-communautaire les emprunts contractés pour l’acquisition de l’immeuble, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 815-13 du Code civil, a fixé, selon l’équité, l’indemnité due de ce chef par l’indivision à M. X..., à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant »
On relèvera d’abord que le remboursement de l’emprunt par un indivisaire seul est analysé comme une dépense conservatoire, selon l’idée que la cessation du remboursement exposerait les indivisaires à une saisie[26].
On relèvera ensuite que la Cour de cassation rompt avec la solution dégagée le 4 mars 1986, selon laquelle l’indemnité devait être égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Alors que le mari invoquait dans son pourvoi ces solutions antérieures, la Cour renvoie au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond en la matière[27]. Elle retrouve ici l’esprit de la loi puisque les débats parlementaires indiquaient clairement que le correctif « selon l’équité » avait pour but d’éviter qu’une revalorisation systématique n’aboutisse à créer une charge trop lourde pour l’indivision[28].
III – Les droits réels
Source des servitudes : l’absence de tierce opposition ? – On distingue généralement différentes sources aux servitudes : les servitudes naturelles découlant de la situation des lieux, les servitudes légales, les servitudes conventionnelles et les servitudes judiciaires[29]. L’arrêt signalé se situe à la frontière du droit des biens et de la procédure civile. Si la servitude n’y naît pas, à proprement parler, d’une décision judiciaire, on peut considérer qu’elle se consolide du fait du comportement adopté par un plaideur, en l’espèce une abstention.
Par une décision devenue irrévocable, un arrêt de 2009 avait confirmé l’existence d’une servitude au profit d’un fonds appartenant à une société civile immobilière (SCI) et avait considéré que la servitude passait sur le fonds de l’autre plaideur et sur le fonds d’un propriétaire voisin, M. Y, qui n’était cependant pas représenté à l’instance. La SCI avait alors fait signifier cet arrêt au propriétaire non représenté, qui l’avait lui-même assigné, dans une autre instance, afin de lui interdire de passer sur son terrain. Dans le cadre de cette seconde instance, la cour d’appel avait considéré que l’arrêt de 2009 revêtait l’autorité de la chose jugée à l’égard des époux Y qui n’y étaient pourtant pas représentés : elle avait donc retenu le même tracé que celui qui avait été retenu par l’arrêt de 2009. La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux Y (Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.970 005).
Extrait
005 Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.970
« Mais attendu qu’ayant relevé que la SCI avait fait signifier l’arrêt du 16 avril 2009 à M. et Mme Y... qui, bien qu’informés par l’acte de signification de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois en vertu des articles 582 et suivants du Code de procédure civile, n’avaient pas exercé ce recours dans le délai imparti, alors que, s’ils contestaient l’existence de la servitude de passage, ils auraient eu intérêt à l’exercer, l’assiette de la servitude reconnue par l’arrêt pouvant grever en partie leur parcelle, c’est sans méconnaître l’article 1351 du Code civil et les articles 582 et 583 du Code de procédure civile que, tirant les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a décidé que l’existence de la servitude de passage était définitivement consacrée par un arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée qui était opposable à M. et Mme Y »
Si l’on comprend bien le sens de l’arrêt, la Cour de cassation déduit l’existence de la servitude consacrée par un arrêt revêtu de la chose jugée de l’abstention des époux Y à faire une tierce opposition, à laquelle ils auraient eu intérêt s’ils entendaient contester l’assiette de la servitude. Cette solution aboutit à dire que l’arrêt initial a l’autorité de la chose jugée à l’égard des époux Y, qui n’y étaient pourtant pas représentés.
La solution peut être justifiée. L’article 582, alinéa 2, du Code de procédure civile disposant que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, on peut en déduire que l’absence de tierce opposition a pour effet de renforcer les points de la décision non critiqués. C’est la solution traditionnellement retenue : chacun des points non discutés par le tiers opposant est considéré comme définitivement acquis à son encontre et ne peut plus être critiqué par la voie de la tierce opposition[30].
De même, si la tierce opposition est rejetée, la décision attaquée produit tous ses effets à l’égard du tiers opposant et l’autorité de la chose jugée qui y est alors attachée s’oppose à ce que ce dernier le conteste à nouveau[31]. Il en va de même quand la tierce opposition n’est pas exercée.
Revenant sur le terrain du droit des biens, il ne faudrait cependant pas penser qu’il y a là une nouvelle source aux servitudes. L’arrêt d’appel avait en effet pris le soin de préciser que la servitude litigieuse avait été acquise par destination du père de famille. Ce ne sont que les détours de sa contestation judiciaire qui ont conféré ce rôle à l’absence de tierce opposition. Quoi qu’il en soit, en pratique, les propriétaires sauront désormais les conséquences qui s’attachent à un défaut de tierce opposition lorsque leur seront signifiées des décisions de justice reconnaissant l’existence de servitudes sur leur terrain.
Jean-Baptiste Seube
[1] Dr. & patr. 2014, n° 237, p. 90, nos obs.
[2] V. l’intervention de Mme Laurence Abeille lors de la séance du 17 septembre 2014 : « L’amendement “Glavany” a été voté avant que le groupe d’étude “Protection des animaux” ait pu déposer la proposition de loi relative au statut juridique particulier de l’animal, qu’il préparait depuis des mois. Il est désormais fort à craindre que ce texte, déposé en avril 2014, ne vienne jamais en débat, la question animale étant abordée au détour de textes plus généraux ».
[3] Par exemple, Mme Colette Capdevielle, Rapport devant l’Assemblée nationale enregistré le 17 septembre 2014 : « Le présent article consacre l’animal, en tant que tel, dans le Code civil afin de mieux concilier la nécessité de qualifier juridiquement l’animal et sa qualité d’être sensible, sans pour autant en faire une catégorie juridique nouvelle entre les personnes et les biens ».
[4] Cass. com., 22 mars 1994, n° 92-11.223, D. 1996, somm., p. 219, obs. F. Pérochon ; RJDA 7/1994, n° 864.
[5] Cass. com., 11 juill. 2006, n° 05-13.103, D. 2006, p. 2462, obs. A. Lienhard, Actualité proc. coll. 2006, n° 16, obs. F. Pérochon, JCP E 2007, 1013, n° 13, obs. M. Cabrillac, RTD. civ. 2006, p. 794, obs. T. Revet, RTD com. 2007, p. 453, obs. A. Martin-Serf.
[6] CA Orléans, 25 oct. 2007, RJDA 2008/1, n° 68.
[7] CA Rennes, 12 sept. 1984, D. 1986, I.R., p. 173, obs. F. Derrida.
[8] CE, 29 janv. 2003, JCP G 2003, I, 172, n° 1, obs. H. Périnet-Marquet ; rappr. J. Dufau, L’ouvrage public mal implanté peut être détruit désormais, JCP A 2002, 1163.
[9] Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-14.148, JCP G 2003, I, 172, n° 1, obs. H. Périnet-Marquet, D. 2003, p. 1932, note S. Petit, RD imm. 2003, p. 571, obs. M. Bruschi.
[10] Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-12.904, D. 2009, p. 1599, note C. Manara.
[11] Sur cette évolution, J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cimamonti, Les biens, LGDJ, 2e éd., 2010, nos 109 et s. ; W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, nos 74 et s. ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, Defrénois, 5e éd., 2013, nos 1070 et s. ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, Dalloz, 5e éd., 2014, nos 351 et s. ; F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Dalloz, 8e éd., 2010, nos 321 et s.
[12] Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.538, D. 2013, p. 17.
[13] V. les références doctrinales précitées.
[14] Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-16303, JCP G 2004, I, 125, obs. H. Périnet-Marquet, D. 2004, p. 2467, obs. B. Mallet-Bricout.
[15] Par exemple Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n° 90-16.340, Bull. civ. III, n° 258 ; Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-17.010, Bull. civ. III, n° 158, JCP G 2000, I, 211, n° 2, obs. H. Périnet-Marquet, JCP G 2000, I, 278, n° 4, obs. R. Le Guidec, RD imm. 1999, p. 619, obs. M. Bruschi, RTD. civ. 2000, p. 607, obs. J. Patarin ; Cass. 3e civ., 31 oct. 2007, n° 06-18.338, JCP G 2007, I, 127, n° 10, obs. H. Périnet-Marquet.
[16] Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-21447, Bull. civ. III, n° 157.
[17] Cl. Brenner, Rép. civ. Dalloz, V° Acte juridique, mars 2014, n° 246.
[18] Cass. 3e civ., 4 févr. 2014, n° 12-13.653.
[19] W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, n° 189-3.
[20] Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 80-15.132, RTD civ. 1984, p. 133, obs. J. Patarin ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 01-10.639, Bull. civ. I, n° 241, JCP G 2004, I, 125, n° 5, obs. H. Périnet-Marquet, Dr. famille 2004, comm. n° 25, obs. B. Beignier, RD imm. 2004, p. 278, obs. M. Bruschi ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-19.185.
[21] N. Reboul-Maupin, Droit des biens, Dalloz, 5e éd., 2014, n° 674.
[22] W. Dross, Les choses, précité, n° 183.
[23] Cass. 1re civ., 18 oct. 1983, D. 1984, p. 289, note D. Rambure, JCP 1984, II, 20245, note E. S. de la Marnierre, RTD civ. 1984, p. 750, obs. J. Patarin.
[24] Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15.071, Bull. civ. I, n° 51, D. 1987, somm., p. 45, obs. A. Bénabent, JCP G 1986, II, 20701, note Ph. Simler, RTD civ. 1987, p. 386, obs. J. Patarin : « pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu’il a faite et le profit subsistant ».
[25] Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n° 11-17.497, D. 2012, p. 1330, AJ famille 2012, p. 414, note P. Hilt, RTD. civ. 2012, p. 561, obs. B. Vareille.
[26] V. déjà, Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-11.524, D. 2006, p. 1913, JCP G 2006, I, 193, n° 23, obs. A. Tisserand-Martin.
[27] V. déjà, reconnaissant au juge la possibilité de modérer l’indemnité qui lui semblerait inéquitable, Cass. 1re civ., 7 juin 1988, n° 86-15.090, D. 1989, p. 141, note A. Breton, RTD civ. 1989, p. 120, obs. J. Patarin, et p. 779, obs. F. Zénati, Defrénois 1988, p. 1079, note G. Morin.
[28] Sur ce point, F. Terré et Ph. Simler, Les biens, précité, n° 591.
[29] Sur cette présentation, v. F. Terré et Ph. Simler, Les biens, précité, n° 878 ; N. Reboul-Maupin, Droit des biens, Dalloz, 5e éd., 2014, nos 592 et s.
[30] Cass. 1re civ., 21 nov. 2001, Bull. civ. I, n° 300.
[31] Cass. 3e civ., 6 févr. 1974, Bull. civ. III, n° 67 ; Cass. com., 29 nov. 1982, Bull. civ. IV, n° 380.
Par Jean-Baptiste Seube, Professeur à l’Université de la Réunion, Doyen honoraire de la faculté de droit et d’économie
Paru in Dr. & Patr. 2015, n° 243, p. 66 (janv. 2015), Chronique de jurisprudence et de législation Droit des biens