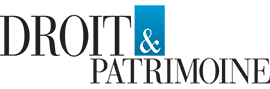CHRONIQUE DE DROIT DU PATRIMOINE FAMILIAL - NOVEMBRE 2023 – NOVEMBRE 2024
Au cours de la période, la Cour de cassation a apporté des solutions certaines sur des questions SUSCITANT la discussion. C’est le cas de l’amélioration d’un bien par l’industrie personnelle d’un époux, qui constitue un acquêt dans le régime de la participation aux acquêts. Elle doit donc être prise en compte dans le droit à participation. Ensuite, c’est la prescription qui a donné lieu à des éclaircissements. Il est désormais acquis que l’action en délivrance des legs est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription décennale de l’option. Ensuite, l’articulation des délais de prescription de l’action en réduction a été précisée, encore qu’il n’existait pas de grands doutes à son sujet. Par principe, l’action en réduction se prescrit par cinq ans et, subsidiairement, par deux ans dans l’hypothèse où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve plus de cinq ans après le décès.
I – Régimes matrimoniaux
A – En régime de participation
aux acquêts, l’amélioration apportée
au bien par l’industrie personnelle
d’un époux constitue un acquêt
Le régime de la participation aux acquêts ne ressemble à aucun des deux autres types de régime matrimonial connu du droit français (communauté et séparation de biens). Il se caractérise par la volonté d’un époux de faire participer l’autre à son propre enrichissement. À cette fin, nulle mise en commun de biens, ni en nature ni en valeur. Il consiste à déterminer l’enrichissement de chaque époux en cours de mariage, ce qui implique de mettre en évidence ce qui a été acquis en cours d’union (l’acquêt). Et c’est alors que le conjoint qui a moins profité du mariage est intéressé à la réussite de l’autre. La première tâche est de mettre au jour les acquêts réalisés par chaque époux en cours de mariage : de quoi s'est-il enrichi en cours d’union ? Cela suppose de comparer le patrimoine au moment du mariage (patrimoine originaire) et le patrimoine à la dissolution du mariage (patrimoine final). Ainsi, les biens acquis en cours de mariage sont évidemment pris en compte dans la détermination de l’enrichissement respectif des époux. Mais en est-il de même en présence de l’amélioration d’un bien ? Faut-il distinguer selon que l’amélioration provienne ou non de l’industrie personnelle de l’époux ?
Une épouse mariée sous le régime de la participation aux acquêts exploite, dès avant son mariage une pharmacie. À l’occasion du divorce, une discussion naît sur la valeur de la pharmacie. Elle s’est en effet accrue entre le début du mariage et sa dissolution, à la faveur de l’activité déployée par l’épouse pharmacienne. Toute la question était de savoir s’il fallait tenir compte de la plus-value du bien au motif qu’elle ne provenait pas d’un investissement financier mais de l’ensemble du travail déployé par l’épouse. Cette affaire était déjà connue de la Cour de cassation , puisqu’elle lui avait donné l’occasion d’affirmer que la clause d’exclusion des biens professionnels, stipulée dans le contrat de mariage, constituait un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du mariage et révoqué en cas de divorce, suscitant l’attention de la doctrine. Dans l’arrêt de 2019, la Haute juridiction avait prononcé la cassation avec renvoi. La cour d’appel de renvoi avait donc pris en compte les biens professionnels pour la liquidation de la créance de participation. Mais la difficulté n’a fait que rebondir, puisqu’il fallait déterminer pour quelle valeur les biens professionnels devaient être considérés et si les améliorations réalisées grâce à l’industrie personnelle de l’épouse devaient être intégrées au calcul en tant qu’acquêts.
Solution. Par un arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation considère que l’amélioration d’un bien doit être prise en considération en tant qu’elle est un acquêt et participe de l’enrichissement de l’époux. Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la plus-value du bien est issue de l’industrie personnelle ou d’un investissement financier. Dès lors, la pharmacie devait être estimée dans le patrimoine originaire au jour de la dissolution, mais selon son état au jour du mariage et, dans le patrimoine final, selon son état au jour de la dissolution, donc en tenant compte des améliorations apportées. Ainsi, la plus-value de la pharmacie constitue un acquêt net de l’épouse propriétaire participant de son enrichissement et devant être décomptée dans la liquidation de la créance de participation.
L’important n’est pas tant que la Cour de cassation dise qu’il faut tenir compte de la plus-value mais qu’elle affirme que son origine est indifférente et qu’elle doit être prise en compte dans tous les cas.
La cour d’appel avait estimé que la plus-value de la pharmacie devait être évincée du calcul, parce qu’elle résultait de l’activité professionnelle de l’épouse, et non d'un investissement financier. Elle étendait ainsi à la participation aux acquêts une distinction bien connue en communauté. Dans ce régime, la jurisprudence estime que sont des faits générateurs de récompenses les plus-values dues à des circonstances économiques fortuites et celles dues à des investissements financiers. En revanche, l’industrie personnelle ne peut pas faire naître un droit à récompense. En effet, la jurisprudence estime que cela peut être le cas seulement si un époux a tiré profit de la communauté, ce qui se concrétise par une dépense, un investissement, une somme empruntée, nous dit l’article 1437 du code civil, autrement dit un appauvrissement effectif de la communauté. Or, l’industrie personnelle n’appauvrit pas la communauté, puisque si elle n’avait pas été déployée, la communauté n’en aurait pas été modifiée . Transposant cette solution à la participation aux acquêts, la cour d’appel considère que la plus-value issue de l’industrie personnelle ne peut pas entrer en compte pour le calcul de la créance de participation.
Explication. Avec justesse, la Cour de cassation délaisse cette distinction estimant qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la source de la plus-value. Un premier argument tient au fait que la distinction ne figure dans aucun des textes relatifs à la participation aux acquêts. Mais un tel fondement demeure fragile, car le texte relatif aux récompenses n’évoque pas expressément la distinction entre l’industrie personnelle et les autres types de plus-value. C’est seulement par interprétation de l’article 1437 du code civil que l’on en déduit l’exigence d’un appauvrissement financier.
Un second argument justifie la solution de manière beaucoup plus pertinente, en ce qu’il s’attache à la raison d’être de chaque régime. Rappelons que la logique de la participation aux acquêts est d’instaurer un intéressement mutuel des époux à la réussite de l’autre. À cette fin, il faut déterminer la richesse de chacun par la mise en évidence de tout ce qui a été acquis en cours de mariage, de ces acquêts qui ont permis l’accroissement de son patrimoine. Aucune distinction n’est à faire s’agissant de l’enrichissement, d’autant qu’il est purement objectif, comme résultant de la simple comparaison entre le patrimoine au moment du mariage et à la dissolution du mariage. Nulle autre considération n’entre en ligne de compte. Toute la logique de ce régime matrimonial est d’identifier l’ensemble des acquêts de chaque époux, afin d’en faire profiter le conjoint qui s’est le moins enrichi. Dès lors, il n’y aucune raison d’exclure certaines plus-values en raison de leur origine. C’est même tout le contraire : il faut toutes les inclure pour apprécier plus exactement l’enrichissement de chacun.
En cela, il existe une différence majeure avec le régime de communauté. Dans ce régime, la distinction selon l’origine des plus-values s’inscrit dans la détermination des récompenses qui seraient dues à la communauté. La fonction de la récompense est de rétablir les patrimoines, de restituer à chaque masse de biens (biens communs et biens propres) son intégrité, pour éviter que l’une ne tire profit de l’autre, pour éviter que l’une ne s’enrichisse au détriment de l’autre. Or, dans la participation aux acquêts, c’est la logique exactement inverse qui est à l’œuvre : par le droit à participation, on veut qu’un époux profite de l’enrichissement de l’autre. Le droit à participation vise l’intéressement, alors que la récompense a pour fin la protection de chaque patrimoine. Elle tend à assurer l’intégrité de chaque masse de biens de telle sorte qu’elle soit rétablie dans l’état qui aurait été le sien si l’autre masse n’en avait tiré profit. Ce rééquilibrage suppose de mettre en évidence le fait qu’une masse a procuré quelque chose à l’autre. Et cet avantage consiste, nous dit la jurisprudence, dans l’emprunt d’une valeur.
L’analogie avec la communauté était inexacte en l’espèce, car ce mode de raisonnement suppose d’avoir des éléments comparables ; or la fonction de la récompense et du droit à participation n’est pas la même.
Évaluation. Une fois affirmée la prise en compte de toute plus-value en dépit de son origine, il faut encore en tirer les conséquences sur un plan liquidatif. S’agissant d’un bien dont l’époux était propriétaire à son mariage, le bien doit figurer dans son patrimoine originaire pour sa valeur à la dissolution selon son état au jour du mariage. Le bien figure aussi dans le patrimoine final pour sa valeur à la dissolution selon son état à cette même date. La plus-value est ainsi prise en compte. Pour la neutraliser, il aurait fallu ne la faire figurer ni dans le patrimoine originaire ni dans le patrimoine final. Dans ce cas, le bien aurait été évalué dans le patrimoine originaire pour sa valeur à la dissolution selon son état au jour du mariage et dans le patrimoine final pour sa valeur à la dissolution selon son état au jour du mariage. L’identité de la date pour apprécier l’état neutralise la plus-value. On aurait pu aussi bien la mentionner dans les deux patrimoines. Le bien aurait alors figuré dans le patrimoine originaire pour sa valeur à la dissolution selon état au jour de la dissolution et dans le patrimoine final pour sa valeur à la dissolution selon son état au jour de la dissolution.
Autonomie de la participation aux acquêts. Observons aussi que l’arrêt du 13 décembre 2023 marque l’autonomie de la participation aux acquêts à l’égard de la communauté. La cour d’appel avait retenu sa solution en se référant directement à ce qui valait pour la communauté. Il n’y a rien d’étonnant à cela tant il est courant de dire que la participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens et se liquide comme une communauté, expliquant que la cour d’appel s’y soit référée pour liquider la créance de participation. Ce régime est aussi décrit comme une communauté en valeur ou une communauté différée. On ne saurait trop déplorer de tels rapprochements. On oublie ce qu’est véritablement la participation aux acquêts : un régime à part entière, autonome, ni communauté, ni séparation, autre chose. C’est en assumant pleinement la spécificité et l’autonomie de la participation aux acquêts que son régime juridique se laisse comprendre et s’épanouit pleinement .
Le propre du régime de la participation aux acquêts est de n’emporter la formation d’aucune communauté en nature, pas plus qu’elle n’en réalise en valeur. Pour autant, elle n’est pas fondée sur une indépendance patrimoniale, puisqu’elle instaure une participation et c’est bien ce qui en fait l’originalité. Les acquêts ne sont pas mis en commun ; ils sont pris en considération pour mettre au jour l’enrichissement d’un époux en cours de mariage, afin d’en faire profiter l’autre. Chaque époux associe l’autre à son enrichissement personnel. Il y a bien une « intention participative » , un intéressement mutuel à la réussite de l’autre, qui se traduit par une créance et non un droit au partage d’un bien. La participation se fait exclusivement en valeur, sans que cela ne passe en principe par l’attribution de biens.
En prolongeant la réflexion, faut-il considérer que la solution adoptée par l’arrêt du 13 décembre 2023 est de nature à remettre en cause celle valant pour la communauté ? D’abord, il faut reconnaître que l’industrie personnelle dans la communauté fait l’objet d’un statut isolé, puisqu’elle est prise en compte dans la séparation de biens sous la forme d’une créance entre époux et dans la participation aux acquêts en tant que composante de l’enrichissement. Faut-il dès lors unifier le régime de l’industrie personnelle ? Peut-être, mais certainement pas au motif d’une unification des régimes matrimoniaux. Si l’autonomie de la communauté et de la participation aux acquêts conduit à ce que les solutions de la communauté n’ont pas vocation à être étendues à la participation aux acquêts, la réciproque est tout aussi vrai : les solutions de la participation aux acquêts n’ont pas vocation à être étendues à la communauté. Par conséquent, si une modification du régime de l’industrie personnelle doit être envisagée en communauté, c’est uniquement parce qu’elle souffrirait de vices internes au régime et non parce que la solution est telle en participation aux acquêts.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2023, n° 21‑25554 (extraits)
Vu les articles 1569, 1571 et 1574 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
9. Selon les deux textes suivants, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition pour les biens originaires et d’après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.
10. Il en résulte que lorsque l’état d’un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire.
11. Pour dire que la valeur de l’officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de Mme [T], l’arrêt, après avoir constaté que la plus-value de l’officine de pharmacie de Mme [T] résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d’investissements de fonds, énonce que si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts, les plus-values résultant de l’industrie personnelle d’un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompenses. Il en déduit qu’il ne doit pas être tenu compte de la plus-value de l’officine de pharmacie de Mme [T] dans le calcul de la créance de participation.
12. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que, par son industrie personnelle, Mme [T] avait amélioré l’état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel a violé les textes susvisés
B – La clause de préciput est un avantage matrimonial non soumis à la taxation au droit de partage
En l’espace de cinq mois, deux décisions de cours d’appel apportent des solutions radicalement contradictoires à la question de savoir si le préciput est une opération assujettie au droit de partage. L’une répond négativement et l’autre estime que le préciput est une opération de partage taxée au droit de partage . Mais ces atermoiements pourraient connaître une solution unificatrice dans les prochains mois. Alors qu’elle était saisie d’une contestation relative à une proposition de rectification de l’administration fiscale tendant à soumettre le préciput à un droit de partage, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité, par un arrêt du 16 octobre 2024 , l’avis de la première chambre civile sur la question de savoir si le préciput « effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage » .
En attendant, rappelons que le préciput est une clause stipulée dans un régime de communauté, en vertu de laquelle un époux peut, en cas de dissolution du mariage par décès, prélever un bien commun avant tout partage . Depuis quelques années, une discussion est apparue sur le fait de savoir si la transmission par préciput était assujettie au droit de partage. En présence d’une mutation patrimoniale, l’administration fiscale est encline à opérer une taxation. Reste à en trouver le bon fondement. Celui des droits de mutation à titre gratuit est fermé, puisque l’article 1516 du code civil dispose que le préciput n’est pas une donation. La seule voie qui demeure envisageable pour une taxation est celle du droit de partage, conduisant l’administration fiscale à voir dans le préciput une opération de partage relevant de l’article 746 du CGI, taxée au droit de partage . Une telle analyse doit pourtant être résolument rejetée pour plusieurs raisons.
1°/ L’article 1515 du code civil ne qualifie pas le préciput d’opération de partage à la différence du prélèvement moyennant indemnité . Plus encore, le texte précise que le préciput opère avant tout partage. La cour d’appel de Grenoble estime pourtant que la mention « avant tout partage » ne suffit pas à elle seule à exclure la qualification de partage, d’autant que, selon elle, le mécanisme du préciput et du prélèvement sont identiques . Pourtant, il serait curieux d’inclure le préciput dans les opérations de partage, alors que l’article 1515 dispose qu’il est mis en œuvre avant tout partage. On pourrait difficilement y voir une maladresse ou une méconnaissance du législateur, puisque l’article 1514 qualifie expressément le prélèvement moyennant indemnité d’opération de partage dans le texte qui précède immédiatement la disposition relative au préciput. Aussi est-ce en toute connaissance de cause que le législateur précise que le préciput opère avant tout partage
2°/ Le préciput consiste pour le conjoint à prélever un bien en vue de le soustraire de la masse partageable. À cet égard, la cour d’appel de Grenoble estime que les mécanismes du préciput et du prélèvement sont identiques. Aussi la qualification doit être la même. Pourtant, le préciput opère différemment du prélèvement moyennant indemnité. Certes, le résultat est identique, en ce que la propriété d’un bien commun est privativement attribuée au conjoint. On passe d’une propriété collective à une propriété privative, ce qui est le propre du partage. Cette idée serait confortée par le fait que l’autre qualification à laquelle on aurait pu songer – la donation – est expressément exclue et écartée par l’article 1516, de sorte que la seule classification disponible serait celle du partage.
Mais cette analyse est insuffisamment convaincante, car elle repose sur une vision binaire des avantages tirés de la convention matrimoniale. Ceux-ci peuvent emprunter divers vecteurs juridiques. Aussi est-ce une vision appauvrie que de considérer que l’avantage conféré passe inévitablement par la donation ou par le partage. Il peut certes emprunter de telles techniques, mais il n’y est pas tenu ; il peut aussi utiliser des voies spécifiques comme l’attribution d’un droit de propriété sur un ou plusieurs biens, sans passer par le partage.
3°/ Surtout, la voie empruntée par le préciput est profondément différente de celle du prélèvement empêchant toute qualification du premier en opération de partage. Celle-ci consiste à substituer une propriété privative à une propriété collective, en conférant à l’attributaire un droit de propriété exclusif par opposition aux droits concurrents dont ils faisaient l’objet, mettant ainsi un terme à l’indivision.
Mais le partage n’est pas réalisé « à vide », puisqu’il est finalisé par le respect des vocations, en veillant à attribuer à chacun ce à quoi il a droit. Le partage des biens est la concrétisation effective des droits théoriques. L’attribution des lots remplit l’indivisaire de ses droits dans l’indivision, chaque bien s’imputant sur les droits. Telle est la fonction du partage.
Or, le préciput y est étranger, puisque le bien sur lequel il porte n’entre pas en ligne de compte pour la communauté et ne s’impute pas sur les droits de l’époux. Il n’a pas vocation à remplir l’époux de ses droits dans la communauté. C’est même tout le contraire, puisqu’il s’y ajoute. Et c’est là la différence essentielle avec le prélèvement moyennant indemnité. Pour ce dernier, l’article 1414 prévoit que le ou les biens prélevés s’imputent sur les droits théoriques du conjoint. Les biens prélevés ont pour fonction de remplir le conjoint de ses droits dans l’indivision, ce qui n’est pas le cas du préciput, puisque le bien prélevé vient en plus des droits du conjoint dans la masse à partage. C’est sur ce point que l’analyse de la cour d’appel de Grenoble s’égare. Elle estime que la circonstance que le prélèvement ait une contrepartie, puisque le conjoint doit en faire rapport à la communauté, est sans effet sur la nature de l’opération, puisqu’un partage n’est pas nécessairement égalitaire. Il est certain qu’un partage peut être inégalitaire, mais les attributions d’un partage ont malgré tout pour objet de remplir l’indivisaire de ses droits dans la masse à partager fussent-ils inégalitaires. Or, les biens prélevés au titre du préciput ne s’imputent pas sur les droits du conjoint dans la masse. Il contrevient même à la fonction du partage, puisqu’il permet le prélèvement de certains biens sans considération pour les droits de l’époux dans la communauté, avantageant ainsi l’époux bénéficiaire .
4°/ Enfin, dans le prolongement de cette idée et ainsi que le considère la cour d’appel de Rennes, le préciput réalise un prélèvement et non un allotissement. Il constitue une restriction à la masse à partage, en opérant une réduction des biens communs formant la masse indivise.
En conclusion, le préciput n’est pas une opération de partage, quand bien même permet-il au conjoint de recueillir la propriété privative sur un bien commun, l'excluant de l'assiette du droit de partage.
CA Rennes. 19 avril 2024, n° 21/03418 (extraits)
30. Toutefois, s’agissant de la 4e condition, le préciput a pour objet de permettre au conjoint survivant de prélever des biens communs avant tout partage, biens qui sont réputés lui avoir appartenu dès la dissolution de la communauté et ce, sans que cette attribution ne s’impute sur ses droits dans le cadre d’un éventuel partage ultérieur. Les biens ainsi prélevés ne feront plus partie de la masse successorale à partager. L’exercice de la clause de préciput n’a donc qu’une fonction de prélèvement par le seul conjoint survivant et non d’allotissements entre plusieurs copartageants (TJ Niort, 22 mars 2022, TJ Lille, 4 avril 2022, CA Poitiers, 4 juillet 2023).
31. En d’autres termes, le préciput est une restriction de la masse à partager. Par l’exercice de sa faculté, le conjoint vient réduire les biens communs, appelés à former la masse indivise. Il n’est donc pas concevable de traiter le préciput comme une attribution dans le partage.
32. D’où la prescription de l’article 1515 du code civil, selon laquelle, dans une logique matrimoniale et non pas fiscale ni successorale, le prélèvement s’opère sur la communauté et avant tout partage. Du reste, les articles 1515 et 1516 sont situés au titre V du livre 3e relatif au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux et non pas au titre I ou II du livre 3e relatif aux successions et libéralités.
CA Grenoble, 24 septembre 2024, n° 23/01411 (extraits)
S’agissant, enfin, de l’existence d’un véritable partage, c’est-à-dire, la transformation du droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens qui lui sont attribués, tel est bien l’objet du préciput qui rend le conjoint survivant seul propriétaire, dès sa mise en œuvre, des biens qu’il désigne ayant dépendu de la communauté dissoute.
Dès lors, les quatre conditions édictées par la doctrine administrative invoquée par les intimés sont bien remplies s’agissant du préciput.
Par conséquent, la mention de l’article 1515 selon laquelle l’autorisation ainsi donnée au conjoint survivant lui permet de prélever les biens prévus dans le préciput « avant tout partage », ne saurait être considérée, à elle seule, comme permettant d’exclure le préciput de la qualification d’acte de partage.
Il sera souligné à cet égard, par analogie, que les articles 1511 à 1514 du même code, lesquels, précédant ceux relatifs au préciput, traitent de la « clause de prélèvement moyennant indemnité », décrivent cette dernière comme offrant au conjoint survivant la « faculté de prélever certains biens communs »(à charge d’en tenir compte à la communauté), formulation quasiment identique à la faculté qu’offre le préciput (autorisation de « prélever sur la communauté, avant tout partage » certains biens) ; or, l’article 1514 édicte expressément que ce prélèvement moyennant indemnité « est une opération de partage ».
La Cour de cassation (Cass. 1re civ, 17 juin 1981) a, par ailleurs, jugé que, dans le cas du prélèvement moyennant indemnité, « l’époux bénéficiaire devient, par l’effet du prélèvement qu’il exerce, seul propriétaire du bien prélevé sans qu’un partage ait été nécessaire et il a qualité pour en disposer', le mécanisme ainsi décrit étant exactement le même que celui résultant du préciput quant à l’exercice du droit, ainsi que son cadre juridique (indivision), sa nature (prélèvement prioritaire) et ses effets, (attribution immédiate du bien avant tout partage), la circonstance que ce prélèvement ait, dans ce cas, une contrepartie puisqu’il doit en être fait rapport à la communauté étant sans effet sur la nature même de l’opération, étant rappelé qu’un partage n’est pas nécessairement égalitaire puisqu’il s' opère en fonction des droits des copartageants qui peuvent être différents.
Il en résulte que le préciput est bien soumis au droit de partage de l’article 746 du code général des impôts.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23‑19780 (extraits)
Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2023), à la suite du décès de son époux le [Date décès 2] 2016, Mme [W] a prélevé sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage, deux biens immobiliers ainsi que les meubles meublants garnissant ces biens.
2. Par une proposition de rectification notifiée à Mme [W] le 9 décembre 2019, l’administration fiscale a soumis ces prélèvements au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
(…)
Examen du moyen
4. L’examen du dossier conduit à un renvoi à la Première chambre civile pour avis en application de l’article 1015‑1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la chambre commerciale :
TRANSMET pour avis à la Première chambre civile la question suivante :
« Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ? » ;
II – Libéralités
A – L’action en délivrance
du legs se prescrit par le délai quinquennal de droit commun
Lorsque le légataire particulier ne bénéficie pas de la saisine, il doit demander, selon l’article 1014 du code civil, la délivrance de son legs auprès des héritiers réservataires et, à défaut, auprès du légataire universel . La délivrance permet de vérifier le titre qui investit le légataire et de contrôler la régularité de son droit. Si le legs est délivré, son bénéficiaire peut se mettre en possession du bien et en percevoir les fruits. Toutefois, il faut bien comprendre que la délivrance ne matérialise pas le transfert de propriété. Le gratifié est investi de la propriété du bien par le testament qui l’institue légataire et la recueille dès le décès du disposant. Le légataire ne saurait se dispenser de cette formalité. Mais de combien de temps dispose-t-il pour solliciter la délivrance ?
Alors qu’elle ne s’était jamais clairement prononcée sur la question, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 23 octobre 2024 que l’action en délivrance se prescrit par la prescription de droit commun , à savoir cinq ans, au motif qu’elle est une action personnelle. Elle a le mérite de trancher la discussion apparue sur le délai de prescription applicable à la délivrance.
Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, la jurisprudence avait considéré que l’action en délivrance relevait de la prescription de droit commun, à savoir trente ans . La solution ne suscitait alors guère de difficulté, puisque le délai était identique pour l’option et pour la délivrance. Mais la loi du 23 juin 2006 a soustrait l’option successorale de la prescription de droit commun pour la faire régir par un délai spécial de dix ans . Aussi s’est-on interrogé sur la prescription applicable à la délivrance. Continuait-elle de relever du délai de droit commun réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ? Ou bien, était-il préférable de la faire coïncider avec le délai d’option ? Trois solutions ont été proposées.
La première conduit à admettre une prescription à géométrie variable pour l’action en délivrance au motif qu’elle serait une action mixte , qui aurait un objet à la fois personnel et réel, à l’exemple de l’action en nullité d’une vente immobilière. Ainsi, l’action est personnelle, puisqu’elle a pour objet la reconnaissance du titre mais elle peut être aussi réelle, lorsque le legs porte sur un bien immobilier. Dans ce cas, l’action en délivrance se prescrit par trente ans . Hormis cette hypothèse, elle relève de la prescription quinquennale.
La deuxième solution aligne la prescription de l’action en délivrance sur celle de l’option successorale, à savoir dix ans à compter de l’ouverture de la succession . Des raisons pragmatiques expliquent cette unification : il serait pour le moins curieux qu’un délai de prescription différent s’applique pour accepter son legs et pour en obtenir la délivrance .
La troisième solution s’en tient aux règles de la prescription. L’action en délivrance est une action personnelle et relève à ce titre de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil .
C’est cette dernière analyse que la Cour de cassation fait sienne. Qualifier l’action en délivrance d’action mixte présente l’inconfort d’un délai de prescription qui diffère selon l’objet du legs, alors que l’objet principal de la délivrance est le même : vérifier le titre et contrôler la régularité du titre. De surcroît, que décider lorsque le légataire recueille des biens meubles et immeubles à la faveur de deux legs particuliers ou d’un legs à titre universel. Il est préférable de s’en tenir à la raison d’être de la délivrance, pour considérer qu’elle est une action personnelle ou, à tout le moins, qu’elle n’est pas une action réelle immobilière, conduisant à retenir le délai quinquennal. On ne saurait nier que cela conduit à une divergence étrange entre le délai pour accepter et celui pour obtenir la délivrance. Bien sûr, cela peut s’expliquer par une différence d’objet. L’option permet au légataire de renoncer ou de consolider le droit attribué par le testament ; la délivrance permet la reconnaissance de son droit par ceux qui sont investis de la saisine . Mais il n’empêche que cela réduit de fait le temps pour opter. Le légataire non saisi doit accepter dans les cinq ans à compter de sa connaissance du legs s’il veut demander la délivrance sans être prescrit. S’il le fait au-delà, son option aura été exercée à temps, mais il ne pourra plus demander la délivrance, puisque cinq ans se seront écoulés, emportant l’inefficacité de son legs et la déchéance de son droit de propriété. L’héritier saisi institué légataire n’encourt pas le même risque, puisqu’il n’a pas besoin de demander la délivrance de son legs.
Face au risque de la prescription de sa demande, le légataire espérait en l’espèce avoir gain de cause en arguant d’une demande implicite de délivrance, consistant dans sa résistance opposée à l’action intentée par l’héritier réservataire tendant à dénier ses droits.
Il est vrai que la demande de délivrance n’est enfermée dans aucune formalité particulière et qu’elle peut être tacite . Encore faut-il que le comportement du légataire soit suffisamment univoque. Et manifestement, ce n’était pas le cas en l’espèce. Il est pour le moins audacieux que de considérer que la défense à une action en nullité du testament, puisse être considérée comme une demande de délivrance. Défendre, ce n’est pas demander. Il aurait fallu pour cela formuler une demande reconventionnelle de délivrance ainsi que l’évoque la Cour de cassation.
Le légataire aurait-il pu invoquer l’existence d’une contestation de la validité du legs comme cause d’empêchement à agir dans le temps imparti ? Après tout, comment demander la reconnaissance d’un titre dont la validité même est contestée ? Le moyen ne pouvait prospérer, puisque la Cour de cassation estime que l’action en nullité du testament engagée par un héritier ne suspend pas la prescription .
Un seul enseignement pratique à retenir : demander au plus vite la délivrance du legs.
Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22‑20367 (extraits)
6. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. Il résulte de l’article 1004 du code civil qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires.
8. L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code.
9. Après avoir relevé que le point de départ de la prescription de l’action en délivrance du legs universel de M. [X] devait être fixé au 8 décembre 2008, date du décès d'[N] [E], la cour d’appel a retenu qu’aucune demande formée par M. [X] lors du litige tendant à l’interprétation du testament, tranché par l’arrêt du 30 janvier 2014, ne pouvait s’analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs, et que cette procédure n’avait pas suspendu la prescription de l’action en délivrance du legs.
10. Elle en a exactement déduit que la demande de délivrance du legs de M. [X] était prescrite et que son legs était privé de toute efficacité.
III – Successions
A – L’action en réduction doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter du décès ou, au-delà, dans un délai
de deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve héréditaire dans la limite de dix ans après le décès
Le délai de prescription de l’action en réduction se présente sous un jour particulièrement sophistiqué, en ce que, dans un même texte et pour une même action, ce ne sont pas moins de trois délais qui sont évoqués. L’article 921, alinéa 2, du code civil dispose que le délai de prescription est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Face à un si grand nombre de délais et à un texte à la rédaction malencontreuse, il était inévitable que leur articulation soit l’objet de discussions.
C’est sur cette question que la Cour de cassation devait prendre parti dans un arrêt du 7 février 2024 . Deux époux étaient décédés 1989 et 2015. À l’occasion du règlement de leur succession, deux de leurs enfants assignèrent les autres en partage de la communauté et de la succession et en réduction de diverses libéralités et avantages dont leur mère aurait profité. Les défendeurs estimèrent que l’action était irrecevable pour cause de prescription. Selon eux, les dispositions de l’article 921 du code civil exigent que le demandeur agisse, dans tous les cas, dans les deux ans du jour où l’héritier a découvert l’atteinte à sa réserve. Le pourvoi est évidemment rejeté donnant l’occasion à la Cour de cassation de fixer clairement et exactement l’articulation du délai quinquennal et du délai biennal.
Le pourvoi se fondait sur une application cumulative ou simultanée des deux délais . L’héritier qui ne recueille pas sa réserve devrait agir à la fois dans les cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, mais aussi dans les deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte à sa réserve . Assez curieusement, le délai de deux ans aurait alors pour effet de réduire le délai de prescription de cinq ans, alors que tel n’est manifestement pas l’objet du texte. C’est alors l’utilité même du délai quinquennal qui est en question. À quoi bon le prévoir, s’il faut toujours agir dans les deux ans de la connaissance de l’atteinte à la réserve dans la limite de dix ans à compter de l’ouverture de la succession ?
C’est une autre analyse, plus respectueuse de l’esprit du texte, que la Cour de cassation a retenu en adoptant une application successive des deux délais. Elle affirme que la prescription quinquennale s’applique d’abord et ce n’est qu’ « au-delà » de ce délai, que l’héritier peut agir dans les deux ans après la découverte de l’atteinte à la réserve. Toutefois, évoquer une application successive des deux délais ne manifeste qu’incomplètement l’articulation spécifique des deux délais, en gommant leur hiérarchisation.
À suivre strictement sa lettre, l’article 921, alinéa 2, pourrait laisser croire que les deux délais sont sur un pied d’égalité, alors qu’il n’en est rien.
Le délai quinquennal constitue la prescription de principe. C’est dans les cinq ans qui suivent l’ouverture de la succession que l’héritier doit agir en réduction des libéralités excessives. C’est ce que laisse entendre la Cour de cassation en affirmant que l’héritier n’a pas d’autre choix que d’agir dans les cinq ans : « l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès » .
Ce n’est que par exception que le législateur a ouvert un autre délai qui fait figure de prescription de rattrapage. Une fois les cinq ans expirés, le législateur offre à titre dérogatoire un délai supplémentaire de deux ans pour le seul cas où l’héritier ignorait l’atteinte à sa réserve et n’en a découvert l’existence qu’après l’achèvement du délai quinquennal, soit que les libéralités étaient déguisées ou indirectes et donc plus difficiles à détecter, soit que les autres héritiers se sont ingéniés à tenir un héritier réservataire à l’écart des opérations de liquidation et de règlement de la succession , soit parce que les circonstances (maladie, éloignement, etc.) l’ont empêché de connaître l’existence de l’atteinte à sa réserve. Le point de départ du délai biennal est différent du délai quinquennal, puisqu’il court à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.
Le délai de deux ans est une mesure de faveur accordée par le législateur à l’héritier réservataire ignorant l’atteinte à sa réserve et qui, pour cette raison, n’a pas été en mesure d’agir dans le délai de cinq ans. Aussi la prescription biennale prend-elle naturellement place à la suite de la prescription quinquennale et ne s’applique que de manière subsidiaire dans l’hypothèse où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve au-delà du délai de cinq ans, ainsi que cela résulte explicitement des travaux préparatoires à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités . C’est aussi en ce sens que la doctrine a compris l’articulation des délais applicables à l’action en réduction, en analysant le délai quinquennal comme la prescription de principe et le délai biennal comme une dérogation, une possibilité exceptionnelle d’agir hors du délai de droit commun pour l’héritier demeuré dans l’ignorance de l’atteinte à sa réserve .
Toutefois, il faut noter que le délai biennal obéit à un point de départ glissant à la différence du point de départ quinquennal (qui court à compter de l’ouverture de la succession). Mais il ne saurait porter trop loin la faculté d’agir contre les libéralités excessives, de sorte que l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil fait glisser les deux ans jusqu’à le faire buter sur le délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Passé celui-ci, aucune action en réduction ne peut plus être exercée.
Cette articulation des délais préfigurait celle que le droit allait connaître à la faveur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Celle-ci a généralisé le modèle d’un point de départ de la prescription glissant assorti d’un délai butoir, venant empêcher toute action au-delà d’un certain délai. Ainsi, la prescription quinquennale de droit commun court à compter du jour « où le titulaire du d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » . Mais, en tout état de cause, le délai de prescription ne saurait être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit . Le délai de prescription de l’action en réduction avait anticipé le futur état du droit positif en matière de prescription avec, en prime, son recalage sur le délai de droit commun de cinq ans.
Une dernière précision enfin sur le délai butoir. Au motif qu’il viendrait empêcher le point de départ du délai biennal de glisser trop longuement, il ne faudrait pas en tirer la conséquence que le délai de dix ans s’applique exclusivement à lui. L’admettre serait contraire à la lettre et à l’esprit du délai butoir. La lettre indique que c’est le délai de prescription qui ne peut jamais excéder dix ans à compter du décès, ce délai visant indifféremment les cinq ans ou les deux ans. Ensuite, l’esprit du délai butoir est de poser une limite infranchissable à l’action en réduction, afin de sécuriser le règlement des successions, qui est l’un des objectifs majeurs de la loi du 23 juin 2006 réalisé notamment par la réduction du délai de prescription de l’action en réduction (trente ans auparavant) et par l’instauration d’un délai butoir réduit par rapport au délai butoir de droit commun (vingt ans).
En résumé, l’action en réduction doit être exercée dans les cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, si l’héritier a connaissance de l’atteinte à sa réserve dans ce délai. Tel est le principe. Si l’atteinte à la réserve est découverte après l’expiration du délai quinquennal, il peut encore agir en réduction dans les deux ans à compter de la connaissance de cette atteinte (et non du décès), sans que cette action ne puisse excéder dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Le délai quinquennal et le délai biennal entretiennent ainsi un rapport de subsidiarité.
Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22‑13665 (extraits)
6. L’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
7. Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
8. Le moyen, qui, en soutenant que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve, postule le contraire, n’est donc pas fondé.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
B – Les legs consentis au conjoint
survivant doivent s’imputer
sur le quart légal en propriété
Au titre du règlement de la succession, il est prévu que les libéralités doivent s’imputer. Ces opérations d’imputation mettent en œuvre le même mécanisme – la soustraction – mais pas au même titre. En premier lieu, l’imputation participe de la détection des atteintes à la réserve en permettant de savoir si la libéralité demeure bien dans le secteur d’imputation qui est le sien : la réserve individuelle, et subsidiairement la quotité disponible pour les libéralités en avance de part successorale, et la quotité disponible pour les libéralités hors part successorale.
En second lieu, l’imputation tend à s’assurer que le conjoint survivant ne puisse pas recueillir les libéralités dont il a été gratifié et les droits successoraux que la loi qui lui accorde.
Peu à peu, la jurisprudence dessine le régime juridique des opérations d’imputation. Il y a deux ans, elle avait affirmé que l’imputation des libéralités devait être opérée en assiette pour la détection des libéralités attentatoires à la réserve héréditaire . Seule cette modalité permettait d’assurer l’intégrité de la réserve en quotité et en nature. C’est maintenant à l’imputation des libéralités sur les droits légaux du conjoint survivant que la Cour de cassation s’attache par un arrêt du 24 janvier 2024 pour décider que les legs reçus par le conjoint survivant ne pouvaient pas se cumuler avec ses droits légaux, mais qu’ils devaient au contraire s’imputer. Le conjoint avait été institué par le défunt légataire de la pleine propriété des liquidités et de l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession. Sur fond de litige relatif à la responsabilité du notaire en charge du règlement de la succession, la cour d’appel avait jugé que les legs institués au profit du conjoint survivant se cumulaient avec les droits que la loi lui conférait dans la succession.
C’est précisément sur ce point que la cassation intervient pour violation de la loi aux visas des articles 757 et 758‑6 du code civil. Pour la Cour de cassation, les legs consentis au conjoint ne peuvent en aucun cas se cumuler aux droits légaux mais doivent au contraire s’imputer sur eux. Pour cela, il faut prendre la valeur en propriété des legs et y ajouter la valeur, convertie en capital, des droits légués en usufruit. Puis, le montant total doit être comparé à la valeur du quart en propriété calculé selon les règles fixées par l’article 758‑5 du code civil. La Cour pose ainsi une règle de principe et en expose les modalités.
La règle de principe. Les libéralités consenties par le défunt au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux et ne se cumulent pas avec eux. Devoir affirmer cette règle peut surprendre, alors que l’article 758‑6 du code civil la prévoit expressément. Cela étonne moins, lorsque l’on a en mémoire les atermoiements législatifs et jurisprudentiels sur l’imputation.
L’attitude du législateur à l’égard de l’imputation a été pour le moins erratique. Jusqu’en 2001, la règle de l’imputation était posée par l’ancien article 767, alinéa 6, du code civil. Ainsi, le conjoint survivant ne pouvait pas recevoir d’une part les droits que la loi lui confère dans la succession du défunt et, d’autre part, les libéralités que celui-ci lui a consenties. Les secondes devaient s’imputer sur les premiers. La loi du 3 décembre 2001 a abrogé l’imputation, offrant au conjoint la possibilité de recueillir à la fois les donations et legs et les droits successoraux. Puis, à la faveur de la réforme des successions et des libéralités du 23 juin 2006, le législateur a rétabli l’imputation.Pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007 . Si le règlement des successions est de nouveau soumis à l’imputation, il demeure donc une « fenêtre », située entre l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 (1er juillet 2002) et le 1er janvier 2007, dans laquelle le conjoint survivant était en droit de cumuler les libéralités reçues du défunt et ses droits successoraux légaux.
Cette hésitation du législateur s’est retrouvée par la force des choses dans la jurisprudence. Par un avis du 26 septembre 2006 , la Cour de cassation a considéré que pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la règle de l’imputation a été abrogée par la loi du 3 décembre 2001 . En conséquence, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux conférés par la loi avec les libéralités reçues du défunt mais sans porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux. En revanche, pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, la règle de l’imputation a été réintroduite par la loi du 23 juin 2006, de sorte que le conjoint survivant ne peut plus bénéficier de ce cumul. L’avis avait pour mérite d’ordonner les choses de manière claire selon la date d’ouverture de la succession. Mais il demeurait pour le moins malencontreux qu’à la faveur du hasard de la date du décès, un conjoint puisse cumuler les libéralités et les droits légaux et un autre non. Hormis ce problème de taille, les choses étaient clairement fixées du moins jusqu’à ce que la Cour de cassation ne les obscurcisse. Par un arrêt du 25 octobre 2017 , elle décide qu’un époux bénéficiaire d’une donation entre époux lui attribuant la plus forte quotité disponible pouvait prétendre recueillir le quart en propriété et les trois quarts en usufruit. Ce n’est pas la solution qui était ici contestable, mais sa motivation. La cour d’appel avait jugé au nom du principe du non-cumul que le conjoint devait se contenter du quart en propriété et ne pouvait pas y cumuler la donation entre époux au risque de porter atteinte à la réserve. La cour d’appel avait assurément mal compris et mal appliqué la règle du non-cumul et de l’imputation. Elle a été justement censurée par la Cour de cassation mais par une motivation qui laisse songeur. Elle estimait que le conjoint pouvait bénéficier de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation dans la limite de la quotité disponible spéciale. C’est le terme « augmentée » qui était inapproprié, en ce qu’il renvoyait à l’idée d’un ajout et donc d’un cumul entre les droits légaux et les libéralités, ce qui était manifestement contraire aux dispositions de l’article 758‑6 du code civil. Il aurait été plus avisé de dire que l’imputation ne saurait priver le conjoint de ce que lui a transmis le défunt par la voie libérale dans les limites de la quotité disponible spéciale.
C’est pourquoi l’arrêt du 17 janvier 2024 est si important : il remet les choses en ordre, en évinçant toute idée d’ajout, de cumul ou d’augmentation. Les libéralités recueillies par le conjoint s’imputent sur ses droits légaux mais ne se cumulent pas. Cela signifie que leur montant doit être retranché des droits conférés par la loi au conjoint survivant. Or, si les mots ont un sens (et ils en ont un), le retranchement est l’opposé de l’ajout ou du cumul. Les deux ne peuvent pas coexister. Par conséquent, le conjoint survivant recueille sa vocation légale diminuée des libéralités reçues du défunt. Par la technique de l’imputation, on vérifie que les libéralités lui permettent de recueillir à tout le moins le montant de ses droits légaux. Si c’est le cas, le conjoint se contente des libéralités sans rien recevoir au titre des droits légaux. Si ce n’est pas le cas, il peut recueillir en plus des libéralités ce qui lui manque pour atteindre les droits légaux. Autrement dit, l’imputation permet de savoir si le conjoint survivant a été servi du montant de ses droits légaux grâce aux libéralités consenties par le défunt. Sauf exhérédation, le législateur souhaite que le conjoint recueille a minima le montant de ses droits légaux par l’intermédiaire des libéralités.
Modalités de l’imputation. Non contente de rappeler clairement la règle d’imputation, la Cour de cassation en livre les modalités d’application. En présence de plusieurs legs, il faut prendre en compte la valeur totale des legs institués au profit du conjoint survivant. Ensuite, cette valeur doit être comparée aux droits légaux ; elle est imputée sur ceux-ci. Mais une difficulté naît lorsque les droits sont de nature différente. En l’espèce, les droits légaux étaient d’un quart en propriété, puisque les enfants laissés par le défunt n’étaient pas issus de son union avec son conjoint. Or l’un des legs portait sur l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers. Comment imputer dans ce cas, car l’on ne peut imputer que des droits de même nature ? La Cour de cassation précise que la valeur de l’usufruit doit être convertie en capital. En apparence, la solution diverge de celle de 2022 où elle affirmait que l’imputation des libéralités devait se faire en assiette. Mais la différence s’explique parfaitement. En 2022, il s’agissait de l’imputation aux fins de détecter d’éventuelles atteintes à la réserve héréditaire. Les libéralités ne sauraient porter atteinte au montant de la réserve mais aussi à sa nature, à savoir des droits en pleine propriété ou en nue-propriété en présence de libéralités consenties à l’époux. Il est donc nécessaire, pour procéder à l’imputation, de tenir compte de la nature des droits conférés par les libéralités. En revanche, l’imputation de l’article 758‑6 du code civil vise à s’assurer que le conjoint recueille bien ses droits légaux. C’est alors moins une question de nature de droits que de montant. Aussi pour procéder à l’imputation dans cette hypothèse, il faut que les droits soient de même nature. S’agissant de droits légaux en propriété, il faut que le montant des legs soit exprimé en valeur propriété, ce qui implique d’évaluer l’usufruit. En revanche, rien n’est dit sur la manière d’y procéder. L’évaluation de l’usufruit peut se faire de manière économique, consistant à tenir compte des flux de revenus futurs selon de l’espérance de vie de l’usufruitier ou bien de manière fiscale en se référant au barème de l’article 669 du CGI.
Une fois calculée la valeur des legs, elle doit être comparée à la valeur du quart de la propriété calculé selon les règles fixées par l’article 758‑5 du code civil. En fait de comparaison, il s’agit d’une imputation, donc d’une soustraction, destinée à savoir si le conjoint a recueilli avec les libéralités un montant identique à celui de ses droits légaux. Deux situations sont possibles. Si les libéralités sont d’un montant égal ou supérieur aux droits légaux, le conjoint survivant se contente des libéralités sans pouvoir prétendre à recueillir les droits légaux. Il ne peut pas cumuler les deux. C’est le résultat concret de l’imputation : le conjoint a été servi de ses droits légaux grâce aux libéralités. Si le montant des libéralités est inférieur aux droits légaux, le conjoint survivant n’en a pas été pourvu. Il peut donc réclamer le complément dans les biens existants de la succession.
Lorsque le conjoint survivant entend recueillir l’usufruit légal , la méthode d’imputation est quelque peu différente. Il convient préalablement d’inclure les libéralités recueillies par le conjoint dans l’assiette de l’usufruit légal, puisque l’on ne peut déduire d’une masse que des biens qui y ont pris en compte . Il faut ensuite convertir cet usufruit en valeur propriété. Enfin, on soustrait de cette valeur le montant des libéralités.
Rappelons que l’imputation n’a lieu d’être que si le conjoint survivant ne recueille pas l’intégralité de la succession par exemple au moyen d’une libéralité universelle. Dans ce cas, la question des droits légaux n’a plus lieu de se poser, puisque le conjoint recueille la totalité de la succession. L’imputation n’a plus de raison d’être.
Dispense d’imputation. La règle de l’imputation sur les droits successoraux s’impose en présence de libéralités du conjoint survivant. Est-elle pour autant d’ordre public ? Les parties pourraient-elles y déroger, autorisant le conjoint à cumuler les droits légaux et le conjoint survivant ? Une partie de la doctrine rejette la possibilité d’une dispense estimant que l’imputation est impérative . Elle s’appuie sur le fait que la dispense d’imputation avait été prévue par la Chancellerie dans le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, mais elle a été supprimée lors des débats parlementaires . Toutefois, l’impérativité de l’imputation n’est guère convaincante. Elle était admise sous l’empire du droit antérieur à la loi du 3 décembre 2001. La jurisprudence avait d’ailleurs accepté de faire produire effet à une telle dispense, permettant que le conjoint survivant recueille l’usufruit légal tout en profitant des libéralités, puisque telle était la volonté du testateur . Plus récemment, la Cour de cassation semble admettre la possibilité de mettre à l’écart l’imputation mais en vertu de décisions difficiles à interpréter. À propos d’une succession ouverte après le 1er janvier 2007, la Cour de cassation a refusé de censurer une cour d’appel qui avait admis que le conjoint survivant pouvait cumuler le quart légal en propriété et la libéralité portant sur l’usufruit de l’entière succession . Ensuite, on ne voit pas ce qui empêcherait un défunt de vouloir avantager son conjoint en lui permettant de recevoir les droits légaux et les libéralités . Un tel cumul ne pourrait évidemment pas porter atteinte à la réserve héréditaire ; il serait cantonné dans les limites de la quotité disponible spéciale.
Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 21‑20520 (extraits)
Vu les articles 757 et 758‑6 du code civil :
(…)
12. En statuant ainsi, alors que pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, en vue de faire une exacte appréciation de l’existence de la perte de chance, les legs consentis à Mme [M] devaient d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci, de sorte qu’il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758‑5 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.