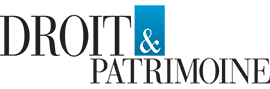Investisseurs & Dirigeants : vers de nouveaux équilibres ?
Paru dans Dirigeants n°7 - Avril 2019
Ces dernières années ont été le théâtre de nombreuses opérations de LBO laissant place à une concurrence acharnée entre les fonds. Un rééquilibrage des pouvoirs s’est opéré et les manageurs sont de plus en plus souvent à la manœuvre. Mieux informés et conseillés, ils sont mentionnés très tôt dans les discussions quand ils ne les initient pas. Quelles incidences sur les relations avec les investisseurs ? Sur les package ? Quel regard des fonds sur cette montée en puissance des dirigeants ?
Avec : Éric de Montgolfier, responsable du bureau français, Gimv ; Olivier Boyadjian, président, H.I.G. Capital France ; Henri Pieyre de Mandiargues, associé, McDermott Will & Emery ; Christophe Karvelis, président cofondateur, Capzanine ; Pierre-Olivier Bernard, associé fondateur, Opleo Avocats ; Stéphane de Lassus, avocat associé, Charles Russell Speechlys Paris.
Quelle relation entre dirigeants et fonds ?
Henri Pieyre de Mandiargues : Le contexte actuel démontre une grande maturité dans les relations entre les investisseurs et les dirigeants. Elle est liée à la profondeur du marché français et à son ancienneté, qui se traduit par un équilibre efficient entre les managers et les investisseurs. Les dirigeants ne considèrent plus que chaque fonds est une « commodité » qui serait substituable par un autre. Dans leur esprit, l’objectif est de trouver le bon partenaire qui sera capable d’accompagner leur projet d’entreprise, de mener à bien une transformation. Ils recherchent un équilibre de pouvoirs et de gouvernance. Chaque fonds peut faire valoir une spécificité (sectorielle ou d’approche) ce qui leur permet, dans un marché qui semble être drivé par le prix, de faire valoir leurs avantages compétitifs.

Pierre-Olivier Bernard : Depuis l’après crise, les dirigeants ne cherchent pas uniquement la rétrocession de plus-values mais sont vraiment à la recherche du bon partenaire pour accompagner le projet d’entreprise. Aujourd’hui, lorsque l’on parle de management package on parle de convergence d’intérêts et de discussion entre partenaires. Dans les opérations de mise en concurrence, le fonds qui l’emportera sera celui qui a noué une relation avec l’équipe de direction. C’est aussi sur les questions de gouvernance que le deal est emporté.
"Les dirigeants ne cherchent pas uniquement la rétrocession de plus-values mais sont vraiment à la recherche du bon partenaire pour accompagner le projet d’entreprise." Pierre-Olivier Bernard, associé fondateur, Opleo Avocats
Éric de Montgolfier : Les situations sont très hétérogènes et j’ai du mal à généraliser. Le cadre dans lequel se déroule la discussion, entre le nouvel investisseur et les dirigeants, structure souvent le type de relation qui va s’instaurer et in fine les équilibres. Dans l’exemple d’un LBO secondaire, le fonds vendeur peut décider de fixer avec le management un niveau de prix attendu pour lui permettre de sortir avec une performance optimisée et de donner, si le prix souhaité est atteint, la possibilité au management de choisir, dans une liste resserrée, son futur actionnaire. La discussion entre le nouvel investisseur et les dirigeants se déplace ensuite sur les équilibres de gouvernance et de partage de valeur entre les uns et les autres. La situation est bien différente lorsque les discussions sont entamées avec le management en amont du process de mise en vente de l’entreprise, ce qui est de plus en plus fréquent. Elle permet de se mettre d’accord sur le projet commun, la valorisation et une gouvernance détaillée avec les dirigeants, pour ensuite proposer une offre préemptive aux actionnaires.

Christophe Karvelis : La nature de la relation n’est pas la même dans un LBO primaire et dans un secondaire. J’ai tendance à penser que dans un LBO bis, le lien de confiance et de proximité qui se crée entre l’actionnaire et les dirigeants est, certes, important mais ce qui drive le plus le deal c’est le prix. Or malheureusement il a deux composantes : celui attendu par le fonds vendeur et le package souhaité par le manager. L’acquéreur potentiel est donc souvent pris entre deux eaux. Dans un LBO primaire, la situation n’est pas le même puisque l’on a un peu plus de temps pour apprendre à se connaître. La réalisation du dossier est d’ailleurs plus aléatoire. Mais a contrario, cette proximité est bien plus forte. On se choisit au-delà du prix. Un équilibre se trouve entre le prix, le projet, l’accompagnement et le package. L’appui des conseils est essentiel à cette phase. Néanmoins la banque d’affaires peut fausser, selon moi, cet esprit de partage et de sérénité que les partenaires tentent de mettre en place.
Stéphane de Lassus : Au moment du LBO secondaire ou tertiaire qui se concentre bien souvent sur des questions de prix, il peut y avoir un désalignement des intérêts. Il n’est donc pas rare que les fonds cherchent à se séparer du président, six ou neuf mois après la transaction. Bien souvent les non-dits durant les discussions préliminaires entraînent une perte de confiance entre les partenaires qui, lorsqu’ils se cristallisent, conduisent à un départ. Je pense que le comportement incisif des banques d’affaires pendant les négociations n’y est pas étranger car elles ont tendance à concentrer les discussions sur le prix, évacuant dès lors des sujets stratégiques qui ne sont pas assez évoqués.
Christophe Karvelis : Il faut tout de même rappeler que bien souvent le business plan est très influencé par la banque d’affaires !
Pierre-Olivier Bernard : De plus en plus on demande aux avocats d’être associés à la négociation du pacte d’actionnaires, avec la banque d’affaires. On vérifie les sujets de levier et d’endettement pour éviter les débordements au moment de la sortie. On tente aussi d’obtenir des droits pour les managers dans ce processus de sortie. Ils peuvent se retrouver pris entre les intérêts du vendeur, de l’acheteur et des leurs - car dans un LBO secondaire ils ont eux-mêmes la double casquette – tout en veillant à ce que la banque d’affaires ne réclame pas d’augmenter le business plan à un niveau insupportable. C’est là où le management package peut résoudre le problème car si le manager vend trop cher, il achète aussi derrière à un prix trop élevé. L’équilibre doit être trouvé et c’est pourquoi les managers demandent de plus en plus à avoir un droit de regard sur le choix de la banque d’affaires.

La situation est-elle comparable dans les autres pays ?
Olivier Boyadjian : La situation est bien différente dans nombre d’autres pays. Aux États-Unis par exemple, le management est le plus souvent absent de la table des négociations.
Éric de Montgolfier : Du fait de l’inflation des management packages, la perception est fortement ancrée, à l’étranger, qu’en France, l’entreprise appartient à ses dirigeants ; alors que partout ailleurs, elle appartient à ses actionnaires !


Les dirigeants ne considèrent plus que chaque fonds est une « commodité » qui serait substituable par un autre. Henri Pieyre de Mandiargues, associé, McDermott Will & Emery
Christophe Karvelis : C’est aussi parce qu’à un moment, certains acteurs ont décidé de pénétrer le marché de façon très agressive en faisant monter les prix des management packages.
Éric de Montgolfier : Ce n’est pas simplement une question de maturité de marché, mais bien une question culturelle. La Grande-Bretagne et la France sont les deux marchés les plus matures d’Europe. Or la manière dont sont construits les management packages au UK, comme la relation entre les fonds et les dirigeants, n’ont pas grand-chose à avoir avec ce qu’elle est en France. Objectivement les fonds majoritaires y ont un pouvoir plus important et le partage de la valeur est moins favorable aux dirigeants, pour des marchés qui ont pourtant des tailles relativement comparables.
Stéphane de Lassus : En Grande Bretagne, ce n’est vraiment pas la même chose. Cela se ressent d’ailleurs au niveau de l’alignement des intérêts puisque le manager est un peu plus mercenaire. Outre-manche, on négocie des accords avec HRMC, le fisc britannique, qui ressemblent en quelques sortes à des stock-options payants : les managers payent une option environ 1 % du sous-jacent à la valeur d’entrée comme mise de départ et seront taxés en plus-values quel que soit le montant de gains à la sortie, Force est de noter un certain décrochage par rapport au modèle français ou un gain élevé est toujours « suspect ».
Olivier Boyadjian : Il faut reconnaître qu’en France, les managers sont d’un niveau nettement supérieur à celui des autres pays.
Christophe Karvelis : Avec les contraintes qu’ont les patrons en France, nous avons la chance d’avoir des profils remarquables. Ils sont d’une maturité et d’une sophistication nettement supérieures à celles de leurs homologues européens.

Olivier Boyadjian : Ce n’est pas parce qu’ils ont été attirés par les management packages qu’ils sont devenus bons ! Le foyer à la base est tout de même bien supérieur.

Le marché s’est industrialisé à tous les étages : conseils, managers, investisseurs… l’univers s’est normé et le seul endroit où il reste une touche de créativité est la fiscalité, les packages. Éric de Montgolfier, responsable du bureau français, Gimv
Christophe Karvelis : C’est un mix de deux. On a su attirer les talents parce que les packages étaient généreux. Les dirigeants de grands groupes industriels ont pris conscience qu’ils pouvaient aussi se créer du patrimoine en étant sous LBO.
Olivier Boyadjian : L’une des explications complémentaires pourrait venir tout simplement de notre mauvaise connaissance de la langue anglaise. Les Allemands, les Néerlandais, les Belges qui n’obtiennent pas ce qu’ils veulent chez eux, s’expatrient car ils ont le niveau d’anglais nécessaire pour pouvoir aller travailler où ils veulent. Les Français eux, sont le plus souvent « obligés » d’être bons chez eux !
Pierre-Olivier Bernard : J’ai aussi vu des personnalités se révéler au contact des fonds.
Stéphane de Lassus : Certains deviennent même ensuite dirigeants de leurs propres fonds !
Quelle structuration possible des packages ?
Olivier Boyadjian : Nous sommes arrivés à un niveau de complexité inédit. Je suis très favorable à un retour aux structures simples.
Christophe Karvelis : Je me souviens de discussions interminables au moment de la sortie parce que personne n’avait la même interprétation du calcul de la plus-value. C’est devenu d’une complexité absolue. France Invest en a fait un cheval de bataille et réclame de la stabilité fiscale ! À chaque fois que nos conseils mettent en place un modèle, l’administration fiscale le remet en cause cinq à dix ans plus tard. Et tout doit être repensé. Le stress occasionné pour les dirigeants d’entreprise n’est pas sain. Sur une opération secondaire, nous avons mis six mois à closer car une jurisprudence avait remis en cause le modèle de package précédent et que le dirigeant ne voulait pas prendre de risque.

Henri Pieyre de Mandiargues : Les conseils subissent aussi cette situation et essayent d’organiser et d’anticiper les contraintes fiscales et sociales. Mais il est difficile de faire simple dans un tel contexte et tant les fonds, les banques de financement que les mangers veulent des solutions sans risque.
Olivier Boyadjian : Je pense sincèrement qu’il est possible de proposer des structures simples à base d’actions ordinaires et d’effet de levier. Dans l’environnement actuel, il faut malheureusement partir du principe que tout peut être requalifié par l’administration fiscale.
Henri Pieyre de Mandiargues : Avant le sujet Urssaf qui nous mobilise en ce moment, l’impact fiscal était surtout concentré sur les managers. Maintenant la société cible partage le risque et donc tous les acteurs de l’opération l’examinent avec plus d’acuité. Les fonds commencent à s’intéresser sérieusement à la question.
Stéphane de Lassus : L’administration fiscale refuse d’assurer cette stabilité. France Invest a tenté à plusieurs reprises de proposer à Bercy des schémas simples pour fixer un cadre, mais n’est jamais parvenue à obtenir de réponse. Lorsqu’il s’agit d’élargir le partage de la plus-value pour faire participer beaucoup de salariés, la réflexion avance plus vite. Mais l’administration refuse de s’engager sur l’avenir sur des structures de management packages ou sur des outils à utiliser. Les jurisprudences attendues rendent les managers nerveux mais elles sont sur des schémas datant de dix, voire de quinze ans. Désormais les schémas bien construits, avec des BSA qui ne sont pas dans le PEA, et avec un impôt payé à taux flat, sont assez sécuritaires. Le marché commence à être relativement balisé.


Il faut reconnaître qu’en France, les managers sont d’un niveau nettement supérieur à celui des autres pays. Olivier Boyadjian, président, H.I.G. Capital France
Henri Pieyre de Mandiargues : La situation est encore plus tendue dans des process de secondaire ou tertiaire qu’il faut sortir en trois semaines. Dans un si court laps de temps, comment pouvoir tout analyser en prenant le minimum de risques ?
Éric de Montgolfier : Aujourd’hui on peut réaliser des deals en trois semaines parce que les process sont préparés pour avoir la capacité de le faire. Le marché s’est industrialisé à tous les étages : conseils, managers, investisseurs… l’univers s’est normé et le seul endroit où il reste une touche de créativité est la fiscalité, les packages. Nous mettons depuis longtemps en annexe des accords avec le management, le modèle pour faire les calculs de sortie. Il est parfois difficile, six ans après, de se souvenir de la méthode retenue car entre-temps la pratique a changé, ou on traite un sujet qui n’existait alors pas encore.
Christophe Karvelis : Cet arrêt de la Cour de cassation va être clé. Il peut remettre en cause un grand nombre de montages, même ceux qui sont solides d’un point de vue fiscal.

Les schémas bien construits, avec des BSA qui ne sont pas dans le PEA, et avec un impôt payé à taux flat, sont assez sécuritaires. Le marché commence à être relativement balisé. Stéphane de Lassus, avocat associé, Charles Russell Speechlys Paris
Henri Pieyre de Mandiargues : L’arrêt d’appel qui est porté devant la Cour de cassation est tellement large du point de vue de sa rédaction qu’il pourrait en effet, si on le lit strictement, emporter tous les types de management packages et remettre en cause la plupart des structures.

Éric de Montgolfier : C’est typiquement un sujet sur lequel les managers et les dirigeants de fonds sont solidaires car la même problématique de good et bad leaver existe sur le carried interest.
Stéphane de Lassus : Sur le carried interest, un texte de loi protège les dirigeants. La loi Pacte prévoit d’ailleurs une réforme sur le carried des fonds étrangers pour attirer les équipes post-Brexit.
Henri Pieyre de Mandiargues : Les actions gratuites ne peuvent constituer une solution idéale puisque le Code de commerce prévoit des limitations du pourcentage de capital qu’elles peuvent représenter et qu’une personne peut détenir. Il y a un forfait social à payer, donc finalement elles ne sont pas si gratuites. Et la fiscalité du titulaire n’est pas non plus idéale. Si les actions gratuites sont données à toute une population de managers, tout le monde est coassocié et devient signataire du pacte d’associés. Ce n’est pas simple à gérer, notamment en cas de départ. Rappelons par ailleurs un questionnement de place sur l’hypothèse de transformer en format gratuit les instruments de ratchet, c’est-à-dire en actions gratuites de préférence. Les fiscalistes ont des doctrines diverses. Pour certains, le ratchet gratuit est parfaitement envisageable. Pour d’autres, c’est un détournement de l’outil même de l’action gratuite. Pour notre part, nous sommes assez réservés et nous estimons que ce montage présente un assez haut degré de risque.

Henri Pieyre de Mandiargues : Il faudra peut-être revenir à des opérations dans lesquelles les managers souscrivent uniquement à des actions ordinaires, un pur effet de sweet equity que l’on module en fonction de ce qui a été négocié.
Christophe Karvelis : Comment bâtir ce sweet equity ?
Henri Pieyre de Mandiargues : Avec des OC détenues par le fonds.
Christophe Karvelis : Depuis le 1er janvier, la déductibilité est à 30 % donc par définition il y en aura de moins en moins dans les opérations de LBO.
Olivier Boyadjian : C’est la déductibilité de la rentabilité. L’OC n’intervient que pour faire levier.
Éric de Montgolfier : En réalité, la souscription d’OC par l’investisseur permet également de limiter son downside si le BP n’est pas réalisé.
Christophe Karvelis : Mais le fonds a moins d’intérêt à avoir des OC car elles ont un coût qui augmente la valeur de l’entreprise.
Olivier Boyadjian : Elles ne servent qu’à permettre aux managers d’investir en sweet equity. Ce que le fonds ne déduira pas en intérêt, il le récupérera en partie au prorata de l’equity.

Olivier Boyadjian : Tu as raison mais on ne peut malheureusement pas tout avoir : la sécurité et la rémunération.
Henri Pieyre de Mandiargues : Rappelons tout de même que le levier fiscal n’est pas ce qui fait le deal.
Les packages peuvent-ils être structurés en dehors des opérations de LBO ?
Éric de Montgolfier : Nous investissons en majoritaire dans des contextes LBO, mais aussi en minoritaire pour accompagner des entreprises en forte croissance. Dans cet univers du Growth, l’appréciation de la valorisation d’entrée est souvent différente entre les entrepreneurs et l’investisseur et difficilement réconciliable. Pour résoudre cette différence de perception, nous prévoyons généralement des actions de préférence, parfois avec un TRI minimum, qui sont prioritaires en termes de cash-in à la sortie. Tout le monde s’y retrouve in fine.

C’est devenu d’une complexité absolue. France Invest en a fait un cheval de bataille et réclame de la stabilité fiscale ! Christophe Karvelis, président cofondateur, Capzanine
Henri Pieyre de Mandiargues : Est-ce qu’il vous arrive de perdre des deals face à des industriels parce qu’ils parviennent à structurer des packages attractifs pour les managers ?
Olivier Boyadjian : Non, c’est en général plutôt une question de prix.
Éric de Montgolfier : Nous aussi. Sur la dernière opération que nous avons perdue face à un industriel, nous avions 20 millions d’euros d’écart de prix. Les industriels sont plus aisément compétitifs sur le prix que sur le package du management de la cible.
Stéphane de Lassus : Les industriels peuvent essayer de mettre en place des packages mais il n’y a pas d’horizon de sortie, ils n’ont pas les mêmes outils et mêmes objectifs, c’est donc compliqué.
Christophe Karvelis : J’ai vendu une affaire à Webhelp il y a deux ans et la situation était différente. Il s’agissait d’une opération de corporate LBO. Nous avons fait un LBO où Webhelp a acquis 60 % du capital, le management conservant 40 %. Le levier a été fait au niveau de la filiale avec un système de clause de rachat, etc. Dans ce cadre, les management packages sont sophistiqués. Mais Webhelp est une entreprise culturellement rompue à l’exercice du LBO puisqu’elle est elle-même détenue par un fonds.

Henri Pieyre de Mandiargues : On a monté ce type de structure pour un industriel qui voulait monter une sorte de pépinière d’entreprises à l’intérieur de son groupe. Il a mis en place des management packages et, sans surprise, nous avons buté sur ce sujet de liquidité et de valorisation à quatre ou cinq ans. Le modèle doit donc être encore affiné.
Pierre-Olivier Bernard : Nous constatons également la volonté des industriels de donner accès au capital à leurs salariés. C’est d’ailleurs devenu l’un des aspects de la marque employeur. Comment organiser la liquidité dans ce cadre ?
Christophe Karvelis : Les seuls industriels qui peuvent le faire sont des entreprises qui sont déjà sous LBO car elles ont un horizon de sortie qui est assez clair et il peut y avoir un effet miroir entre les deux opérations. Sinon, c’est difficile.