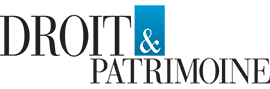La réforme des professions juridiques réglementées et la Constitution
La réforme consistant à organiser sur un modèle de libre installation et de libre concurrence, régulé par les avis de l’Autorité de la concurrence, des professions réglementées d’officiers publics se heurte à de fortes objections de constitutionnalité et de conventionnalité.
Par Yves Gaudemet, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Membre de l’Institut[1]
Contrairement à ce qu’indique notre programme, il n’y a pas lieu, à ce moment de la journée, à une synthèse générale. D’une part, des synthèses intermédiaires ont déjà été présentées, tirant les enseignements des deux tables rondes qui se sont succédé, d’autre part, nos interventions ont le devoir de se dérouler si je puis dire « en temps réel » puisque le texte qui nous mobilise est en cours de discussion au Parlement.
Il s’agit donc bien davantage, dans les quelques minutes qu’il nous reste, de dégager ici, du strict point de vue du droit constitutionnel et conventionnel, les différentes objections qui pourraient être faites, à ce stade des débats ou encore ensuite lors du contrôle de constitutionnalité de la loi, au texte tel qu’il a été finalement déposé devant le Parlement.
Un mot d’abord, très rapide, pour resituer le contexte dans lequel cette discussion se poursuit.
L’esprit général de la réforme, qui a été conçue au sein du ministère des Finances, plus précisément de l’Inspection générale des finances et de l’Autorité de la concurrence, est empreint d’une idéologie « libérale » telle qu’on la comprend aujourd’hui sur le plan juridique ; c’est-à-dire l’ouverture à la concurrence d’un « marché » qui serait actuellement paralysé et artificiellement confisqué par une réglementation dont bénéficient les professionnels, assurés ainsi du bénéfice de ce que la réforme appelle « des rentes de situation ». Il s’agit de substituer la régulation de ces marchés à l’actuelle réglementation, cette régulation étant elle-même tout naturellement confiée à titre principal à l’Autorité de la concurrence.
Dans cette logique, on comprend que le principe soit posé – au Code de commerce ! – d’un alignement des tarifs sur les coûts, d’une libre installation des professionnels et que, à tous les stades de la mise en œuvre d’un tel processus, on rencontre l’autorité régulatrice qu’est l’Autorité de la concurrence en lieu et place du ministère de la Justice. La régulation, par voie d’avis ou de recommandations, bref de « droit souple » – la pire des choses –, est ainsi substituée à l’actuelle réglementation des professions organisées, comme on l’a très bien dit, en service public ou en gestionnaires de prérogatives de puissance publique. On voit que, ainsi, la réforme comporte également un aspect institutionnel : ses promoteurs relayant et remplaçant – jusques et y compris lors du débat parlementaire – les autorités de référence et de contrôle habituelles des professions juridiques réglementées.
C’est qu’il n’y a pas de distinction véritable dans l’esprit des promoteurs de la réforme – et l’étendue des matières abordées par la loi « Macron » en porte la marque – entre le « marché » des professions et des activités juridiques et tout autre marché de fourniture de services.
Beaucoup a été dit sur le caractère fallacieux et en même temps dangereux, y compris du point de vue économique et pour les usagers de ces professions, de cette ignorance de la spécificité des prestations de services juridiques, tout spécialement celles qui sont placées entre les mains de professions réglementées. Et on a le sentiment que les pouvoirs publics commencent à le découvrir.
Mais, pour nous et à ce stade, la question qui se pose et à laquelle sont consacrées les réflexions qui suivent est plus strictement juridique : le changement de perspective politique que porte la loi ne se heurte-t-il pas à des obstacles constitutionnels ou encore d’ordre conventionnel ?
Cette discussion au demeurant n’est pas entière. L’avant-projet de loi, soumis au Conseil d’État, a fait l’objet de sa part d’un avis rendu public qui a mis en avant l’importance de ces objections constitutionnelles. Le projet de loi, tel qu’il a été déposé, ne pouvait pas ne pas en tenir compte, mais mon sentiment est qu’il l’a fait a minima et que ces critiques, pour l’essentiel, demeurent.
Pour en rendre compte, je suivrai l’ordre du projet de loi tel qu’il a été déposé, examinant d’abord la question des tarifs (I), celle de la liberté d’installation et du droit de présentation (II), celle ensuite de l’indemnisation des offices existants (III), et enfin celle des renvois prévus par la loi à des ordonnances de l’article 38 de la Constitution (IV).
I – Les tarifs
Le projet de loi pour la croissance et l’activité instaure en son article 1er de nouveaux principes d’orientation vers les coûts pour la fixation et la révision des tarifs auxquels sont soumis les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires. Le principe est posé à l’article L. 444-2 qui serait ajouté au Code de commerce et selon lequel « les tarifs réglementés (…) prennent en compte les coûts du service rendu ainsi qu’une rémunération raisonnable définie sur la base de critères objectifs ».
La mise en œuvre de ces principes nouveaux est renvoyée à un décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de la concurrence, laquelle peut au demeurant toujours être consultée par le gouvernement sur cette politique tarifaire ou s’autosaisir.
Sur ces bases, ce sont des arrêtés conjoints du ministre de la Justice et du ministre de l’Économie qui « arrêtent le tarif de chaque prestation, sous la forme d’une fourchette comportant un maximum et un minimum », dans la limite d’un ratio fixé en deçà du double par le décret tarifaire. C’est le système dit du « corridor tarifaire » présenté dans le dossier de presse qui accompagne la loi comme comportant un plafond avec la possibilité de « réductions négociées dans la limite d’un plancher pour éviter le dumping ».
Que faut-il en penser ? Que c’est là une présentation radicalement nouvelle, procédant d’une démarche abstraite et théorique de la formation des prix sur un marché, et qui, surtout, ignore ce qui justifie à la fois le principe d’un tarif des professions juridiques réglementées, son unicité et son caractère non négociable ainsi que la fonction qu’il remplit.
A – Sur le principe et l’unicité du tarif
La question qui se pose en droit est en effet d’abord celle du principe d’un tarif, le même pour tous et déterminé par catégorie d’actes, assurant l’égalité des usagers dans l’accès à la prestation en cause ; tarif au demeurant fixé, aménagé et librement modifié par les pouvoirs publics dans le respect du principe d’unicité et d’égalité des usagers.
À cet égard, il faut remarquer que le tarif, lorsqu’il existe, ne couvre pas l’intégralité des prestations des professions concernées ; ce que néglige de faire le projet de loi pour la croissance et l’activité.
Ces professionnels sont en effet à la fois et selon les moments officier public et professionnel libéral ; ainsi, pour le notaire, rédacteur d’actes qu’il reçoit et auxquels, délégataire de la puissance publique, il confère un caractère exécutoire, et conseil de ses clients comme le sont d’autres professionnels du droit.
Or le tarif ne concerne que les actes reçus par des officiers publics, investis de prérogatives de puissance publique, et pour conférer à ces actes un brevet de légalité et les rendre exécutoires ; ce qui est le cas, si l’on prend encore l’exemple des notaires, des actes authentiques, auxquels précisément ce caractère authentique et la force exécutoire qui en découle sont conférés par l’intervention du notaire, délégataire du sceau de l’État qui exerce ainsi – comme vient encore de le rappeler le Conseil constitutionnel[2] – une prérogative de puissance publique ; et cela que l’authentification soit requise par la loi ou simplement souhaitée par les parties, c’est-à-dire pour tous les actes « auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité », pour reprendre l’expression de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (JO 3 nov.).
Dans ce domaine réservé, l’office du notaire est un office de juridiction, la juridiction de l’authenticité, juridiction amiable et préventive, exercée au nom de l’État. La formule de Réal dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI est toujours actuelle : « L’attribut le plus essentiel du notariat pour toutes les classes de citoyens, c’est d’authentiquer (sic) les conventions, d’en certifier la date et de leur donner, en les recevant, le caractère et la force de l’exécution parée. Le notaire exerce ici une partie de l’autorité de la justice ; ce qu’il écrit fait la loi des parties ».
La force exécutoire qui s’attache aux actes de ces professionnels investis de prérogatives de puissance publique est en effet un monopole de l’État qui se rattache au privilège du préalable : la présomption de légalité de l’acte dont ils vérifient et attestent la légalité et qu’ils signent avec les parties permet de lui reconnaître un caractère exécutoire, de lui reconnaître l’ensemble des effets de droit qu’il comporte. C’est en cela que la force exécutoire est liée à la juridiction, parce que celle-ci comporte une vérification préalable de la légalité de l’acte. Le Conseil constitutionnel, par une formule de principe, a rappelé dès 1998 que « toute décision de justice a force exécutoire »[3] ; à ne pas confondre, évidemment, avec l’autorité de chose jugée qui, au demeurant, n’est pas réservée à la justice étatique.
Or pas davantage que l’accès à la juridiction contentieuse, l’accès à la juridiction amiable ni même à la prérogative du caractère exécutoire n’est susceptible de relever d’une onérosité négociée qui permettrait de distinguer entre les juridictions ou entre les requérants.
C’est en effet le principe d’accès au juge, plus largement au service public de la justice, qui est ici en cause. Et si l’accès au juge peut n’être pas gratuit, il est gouverné par un principe d’égalité qui interdit de traiter différemment les requérants selon la façon dont ils exercent leur droit au juge.
Admettrait-on que les frais de timbres, l’aide juridictionnelle ou encore le droit de postulation puissent être négociés par ceux qui en sont les porteurs et dont l’office conditionne l’accès au juge ? Ainsi, à propos de l’aide juridictionnelle, le Conseil constitutionnel vérifie l’existence d’un tarif et le respect, dans le mode d’établissement de celui-ci, de l’égalité des usagers devant le tarif[4].
Qu’il s’agisse de prestations auxiliaires liées à l’accès au juge ou de l’exécution de ses décisions ou, plus évidemment encore, de l’accès directement à l’office du juge comme c’est le cas des notaires dans l’exercice de la juridiction amiable, le principe constitutionnel d’égalité dans l’exercice du droit au juge s’impose et veut lui-même l’unicité du tarif, sans possibilité de rabais négociés.
Ajoutons que le fait que le tarif s’impose au professionnel lui-même rejoint le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions, lui aussi principe de caractère constitutionnel[5]. L’impossibilité pour le professionnel de négocier la rémunération attachée à l’acte avec le demandeur d’authenticité ou d’exécution garantit une complète indépendance du premier par rapport aux parties à l’acte qu’il reçoit ou établit. Il reçoit ou établit l’acte et lui confère force exécutoire à des conditions tarifaires qui résultent mécaniquement de l’application du tarif arrêté par la puissance publique ; ainsi s’explique et se justifie, en particulier, l’interdiction faite aux notaires de renoncer à l’application du tarif.
Le principe d’égalité dans l’accès au juge s’impose ainsi, principe qui veut l’application d’un tarif arrêté par la puissance publique et impératif tant pour le juge ou les officiers publics associés à la juridiction ou exerçant la juridiction amiable que pour la généralité des usagers[6]. Cet égal accès au service public de la justice peut passer, soit par la gratuité, soit par un tarif ou des droits à la condition que ceux-ci soient établis de façon objective et pour la généralité des usagers. Il est incompatible avec la formule de rabais négociés, telle que prévue par le projet de loi sur la croissance et l’activité.
Et le Conseil constitutionnel, par des décisions répétées, a reconnu le caractère constitutionnel du droit au recours, élément nécessaire de la garantie des droits.[7]
Cette objection de constitutionnalité n’a apparemment pas été relevée par le Conseil d’État lorsqu’il a examiné l’avant-projet de loi. Cela n’interdit nullement de la faire valoir lors de l’examen parlementaire de celui-ci ou devant le Conseil constitutionnel s’il doit être saisi de l’ensemble de la loi votée avant sa promulgation.
B – Sur la fonction du tarif
Le tarif des professionnels concernés par le projet de loi n’a pas à ce jour d’abord pour fonction de rémunérer à leur juste coût les prestations correspondantes.
Bien sûr, il comporte cet élément mais, au-delà, il s’agit, par la détermination d’un tarif qui est le fait de la puissance publique, d’assurer à la fois une forme de péréquation interne tenant compte des actes – nombreux – établis à perte et aussi d’assurer le financement d’un véritable service public de la sécurité juridique confié à ces professionnels : conservation des actes ; institutions d’intérêt collectif comme le fichier des dernières volontés pour le notariat ; perception de droits et taxes ; collecte de renseignements administratifs ; alimentation du fichier immobilier, de différents registres ; recouvrement ; significations ; etc.
Le tarif n’est pas déterminé en fonction du coût de chaque prestation – comme l’on voudrait qu’il en soit demain – mais bien fixé unilatéralement par la puissance publique et appliqué par le professionnel qui ne peut en disposer. Et dans la fixation et la révision de ce tarif, la puissance publique veille à ce que, au bénéfice de compensations internes, le financement des activités d’intérêt général, de service public et de puissance publique confiées à ces professionnels soit assuré ainsi que le maillage géographique des offices, condition là encore de l’égal accès au service public.
Ce n’est pas sans raison que les notaires notamment dénoncent aujourd’hui le risque, avec le nouveau texte, d’un « désert juridique » auquel conduirait la liberté tarifaire ; surtout conjuguée avec la liberté d’installation, on va y venir.
On retiendra de ceci que le financement par les coûts unitaires des différents actes reçus ou établis par ces professionnels est radicalement incompatible avec la dévolution par la loi à ceux-ci du service public de la justice amiable ainsi que d’autres activités de service public ou de puissance publique ; et que, sur ce terrain encore, une discussion de constitutionnalité peut être ouverte.
II – La liberté d’installation et le droit de présentation
Le droit de présentation, un moment contesté et à propos précisément du droit de présentation des notaires, a été reconnu non contraire à la Constitution, en l’espèce l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, par une décision du Conseil constitutionnel du 21 novembre 2014[8]. Il est jugé que « s’ils participent à l’exercice de l’autorité publique et ont ainsi la qualité d’officier public nommé par le garde des Sceaux, les notaires titulaires d’un office n’occupent pas des “dignités, places et emplois publics” au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu au notaire de présenter son successeur à l’agrément du garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant ».
Ce brevet de constitutionnalité, en l’espèce de la loi du 28 avril 1816 instituant le droit de présentation pour différentes professions juridiques et judiciaires laisse entière la compétence du législateur pour l’organiser, le réglementer, voire le supprimer. Et c’est d’ailleurs apparemment ce que la loi pour la croissance et l’activité voudrait faire pour le droit de présentation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Elle procède différemment pour les autres professions concernées.
Le projet de loi déposé énonce un principe de la liberté d’installation (c’est le titre de cette section de la loi) : « Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée en qualité de (…) dans le lieu d’établissement de son choix ». La réserve du droit de présentation – réserve qui figurait dans l’avant-projet de loi en ces termes : « Cette titularisation est effectuée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sans préjudice du droit de présentation » – disparaît ou du moins n’est plus explicite dans le projet de loi déposé au Parlement.
Il était encore indiqué dans l’avant-projet de loi que l’installation des offices s’inscrit dans le cadre de recommandations émises par l’Autorité de la concurrence pour l’installation de ceux-ci et peut être refusée « pour des raisons tenant au nombre et aux caractéristiques des offices déjà installés sur le territoire où se situe le lieu d’implantation choisi ». Dans le projet de loi déposé, ceci est remplacé par une « cartographie », établie sur proposition de l’Autorité de la concurrence, des zones où l’implantation de nouveaux offices est libre. Un appel à manifestation d’intérêt est organisé sur la base duquel intervient la décision de titularisation. Les décisions refusant la titularisation doivent être motivées. Cette procédure, au demeurant fort complexe, doit être précisée par décret en Conseil d’État.
On lit dans ces changements de rédaction entre l’avant-projet de loi et le projet déposé au Parlement la prise en compte – mais est-elle suffisante ? – des réserves de constitutionnalité faites par le Conseil d’État lorsqu’il a examiné l’avant-projet de loi ; en un mot, s’il est confirmé que la loi peut disposer du droit de présentation, elle ne peut le faire que dans des conditions respectueuses du droit de propriété, du principe d’égalité devant les charges publiques et de la garantie des droits, consacrés respectivement par les articles 17, 6 et 13 de la Déclaration des droits de 1789.
A – Le droit de présentation, un statut législatif
Rappelons que la suppression du droit de présentation a fait l’objet historiquement de nombreux projets et propositions de loi dont aucun n’a abouti, butant en particulier sur la question dite du « rachat des charges », c’est-à-dire de l’indemnisation des titulaires d’office en place privés de la valorisation de leur office que permettait la présentation de leur successeur à la nomination du garde des Sceaux.
Pour s’en tenir à l’essentiel et parce que ceci semble avoir été absolument ignoré des rédacteurs de l’actuel projet de loi pour la croissance et l’activité, on rappellera que, sur la base d’une doctrine qui avait élaboré la théorie juridique de l’office ministériel analysé comme une propriété incorporelle, le droit de présentation fut menacé à plusieurs reprises par des initiatives parlementaires.
La proposition de loi « Fournière » du 12 janvier 1899 visait à la suppression du droit de présentation, présentée comme l’équivalent de l’abolition de tous les offices. C’était là son unique article, le texte renvoyant l’indemnisation des titulaires d’office à des lois de finances ultérieures et l’organisation des professions concernées à un règlement d’administration publique à venir. Tout aussi générale puisqu’elle visait pareillement tous les offices, la proposition « Clemenceau » du 23 octobre 1902 était plus complète en ce qu’elle réglait les conséquences de la suppression du droit de présentation. Les notaires devenaient des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, nommés et rétribués par l’État. L’indemnisation était prévue sur la base du prix d’achat des études. Une semblable fonctionnarisation était inscrite dans la proposition de loi « Gruet » du 9 juillet 1919, moyennant le rachat préalable de tous les offices. Ce même parlementaire reprit son projet, sans plus de succès, en mars 1933.
À la différence des initiatives précédentes, la proposition de loi « Saget » du 8 novembre 1920 concernait le seul notariat par la suppression du droit de présentation, perçue, cette fois encore, comme une abolition de la finance. En conséquence, un remboursement de la valeur des offices était prévu. Les notaires en exercice pouvaient, à leur demande, conserver leurs fonctions à titre personnel et viager tandis que les futurs notaires devaient être recrutés au concours.
Aucun de ces textes ne fut voté par les assemblées. Leur rappel n’en est pas moins fort instructif, car il s’en dégage notamment les observations suivantes. La suppression du droit de présentation est assimilée par tous à l’abolition de la vénalité des offices, voire des offices eux-mêmes. Dans la quasi-totalité de ces projets, les notaires sont fonctionnarisés, au titre des prérogatives de puissance publique qu’ils exercent. Enfin, toutes ces réformes, présentées comme des expropriations, comportent ou prévoient un train de mesures d’indemnisation.
Au début de la Ve République, le rapport « Rueff-Armand » ne préconisait pas, loin s’en faut, des mesures aussi radicales. Il se bornait à proposer la création de nouvelles études dans les cités et les régions en expansion ainsi qu’un abaissement du tarif pour les actes importants et pour les actes répétitifs.
Quelques années plus tard, des sorts inverses étaient réservés à des offices ministériels autres que les offices notariaux. Tandis que la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 (JO 2 déc.) fonctionnarisait les greffes des juridictions civiles et pénales, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (JO 5 janv. 1972) supprimait les offices d’avoués près les tribunaux de grande instance et ouvrait aux anciens avoués les portes de la nouvelle profession d’avocat. Dans le premier cas, l’office ministériel était absorbé dans la fonction publique ; dans le second, il rejoignait une profession libérale. Mais dans l’un et l’autre cas, une compensation pécuniaire égale à la valeur des offices supprimés était attribuée par l’État aux titulaires privés de leur charge et du droit de présentation correspondant.
Le rapport « Attali » en 2008 préconisait la suppression du numerus clausus pour un certain nombre de professions judiciaires dont les mandataires de procédure collective et les avocats aux conseils. S’agissant des notaires, il n’envisageait que « l’ouverture des activités de notaire à de nouveaux professionnels (…) afin de répondre à l’augmentation des besoins de service juridique personnel, et cela notamment au moment où il est envisagé de confier aux notaires des compétences très étendues en matière de divorce par consentement mutuel »[9]. Ce même rapport « Attali » invitait, en revanche, à la suppression des avoués près des cours d’appel pour les intégrer dans la profession d’avocat. Ce qui fut fait par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 (JO 26 janv.). À cette occasion, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi au titre du contrôle préventif, a rendu une décision importante sur l’indemnisation des avoués[10].
Ainsi le législateur dispose du droit de présentation ; et il l’a déjà fait pour différents offices ou charges. Reste qu’il ne peut le faire que dans des conditions respectueuses du droit de propriété et de la garantie des droits, principes eux-mêmes reconnus et consacrés tant par la Constitution que par le protocole n° 1 « relatif au droit aux biens » annexé à la Convention européenne des droits de l’homme. Ce qui se traduit par la nécessité de prévoir un mécanisme d’indemnisation approprié et non spoliatif.
B – La suppression du droit de présentation et le respect du droit de propriété, de l’égalité devant les charges publiques et de la garantie des droits
Quel est le mécanisme d’indemnisation prévu par le projet de loi pour la croissance et l’activité ?
Le projet de loi se borne à mettre en place une procédure d’indemnisation pour les hypothèses où cette installation hors présentation causerait à un titulaire d’office en place un préjudice répondant aux conditions d’indemnisation de la loi ; cette indemnisation serait alors à la charge du notaire nouvellement installé. Il n’y a pas, en effet, suppression du droit de présentation mais dévalorisation de celui-ci du fait de l’ouverture de la profession à la libre installation hors droit de présentation.
De la sorte est contournée l’objection d’une indemnisation générale par l’État des professionnels en place, puisque ceux-ci conservent leur droit de présentation et que, lorsque ce dernier est dévalorisé du fait de l’ouverture de la profession, une compensation indemnitaire est versée, curieusement mise à la charge du notaire nouvellement installé et non de l’État.
Cette façon de faire a été critiquée des points de vue constitutionnel et conventionnel par le Conseil d’État dans l’avis donné sur l’avant-projet de loi.
Que dit en effet l’avis du Conseil d’État ? Il admet que le projet de loi puisse poursuivre un objectif d’intérêt général en ouvrant les professions pour « susciter une offre plus dense, plus diversifiée et plus ouverte des services fournis par les offices et aménager un débouché aux professionnels salariés ». Mais cela ne peut se faire, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles, en posant tout uniment un principe selon lequel toute personne présentant les qualités suffisantes peut, sur la base d’une manifestation d’intérêt, « être titularisée dans le lieu d’établissement de son choix ».
Plus précisément, l’objectif d’ouverture de la profession, qui est, en lui-même, légitime de la part du législateur, ne peut pas passer par un principe de libre établissement tel que prévu par le projet de loi. S’y opposent le principe d’égalité devant les charges publiques et la garantie des droits, consacrés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de 1789.
En effet, ce dernier principe, celui de la garantie des droits, est interprété par le Conseil constitutionnel depuis 2007 comme interdisant, sauf motif d’intérêt général suffisant, de porter atteinte aux situations légalement acquises ou de remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations[11]. On sait que cette jurisprudence du Conseil constitutionnel n’est pas étrangère à la consécration par la Cour européenne des droits de l’homme du principe de confiance légitime qui protège comme un bien l’espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un élément du droit de propriété
En l’espèce, en termes de proportionnalité, le motif d’intérêt général d’ouverture de la profession n’est pas jugé suffisant pour porter une atteinte de cette gravité à la garantie des droits des professionnels en place. Le préjudice ainsi causé aux professionnels en place serait, en l’absence d’un dédommagement adéquat, « trop grave pour ne pas méconnaître ces garanties constitutionnelles » ; serait en effet substantiellement réduite la valeur patrimoniale des offices existants, ladite valeur résultant du droit de présentation et des dispositions légales actuelles subordonnant la création de nouveaux offices à une procédure de concertation avec la profession et à une indemnisation des titulaires des offices concernés.
Pour tenir compte de ces critiques, des modifications – que l’on peut juger largement rédactionnelles – ont été apportées à l’avant-projet, et est ainsi apparue, dans le projet de loi déposé, la distinction, qui devrait se faire sur la base des recommandations de l’Autorité de la concurrence, de « zones où l’implantation d’offices est libre » et de « zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu » ; le nombre des zones où l’implantation d’offices est libre devant être progressivement augmenté.
Il s’agit en réalité de nouvelles modalités du même parti de substitution au maillage géographique administré actuel d’un principe de libre installation, laquelle, même si elle est annoncée comme devant se faire progressivement, ne met pas, selon moi, la réforme à l’abri des critiques de constitutionnalité qu’appelle le principe même d’une libre installation, telles que ces critiques ont été formulées dans l’avis du Conseil d’État.
À quoi s’ajoute que l’ouverture de la profession se ferait au rythme et sur la base des recommandations de l’Autorité de la concurrence dont ce n’est ni la mission ni le domaine de compétence.
III – L’indemnisation par le nouvel arrivant
On s’intéressera encore aux dispositions du projet de loi prévoyant que l’indemnisation éventuelle des offices en place lésés par l’installation « libre » d’un nouvel office serait à la charge de ce dernier : lorsqu’il y a lieu à indemnisation du fait d’une installation dans une zone déjà « desservie », le projet de loi met en place un curieux mécanisme d’expropriation pour cause d’utilité privée qui désigne le notaire qui s’installe comme débiteur de l’indemnité d’expropriation.
Ceci mérite d’être discuté, du seul point de vue du droit. C’est en effet la responsabilité de l’État qui, en réalité, est ici en cause, responsabilité sans faute du fait du dispositif de la loi nouvelle, responsabilité dont le transfert au nouveau professionnel qui s’installe comporte une rupture de l’égalité devant les charges publiques et méconnaîtrait ainsi l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789.
En outre, les mesures prévues par le projet de loi paraissent insuffisantes ou inappropriées, en ce qu’elles ne prévoient une indemnisation qu’à des conditions très restrictives et en ce qu’elles confèrent à l’Autorité de la concurrence, dit le Conseil d’État, « des prérogatives étrangères à sa mission fondamentale et contradictoires entre elles : en la conduisant à statuer sur un préjudice qu’elle aurait contribué à causer, elles placeraient en effet l’Autorité dans une situation peu propice à l’accomplissement serein de ses nouvelles fonctions ».
IV – Les renvois à des ordonnances de l’article 38 de la Constitution
Le projet de loi actuellement débattu comporte, dans ses articles 20, 21 et 22, le renvoi à des ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour fixer, par voie réglementaire, des aspects importants de la réforme des professions réglementées en cause. Il s’agit – pour faire bref – : de la création d’une profession unique regroupant les huissiers de justice, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ; du recrutement par concours des greffiers des tribunaux de commerce ; de la création de sociétés d’exercice commun à plusieurs professions juridiques et judiciaires et d’expertise comptable ; de l’ouverture du capital des professions juridiques et judiciaires ; enfin de la création des sociétés d’exercice libéral. Ces habilitations figuraient déjà, dans des termes un peu différents, dans l’avant-projet de loi tel qu’il a été examiné par le Conseil d’État.
La technique des ordonnances de l’article 38 de la Constitution, déjà très – trop – pratiquée depuis longtemps, a été annoncée récemment comme devant être systématique aujourd’hui pour des raisons d’accélération des procédures et d’encombrement du Parlement. Il faut bien comprendre que, pour être inscrite dans la Constitution (ce qui ne s’est d’ailleurs pas fait sans hésitation en 1958), elle constitue une forme de défausse du pouvoir législatif sur l’autorité réglementaire et que, à ce titre, elle est naturellement contrôlée par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel vérifie que les termes de la loi d’habilitation, en l’espèce les articles que j’ai rappelés du projet de loi « Macron », ne comportent aucune inconstitutionnalité et sont suffisamment précis pour encadrer l’intervention de l’autorité réglementaire ; le Conseil d’État vérifie, tant que l’ordonnance n’a pas été ratifiée, que celle-ci respecte l’ensemble des règles constitutionnelles, et aussi les termes de la loi d’habilitation ; enfin, depuis la réforme constitutionnelle de 2008 (L. const. n° 2008-724, 23 juill. 2008, JO 24 juill.), les ordonnances sont nécessairement soumises au Parlement pour ratification et, à l’occasion de la loi de ratification, le contrôle du Conseil constitutionnel peut à nouveau s’exercer.
Dans le cas présent, des réserves ont été faites par le Conseil d’État à l’occasion de l’examen de l’avant-projet de loi, portant notamment sur la possibilité de créer une profession unique regroupant les huissiers de justice, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires. Dans le débat parlementaire actuel, il est donc légitime de s’interroger à nouveau sur la portée de ces habilitations et sur la nécessité, pour le législateur, d’encadrer strictement le pouvoir réglementaire ; ce qui pourrait contraindre ce dernier à s’écarter de projets d’ordonnance qui – a-t-on dit – sont déjà pratiquement rédigés.
Et maintenant je me tais. Il faudra suivre les travaux d’examen du projet de loi pour voir comment ces textes évolueront ; et, éventuellement, contribuer à alimenter la discussion parlementaire.
Reste que, dans les limites de cette réflexion d’étape, on a des raisons de penser que la réforme, telle qu’elle est engagée, demeure exposée aux critiques de constitutionnalité portant sur le principe même d’un dispositif consistant à organiser sur un modèle de libre installation et de libre concurrence des professions réglementées d’officiers publics investis de prérogatives de puissance publique et de juridiction et délégataires du service public de la sécurité juridique.
[1] Cet article est la retranscription de la synthèse générale du colloque organisé par l’Université Panthéon-Assas le 14 janvier dernier, sur le thème « Les professions juridiques. Service public et déréglementation ». Il est précédemment paru in JCP N 2015, n° 6, 1071.
[2] Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-429 QPC
[3] Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, Rec. Cons. const., p. 276.
[4] Cons. const., 25 nov. 2011, n° 2011-198 QPC, Rec. Cons. const., p. 553.
[5] V. par exemple Cons. const., 8 juin 2012, n° 2012-250 QPC, Rec. Cons. const., p. 281.
[6] V. par exemple Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC.
[7] V. par exemple Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, Rec. Cons. const., p. 43 ; Cons. const., 13 mai 2011, n° 2011-129 QPC, Rec. Cons. const., p. 239 ; Cons. const., 17 juin 2011, n° 2011-138 QPC, Rec. Cons. const., p. 281 ; Cons. const., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC, Rec. Cons. const., p. 605 ; Cons. const., 13 sept. 2013, n° 2013-338/339 QPC.
[8] Cons. const., 21 nov. 2014, n°2014-429 QPC, précité.
[9] Attali J. (dir.), Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, 2008, Décision 216.
[10] Cons. const., 20 janv. 2011, n° 2010-624 DC, Rec. Cons. const., p. 67.
[11] Cons. const., 27 févr. 2007, n° 2007-350 DC ; Cons. const., 19 déc. 2013, n° 2013-682 DC.
Par Yves Gaudemet, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Membre de l’Institut
Paru in Dr. & Patr. 2015, n° 245, p. 22 (mars 2015).