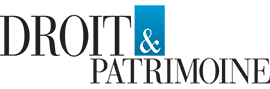Notes
(1)
L. no 2014-779, 8 juill. 2014, habilitant le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.
Retour au texte
(2)
C. propr. intell., art. L. 132-1, L. 132-2 et L. 132-3, modifiés par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 3.
Retour au texte
(3)
C. propr. intell., art. L. 132-9, modifié par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 5.
Retour au texte
(4)
C. propr. intell., art. L. 132-11, modifié par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 6.
Retour au texte
(5)
C. propr. intell., art. L. 132-17, modifié par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 7.
Retour au texte
(7)
C. propr. intell., art. L. 132-17-1, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8, et Arr. 10 déc. 2014, § 1.
Retour au texte
(9)
C. propr. intell., art. L. 132-17-5, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8, et Arr. 10 déc. 2014, § 3.
Retour au texte
(12)
C. propr. intell., art. L. 132-17-2, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8, et Arr. 10 déc. 2014, § 4 et s.
Retour au texte
(15)
C. propr. intell., art. L. 132-17-3, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8, et Arr. 10 déc. 2014, § 7.
Retour au texte
(16)
C. propr. intell., art. L. 132-17-3, al. 2 à 6, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8 ; Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 11.
Retour au texte
(17)
C. propr. intell., art. L. 132-17-4, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8, et Arr. 10 déc. 2014, § 8.
Retour au texte
(18)
C. propr. intell., art. L. 132-17-6, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8 ; Arr. 10 déc. 2014, § 5 et Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 11.
Retour au texte
(19)
C. propr. intell., art. L. 132-17-7, créé par Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 8 ; Arr. 10 déc. 2014, § 6, et Ord. no 2014-1438, 12 nov. 2014, art. 12.
Retour au texte
(21)
C. propr. intell., art. L. 135-1 à L. 135-7, créé par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 4.
Retour au texte
(22)
C. propr. intell., art. L. 211-7, créé par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 5.
Retour au texte
(23)
C. propr. intell., art. L. 211-4, I et II, modifié par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 1er.
Retour au texte
(24)
C. propr. intell., art. L. 212-3-1, créé par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 2, et R. 213-8, créé par D. no 2015-506, 6 mai 2015, art. 2.
Retour au texte
(25)
C. propr. intell., art. L. 212-3-2, créé par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 2.
Retour au texte
(26)
C. propr. intell., art. L. 212-3-3, créé par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 2.
Retour au texte
(27)
C. propr. intell., art. L. 212-3-4, créé par L. no 2015-195, 20 févr. 2015, art. 2.
Retour au texte
(29)
CJUE, 21 oct. 2014, aff. C-348/13, BestWater International c/ M. Mebes et S. Potsch, Comm. com. électr. 2014, comm. 92, note Ch. Caron, JCP E 2014, 1063, note G. Busseuil, LEPI 2015, no 1, p. 3, note C. Bernault, RLDI 2014/110, éclairage L. Dubois et F. Gaulier, RTD com. 2014, p. 808, note crit. F. Pollaud-Dulian.
Retour au texte
(30)
CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12, Svensson, v. cette chronique in Dr. & patr. 2014, no 240, p. 89 et nos obs.
Retour au texte
(31)
CJUE, 26 mars 2015, aff. C-279/13, C More Entertainment AB c/ Linus Sandberg, JCP G 2015, 419, obs. F. Picod, Comm. com. électr. 2015, comm. 40, note Ch. Caron, RLDI 2015/116, éclairage S. Dormont.
Retour au texte
(32)
V. déjà pour une approche divergente de la notion de communication au public figurant dans les dispositions des directives nos 2001/29/CE et 92/100/CEE, CJUE, 15 mars 2012, aff. C-135/10, Del corso, v. cette chronique in Dr. & patr. 2012, no 218, p. 88 et nos obs.
Retour au texte
(33)
CJUE, 13 mai 2015, aff. C-516/13, Dimensione direct Sales Srl c/ Knoll International SpA, Comm. com. électr. 2015, comm. 56, note Ch. Caron, LEPI 2015, no 7, p. 2, note A. Lebois, Europe 2015, comm. 278, note V. Michel.
Retour au texte
(34)
CJCE, 4e ch., 17 avr. 2008, aff. C-456/06, Peek & Cloppenburg c/ Cassina SpA, v. cette chronique in Dr. & patr. 2008, no 174, p. 81 et nos obs.
Retour au texte
(35)
CJUE, 21 juin 2012, aff. C-5/11, Donner, pt 30 ; CJUE, 6 févr. 2014, aff. C-98/13, M. Blomqvist c/ Rolex et a., pt 32, v. cette chroniquein Dr. & patr. 2014, no 240, p. 88 et nos obs.
Retour au texte
(36)
CJUE, 4e ch., 22 janv. 2015, aff. C-419/13, Art & Allposters International BV c/ Stichting Pictoright, Comm. com. électr. 2015, comm. 18, note Ch. Caron, D. 2015, p. 776, note C. Maréchal, JCP E 2015, 133, obs. F. Picod, LEPI 2015, no 3, p. 1, note A. Lebois, Europe 2015, comm. 123, note L. Idot, RLDI 2015/116, éclairage S. Dormont.
Retour au texte
(37)
CJCE, 5e ch., 1er juill. 1999, aff. C-173/98, Sebago, Rec. CJCE 1999, I, p. 04103.
Retour au texte
(38)
CJUE, 5 mars 2015, aff. C-463/12, Copydan Bandkopi c/ Nokia Danmark, Comm. com. électr. 2015, comm. 30, note Ch. Caron, Europe 2015, comm. 200, note D. Simon, LEPI 2015, no 5, p. 2, note C. Bernault.
Retour au texte
(39)
CJUE, 21 oct. 2010, aff. C-407/09, Padawan ; CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09, Stichting de Thuiskopie, v. cette chronique in Dr. & patr. 2011, no 207, p. 94 et nos obs. ; CJUE, 27 juin 2013, aff. jtes. C-457/11 à C-460/11, VG Wort, et CJUE, 11 juill. 2013, aff. C-521/11, Amazon, v. cette chronique in Dr. & patr. 2014, no 240, p. 91 et nos obs. ; CJUE, 4e ch., 10 avr. 2014, aff. C-435/12, ACI Adam.
Retour au texte
(40)
CJUE, gde ch., 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Johan D. et Vrijheidsfonds VZW c/ Helena V. et a., Comm. com. électr. 2014, comm. 82, note Ch. Caron, Gaz. Pal. 2015, no 64, p. 14, chron. L. Marino, LEPI 2014, no 10, p. 1, note C. Bernault, D. 2014, p. 2097, note B. Galopin, RLDI 2014/108, éclairage C. Castet Renard, et no 3577, note Ph. Mouron, RTD com. 2014, p. 815, note F. Pollaud-Dulian.
Retour au texte
(41)
CJUE, 11 sept. 2014, aff. C-117/13, Technische Universitär Darmstadt c/ Eugen Ulmer KG, Comm. com. électr. 2014, comm. 83, note Ch. Caron, LEPI 2014, no 10, p. 2, note A. Lucas-Schloetter, Gaz. Pal. 2015, no 64, p. 16, note L. Marino, RLDI 2014/108, note G. Busseuil, RTD com. 2014, p. 810, note F. Pollaud-Dulian.
Retour au texte
(42)
BGH, 16 avr. 2015, Technische Universität Darmstadt c/ Eugen Ulmer, LEPI 2015, no 7, p. 3, note A. Lucas-Schloetter.
Retour au texte
(43)
Cass. 1re civ., 7 mars 1984, no 82-17.016, Bull. civ. I, no 90.
Retour au texte
(44)
Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, no 13-14.532, Comm. com. électr. 2014, comm. 91, note Ch. Caron, LEPI 2014, no 10, p. 2, note A. Lebois, RTD com. 2014, p. 818, note F. Pollaud-Dulian.
Retour au texte
(45)
V. notamment cette chronique in Dr. & patr. 2013, no 228, p. 65 et nos obs.
Retour au texte
(46)
Cass. 1re civ., 24 janv. 2014, no 13-12.675, Bull. civ. I, no 12.
Retour au texte
(47)
CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-41/1, Christie’s France SNC c/ Syndicat national des antiquaires, Comm. com. électr. 2015, comm. 29, note Ch. Caron, Comm. com., électr. 2015, étude 9, par F. Pollaud-Dulian, D. 2015, p. 567, obs. J. Daleau, Gaz. Pal. 2015, no 197, p. 20, note L. Marino, LEPI 2015, no 4, p. 3, note A. Lucas, RLDI 2015/114, éclairage F. Valentin et X. Près.
Retour au texte
(48)
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, no 13-12.675, JCP G 2015, 718, obs. P. Boiron.
Retour au texte
(49)
Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, no 95-22.282, Bull. civ. I, no 75.
Retour au texte
(50)
Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, no 13-22.401, Comm. com. électr. 2015, Comm. 2, note Ch. Caron, Comm. com. électr. 2015, chron. 4, no 2, obs. X. Daverat, D. 2015, p. 410, note A. Etienney de Sainte Marie, LEPI 2015, no 1, p. 4, note C. Bernault, RTD com. 2015, p. 291, note F. Pollaud-Dulian.
Retour au texte
(51)
T. confl., 7 juill. 2014, no 3954, M. A c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, et no 3955, M. A c/ Conseil général de Meurthe-et-Moselle, LEPI 2014, no 9, p. 7, note D. Lefranc, Comm. com. électr. 2014, comm. 76, note Ch. Caron, Gaz. Pal. 2014, no 310, p. 15, note L. Marino, RTD com. 2014, p. 611, note F. Pollaud-Dulian,
Retour au texte
(52)
T. confl., 2 mai 2011, no 3770, v. cette chronique in Dr. & patr. 2011, no 207, p. 90 et nos obs.
Retour au texte
(53)
CJUE, 22 janv. 2015, aff. C-441/13, Pez Hejduk c/ Energie Agentur NRW GmbH, Europe 2015, comm. 132, note L. Idot, Gaz. Pal. 2015, no 197, p. 20, note L. Marino, JCP G 2015, 421, note M. Attal, LEPI 2015, no 3, p. 7, note A Lucas, Proc. 2015, comm. 81, note C. Nourissat, RLDI 2015/114, éclairage X. Près.
Retour au texte
(54)
CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-170/12, Peter Pinckney c/ KDG Mediatech AG ; v. cette chronique in Dr. & patr. 2014, no 240, p. 95 et nos obs.
Retour au texte
(55)
CJUE, gde ch., 18 oct. 2011, aff. C-34/10, Brüstle, v. cette chronique in Dr. & patr. 2012, no 218, p. 91 et nos obs.
Retour au texte
(56)
CJUE, gde ch., 18 déc. 2014, aff. C-364/13, International Stem Cell Corporation c/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, Europe 2015, comm. 83, note S. Roset, Gaz. Pal. 2015, no 64, p. 17, note L. Marino, JCP G 2015, 135, note C. Byk, JCP E 2015, 1209, note A. Mendoza-Caminade, LEPI 2015, no 2, p. 1, note J.-P. Clavier, RTD civ. 2015, p. 97, obs. J. Hauser.
Retour au texte
(58)
CJUE, 16 juill. 2015, aff. C-170/13, Huawei Technologies c/ ZTE Corp. et a., Comm. com. électr. 2015, comm. 65, note Ch. Caron.
Retour au texte
(59)
Licence consentie dans des conditions raisonnables équitables et non discriminatoires.
Retour au texte
(60)
V. déjà sur ce type de défense, les décisions de la Commission dans les affaires « Samsung » et « Motorola » citées par N. Petit,in Le droit européen de l’abus de position dominante en 2014, Comm. com. électr. 2015, étude 3.
Retour au texte
(61)
V. cette chronique in Dr. & patr. 2014, no 240, p. 100 et nos obs.
Retour au texte
(62)
C. propr. intell., art. D. 712-29, créé par D. no 2015-671, 15 juin 2015, art. 1er.
Retour au texte
(63)
C. propr. intell., art. D. 712-30, créé par D. no 2015-671, 15 juin 2015, art. 1er.
Retour au texte
(64)
CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-421/13, Apple Inc. c/ Detsches Patent und Markenamt, LEPI 2014, no 9, p. 6, note J.-P. Clavier, Propr. industr. 2014, comm. 62, note A. Folliard-Monguiral, Propr. intell. 2014, no 53, p. 422, obs. B. Geoffray, Gaz. Pal. 2014, no 310, p. 17, note L. Marino, D. 2015, p. 230, chron. J.-P. Clavier, N. Martin-Braz et C. Zolynski, no 19.
Retour au texte
(65)
CJCE, 24 juin 2004, aff. C-49/02, Heidelberger Beauchemie GmbH, Rec. CJCE, I, p. 06129.
Retour au texte
(66)
CJCE, 7 juill. 2005, aff. C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Rec. CJCE, I, p. 05873.
Retour au texte
(67)
CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-420/13, Netto Marken-Discount AG & Co. KG c/ Deutsches Patent- und Markenamt, LEPI 2014, no 9, p. 6, note J.-P. Clavier, Propr. industr. 2014, comm. 63, note A. Folliard-Monguiral, D. 2015, p. 230, chron. J.-P. Clavier, N. Martin-Braz et C. Zolynski, no 20.
Retour au texte
(68)
CJUE, 21 févr. 2013, aff. C-561/11, v. cette chronique in Dr. & patr. 2013, no 228, p. 72 et nos obs.
Retour au texte
(69)
CJUE, 10 mars 2015, aff. C-491/14, Rosa dels Vents Assessoria SL c/U Hostels Albergues Juveniles SL, LEPI 2015, no 5, p. 1, note F. Herpé.
Retour au texte
(70)
CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-325/13 et C-326/13, Peek et Clopenburg KG, c/ OHMI et a., LEPI 2014, no 9, p. 5, note S. Chatry, D. 2015, p. 230, chron. J.-P. Clavier, N. Martin Braz et C. Zolynski, no 19.
Retour au texte
(71)
V. également CJUE, 29 mars 2011, aff. C-96/09 P, pt 159.
Retour au texte
(72)
TUE, 30 sept. 2014, aff. T-51/12, Scooters India Ltd. c/ OHMI, LEPI 2014, no 11, p. 6, note J.-P. Clavier, Propr. industr. 2014, comm. 76, note A. Folliard-Monguiral.
Retour au texte